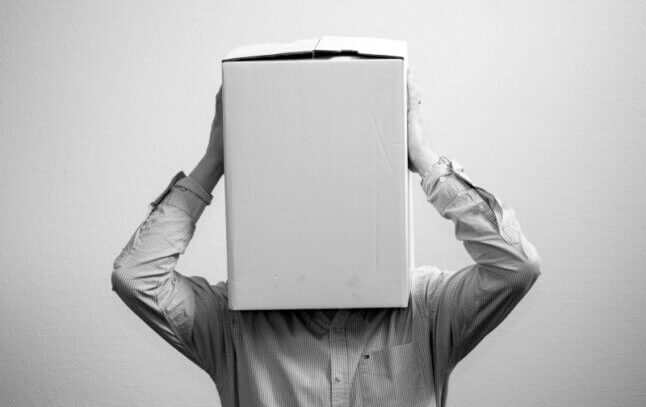Les professionnels de la transition écologique et sociale ont le blues. Encore inconnus il y a 20 ans, les métiers du développement durable et de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) sont aujourd'hui en plein essor. Consultants spécialisés, experts en stratégie de durabilité, responsables RSE ou "chief impact officers"... Ils font désormais partie d'un écosystème professionnel très actif, alors que la transformation durable des entreprises est plus que jamais urgente. Pourtant, derrière l'apparence de métiers utiles, au service de l'intérêt général, se cache une réalité professionnelle souvent difficile. Greenwashing, manque de moyens, désillusions et doutes, éco-anxiété : voilà le quotidien de ces professionnels, souvent jeunes, souvent des femmes, qui ont décidé de dédier leur carrière à la transformation durable de notre économie, et qui se heurtent à l'inertie du système.
Diana* est l'une de ces professionnelles de la transition durable. Après des études dans une grande école d'ingénieur, elle veut se lancer dans le développement durable, un secteur porteur de sens, qui a le vent en poupe, aux lendemains de la COP21. Elle trouve un stage, qui devient CDD, puis CDI dans une petite agence de conseil et formation parisienne dédiée aux enjeux du développement durable. Elle y reste six ans durant lesquels elle enchaîne les missions, surtout avec des grandes entreprises du CAC40. Elle fait tantôt du consulting, tantôt de la formation avec des Fresques du Climat, ces ateliers ludiques de sensibilisation sur la crise climatique… Sur le papier, le boulot a du sens : aider les entreprises à devenir plus "vertes". Dans les faits ? Diana garde surtout un souvenir amer de cette expérience : "On arrive dans ce métier pour faire bouger les choses, parce qu'on se dit que sans ça, on va dans le mur, mais rapidement, on comprend que tout ça c'est du bullshit".
La première désillusion, explique-t-elle, c'est le sentiment de solitude, la difficulté à convaincre et mobiliser autour des enjeux écologiques et sociaux. "La plupart des gens dans le monde de l'entreprise n'en ont rien à faire de la crise écologique, la priorité c'est le business", explique la trentenaire.
"La plupart des gens n'en ont rien à faire"
Sylvie, elle, est responsable RSE dans une grande entreprise industrielle, et elle partage elle aussi ce constat. "Globalement, les gens s'en foutent, il y a une certaine apathie. Ils ont beau s'inquiéter, la plupart d'entre eux font l'autruche aussi. Personne ne voit vraiment ça comme une crise existentielle." Dans son entreprise, elle porte à bout de bras les sujets RSE, mais décrit la frustration de ne pas parvenir à mobiliser autour d'elle. "Les gens sont pris dans leur quotidien, ils ont la pression de leur hiérarchie, ils ont des objectifs financiers… alors la RSE, ça passe au second plan". Même dans les instances qui sont supposées être garantes de la RSE et de la durabilité, le sujet n'infuse pas : "On a encore des gens dans notre comité RSE qui ne connaissent rien du tout aux enjeux, qui ne savent même pas ce que veut dire RSE", se lamente-t-elle.
Pour Fabrice Bonnifet, président du Collège des Directeurs du Développement durable (C3D), association qui réunit près de 400 professionnels du secteur, le blocage vient bien souvent "d'en haut", notamment des directions. "Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises manquent d'un vrai leadership sur la transition écologique et sociale, le management et les cadres dirigeants ne comprennent pas l'urgence de la crise", explique-t-il. Plusieurs études ces derniers mois ont en effet montré le manque d'implication des dirigeants et des managers dans les politiques RSE de leurs entreprises : la majorité des conseils d'administration considèrent même que cela ne fait pas partie de leurs attributions. Or, comme l'explique Hélène, consultante spécialisée :"Sans le soutien de la direction tu te débats toute seule, tu n'as pas les outils, pas les moyens d'agir."
Le manque de moyens, voilà ce qui revient le plus quand on interroge les professionnels du secteur. Diana raconte : "les clients te demandent de tout faire, leur stratégie climat, leur reporting, leur analyse de matérialité… mais ils n'ont pas envie de mettre de budget, et n'ont pas assez de monde en interne pour s'en occuper… Forcément, on ne fait pas grand chose de sérieux…" Même constat pour Gaspard, qui a lui aussi été consultant pendant près de trois ans dans une autre agence : "j'avais souvent le sentiment très frustrant de ne pas pouvoir aller au bout des choses, avec des clients qui nous disaient : "oui, oui, c'est intéressant ce que vous proposez, mais on n'a pas le budget…"
Malgré les discours affichés publiquement, dans les entreprises, la transition écologique et sociale et la RSE est souvent reléguée au second plan, avec des budgets et des moyens humains et techniques limités, comme le rappelait tout récemment le rapport publié par la Plateforme RSE. Les professionnels interrogés par Novethic racontent tous des dizaines d'anecdotes similaires. Une entreprise qui refuse d'agir sur sa plus grosse source d'émissions de gaz à effets de serre, car cela serait trop coûteux. Une autre qui préfère mettre en valeur la suppression des gobelets à la machine à café, moins cher. Une autre encore qui se contente de faire un "séminaire RSE" pour sensibiliser ses salariés. Sans compter les entreprises qui multiplient les "formations", "ateliers de sensibilisation" et autres formats "inspirants", sans stratégie globale. Julianne, consultante, soupire : "certaines entreprises gaspillent complètement leurs ressources sur des projets peu utiles". Un exemple ? "On a travaillé pour un client sur un projet à 40 000 euros… Sans que l’entreprise ait cadré les objectifs précisément au départ. Malgré de bonnes intentions, je ne suis pas certaine que le projet ait servi à grand chose. Heureusement, c'est plutôt une exception."
C'est "business first"
Ils sont ainsi nombreux à décrire un univers professionnel où tout ou presque tourne autour de la communication. "Beaucoup de nos clients, pas tous, étaient là pour cocher des cases, pour remplir des lignes dans leurs rapports RSE", confirme Diana. La consultante raconte l'enchaînement de petites missions de façade, mises en place sans vision globale, uniquement pour de l'affichage : "pendant une période, je ne faisais que des Fresques chez les clients, qui voulaient dire "on a formé nos salariés"... Fresque du Climat, Fresque de ci, Fresque de ça… mais en réalité, je me retrouvais à sensibiliser les stagiaires et les alternants, c'était inutile." Gaspard, de son côté, décrit ces entreprises qui font appel à des consultants "uniquement pour avoir un label" : "en matière de mobilité durable, certaines entreprises venaient nous voir non pas pour nous écouter, mais avec une idée préconçue et un objectif : obtenir la certification qui leur donne accès aux subventions." La formation, les Fresques et les labels deviennent alors des prétextes pour donner l'impression d'agir, sans transformer fondamentalement le modèle d'affaires.
Dans son entreprise, Sylvie raconte ainsi le décalage entre les communications officielles autour de la stratégie RSE et la réalité quotidienne de l'entreprise : "On prétend être "responsables", mais ce qui reste prioritaire, ce sont nos objectifs financiers. Tant que la RSE n'est pas dans les fiches de poste, concrètement, cela bouge lentement." Malgré les outils réglementaires déployés ces dernières années dans le domaine de la RSE et de la transition écologique, beaucoup d'actions mises en œuvre par les acteurs du monde de l'entreprise restent ainsi du domaine du déclaratif. Les entreprises affichent leurs "raisons d'être" ou leurs statuts de "société à mission", mais n'alignent pas véritablement leurs pratiques commerciales, marketing ou opérationnelles sur des objectifs écologiques ou sociaux.
Le secteur est d'ailleurs bien souvent accusé de greenwashing, notamment dans les cabinets de conseil, souvent pointés du doigt pour leurs prestations complaisantes. Au point que certains professionnels ont parfois le sentiment de travailler contre leurs convictions. Diana raconte : "Je préparais des slides de formation sur la finance durable, et notre client, une banque, nous demandait de ne pas mentionner le financement des énergies fossiles. Trop gênant par rapport à leurs activités. Et le pire, c'est que mon directeur était tout à fait d'accord avec ça… J'étais tellement en colère !"
Pour les clients comme dans les agences, c'est "business first". "On est schizophrènes", se désole Hélène : "on parle de sobriété, de durabilité, et en même temps on nous demande de faire plus de 40% de rentabilité sur chaque mission de conseil…". Finalement, beaucoup considèrent que le secteur est dominé par les opportunistes, "qui font de l'argent en se persuadant qu'ils sont des champions de l'intérêt général et de l'écologie…". "On finit par se demander si en travaillant dans ce secteur, on ne contribue pas à pérenniser un système pourri de l'intérieur, et si finalement, la seule solution n'est pas la révolution", ironise Hélène.
Impuissance et éco-anxiété
Face à cette inertie, beaucoup d'experts de la transition écologique en entreprise se disent "à bout", "épuisés", "usés". Fabrice Bonnifet lâche : "j'en parlais récemment avec Jean-Marc Jancovici [ingénieur spécialisé dans les enjeux climatiques, NDLR] et on se disait que malgré nos efforts depuis des années, ça n'avance pas." Ceux qui sont dans le secteur depuis longtemps partagent souvent ce sentiment d'impuissance et la frustration qu'il génère. A force, c'est une fatigue mentale qui s'installe, et plusieurs parmi les professionnels interrogés nous ont avoué avoir traversé des périodes très difficiles. "J'ai fini par faire un burn-out, tout en continuant à travailler", avoue Hélène, avant d'ajouter, désabusée : "mais tout ça, c'est monnaie courante dans le secteur."
Quand ce n'est pas de l'épuisement, c'est l'éco-anxiété qui domine. Souvent submergés par l'ampleur des défis de la transformation qu'ils incarnent dans leur entreprise et par les conséquences d'une inaction qu'ils ne peuvent que constater, les professionnels de la durabilité angoissent. "Ca devient complètement épuisant de penser à ces sujets, de traiter tous les jours de "la fin du monde", c'est très anxiogène", confie Sylvie. Au quotidien, les professionnels du développement durable sont en effet les témoins des conséquences écologiques, sociales et humaines du système économique moderne, et ils croulent bien souvent sous les mauvaises nouvelles : crises sociales, inégalités, records de chaleur, extinction d'espèces vivantes... "Obligés de vivre avec l'éco-anxiété", ils doivent, comme l'explique Hélène, "apprendre à accepter l'inacceptable, tout en étant capable de se dire que tout ne repose pas sur [leurs] épaules." C'est là tout le paradoxe de ces fonctions, construites sur l'idée qu'elles doivent "avoir un impact", "changer les choses".
Lassés, désabusés, certains finissent par changer de carrière. C'est le cas de Diana, qui a préféré se consacrer au monde associatif. Gaspard, lui, a quitté le conseil pour rejoindre une structure qui fait la promotion de la mobilité durable. Fabrice Bonnifet continue malgré tout à travailler, notamment avec le C3D pour faire bouger les lignes. Sylvie, Julianne ou encore Hélène continuent de se battre pour rendre le système économique plus soutenable. "Malgré toutes les difficultés, on voit qu'on arrive à faire évoluer les choses petit à petit, et que de plus en plus de personnes dans les entreprises sont sensibilisées et prêtes à agir", tempère Hélène. Avec les nouvelles réglementations, la directive européenne sur le reporting (CSRD) ou celle sur le devoir de vigilance, "les entreprises sont obligées de bouger", ajoute la consultante. Pas assez vite peut-être, mais suffisamment pour donner de l'espoir à celles et ceux qui se sont engagés dans ces métiers pour changer les choses.
* Les prénoms ont été modifiés