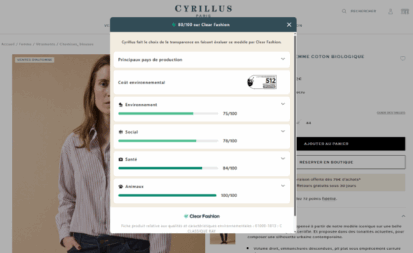Des impacts environnementaux encore largement invisibilisés
L’intelligence artificielle repose sur une infrastructure énergétique et matérielle lourde. L’entraînement des modèles les plus puissants consomme d’immenses quantités d’électricité, d’eau et de ressources naturelles, tout en générant une empreinte carbone difficile à évaluer, faute de données disponibles. Si des acteurs comme Mistral AI commencent à ouvrir la voie en publiant un rapport d’impact environnemental, la majorité des entreprises du secteur restent opaques. À cela s’ajoutent les risques liés à l’extraction de matières premières, concentrée dans des zones géopolitiquement sensibles et socialement vulnérables, qui interrogent la résilience de la chaîne de valeur de l’IA. En dépit des discours technosolutionnistes qui font de l’IA un outil au service de la transition écologique, les effets rebonds et externalités négatives pourraient bien contrebalancer les bénéfices attendus.
Une reconfiguration du travail et de nouveaux risques sociaux
Sur le plan social, l’IA transforme en profondeur le marché du travail. Si certains évoquent la « substitution massive » des emplois par les machines, la réalité est plus complexe : on assiste à une digitalisation du travail, déléguée à une armée de microtravailleurs précaires, souvent basés dans des pays à bas revenus. Ce digital labor, indispensable au fonctionnement des systèmes d’IA, est invisible, non protégé et très rarement encadré par des normes sociales. Par ailleurs, les biais algorithmiques, en particulier en matière de genre, d'origine ou de classe sociale, restent insuffisamment traités, malgré leurs effets concrets sur la société, creusant les inégalités (les processus de recrutement, d’accès au crédit ou de maintien dans l’emploi). Ces dérives, déjà documentées, appellent à une gouvernance plus exigeante et à un encadrement réglementaire renforcé, notamment au sein de l’Union européenne, avec l’IA Act et les obligations croissantes en matière de reporting de durabilité.