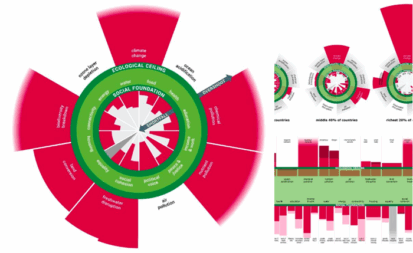Dans votre livre, "L'Innovation, mais pour quoi faire ? Essai sur un mythe économique, social et managérial" (Editions Seuil), vous expliquez que l'innovation est en quelque sorte devenue une "religion", un "culte". En quoi ?
Franck Aggeri : Il suffit de regarder le monde économique, politique, social ou encore scientifique pour se rendre compte que l'innovation est aujourd'hui partout. On parle d'innovation publique, d'innovation pédagogique, d'innovation culturelle, sociale, verte… Ce qui est frappant c'est que l'innovation est rentrée dans le langage commun, elle a colonisé l'ensemble de la sphère sociale et se trouve désormais dans les discours de tous les acteurs économiques et sociaux.
Or, cette innovation s'est progressivement imposée avec une connotation inévitablement positive. Les économistes, par exemple, nous expliquent depuis Schumpeter, que l'innovation est le moteur du progrès, de la croissance. Il faudrait être sur le front de l'innovation, pour ne pas être voué au déclassement. Il y a cette croyance que l'innovation produit forcément des bienfaits, qu'elle nous apporte des bénéfices sociaux et économiques. C'est ce que le sociologue américain Everett Rogers appelle le "biais pro-innovation".nano
Or avec ce biais pro-innovation, l'innovation est progressivement devenue un impensé, un élément de notre culture que l'on n'interroge plus qui fait l’objet d’un véritable culte. L'innovation devient alors une fin en soi, un impératif, avec ses mythes économiques, sociaux et managériaux : l'innovation serait la condition de la compétitivité des entreprises, innover serait synonyme d'épanouissement individuel… Au point que l'on ne questionne plus ses potentielles conséquences négatives, et que l'on ne se demande même plus s'il faut innover ou pourquoi il faudrait innover.
Justement, vous montrez dans vos travaux que l'innovation n'a pas toujours que des conséquences positives…
F.A : En effet. Par exemple, le réchauffement climatique n'est rien d'autre que la conséquence d'innovations passées : ce sont bien les véhicules thermiques, l’agriculture intensive ou la production électrique thermique qui génèrent l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre. D'une manière plus générale, si l'on regarde les dernières décennies, on voit bien que les conséquences positives de l'innovation peuvent être interrogées. On dit par exemple que l'innovation alimente la croissance économique et le progrès social, mais paradoxalement, les travaux de recherche montrent que depuis 1970, en dépit de très nombreuses innovations, l’indicateur de développement humain (IDH), qui mesure la qualité de vie, stagne dans les pays développés. Autre exemple : les Etats-Unis, dépensent 17% de leur PIB dans la santé, déposent chaque année des milliers de brevets dans ce domaine, et c'est pourtant l'un des pays développés où l'espérance de vie est la plus faible.
Evidemment, certaines innovations ont des impacts positifs indéniables. Mais il y a très souvent un décalage entre les promesses que l'on prête aux innovations et la réalité de leurs impacts. Les technologies dites "vertes", par exemple, comme la voiture électrique ou les énergies renouvelables, sont certes utiles pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais on nous promettait des technologies "propres", sous-entendu sans impacts sur les écosystèmes. Dans les faits, ce n'est pas que l'on observe. On voit au contraire des transferts de pollutions, des impacts sociaux et environnementaux que l'on n’avait pas anticipés : épuisement des ressources, pollution de l'eau, des sols, impact sur la biodiversité, empreinte matérielle, recyclage, fin de vie… Il ne s'agit pas de dire : "il faut arrêter d'innover" mais d'apprendre à innover mieux, s’interroger sur les finalités des innovations et mieux anticiper ses conséquences potentielles.
Concrètement, qu'est-ce que cela signifierait d'innover mieux ?
F.A : L'idée centrale c'est de passer d'une responsabilité rétrospective, où l'on se rend compte trop tard des conséquences de nos innovations pour pouvoir revenir en arrière, à une responsabilité projective, où l'on est capable d'anticiper et de gérer ces impacts. Pour cela, la première étape est sans doute de changer ce que Max Weber appelait l'infrastructure du capitalisme : la comptabilité. Aujourd'hui, nos indicateurs comptables ne mesurent que le capital financier, mais il faudrait également mesurer nos impacts sur le capital écologique et humain, pour que les acteurs visualisent les impacts de leurs activités. C'est le cœur des comptabilités multi-capitaux, comme la méthode CARE.
C'est aussi l'objectif des techniques de l'écoconception, comme l'analyse de cycle de vie (ACV), qui permet d'anticiper les impacts écologiques d'un projet d’innovation sur l’ensemble de son cycle de vie. On doit aussi absolument mobiliser les sciences sociales dans les processus d'innovation, pour comprendre les conséquences des innovations à l'échelle de la société. Comment une innovation va être utilisée, comment va-t-elle se diffuser, quels sont les potentiels effets d'échelle ? Ce sont des questions que l’on peut explorer, grâce à des méthodes comme le design-fiction ou le design participatif.
Cela nous amène à la véritable question centrale, qui est celle du besoin. Notre système économique repose sur l'idée que les besoins doivent être en permanence renouvelés, via l'innovation, l'obsolescence programmée. Aujourd'hui, ce modèle arrive à épuisement, et provoque de graves crises écologiques et sociales. Il faut donc changer de paradigme, s'interroger sur l'utilité de ce que l'on conçoit, ce que l'on produit, ce que l'on vend, et passer d'une logique d'abondance à une logique de sobriété. Cette démarche doit être l’objet d’une réflexion véritablement collective.
Qu'entendez-vous par "réflexion collective" ?
F.A : Passer d'une logique d'abondance à une logique de sobriété ne peut se faire qu'à l'échelle de la société, avec des politiques éducatives, sociales, économiques, pour transformer nos modes de production et de consommation. Prenons un exemple trivial : si l'on décide que l'on veut se passer des véhicules thermiques pour les trajets courts, il faut développer des infrastructures adaptées, des pistes cyclables, des politiques publiques pour valoriser le vélo et les mobilités alternatives… Il faudra aussi mettre en œuvre certaines contraintes, des réglementations, pour permettre aux acteurs de se projeter dans un système différent. Toutes ces mesures ne peuvent être le fruit que d’un travail collectif.
Les filières REP (Responsabilité élargie du producteur) constituent en ce sens un bon exemple. Au départ conçues pour responsabiliser les producteurs en matière de recyclage, les filières REP intègrent de plus en plus, notamment avec la loi AGEC, d'autres enjeux comme le réemploi, l'écoconception, la durabilité, la réparabilité, l'intensification des usages. Avec des politiques publiques adaptées, des incitatifs, mais aussi des cadres réglementaires plus stricts, on peut réorienter la créativité des acteurs économiques et les pousse à prendre en compte ces enjeux lorsqu'ils innovent ou mettent de nouveaux produits sur le marché.
Cela ne revient-il pas, finalement, à transformer radicalement le capitalisme, et notamment le capitalisme financier qui impose une économie basée sur les rendements à court terme ?
F.A : Il y a en effet un problème structurel avec le capitalisme financier, qui encourage une fuite en avant vers des modèles d'affaires et des innovations très rentables à court terme, mais incapables de prendre en compte les impacts de long terme. Pour reprendre la formule de l'économiste Pierre-Noël Giraud, le capitalisme financier, c'est "le commerce des promesses": des promesses de rendements financiers très élevés, parfois mêmes délirants. L'innovation, c'est la machine à fabriquer les promesses du capitalisme financier. On met ainsi des sommes colossales, que ce soit de l'argent public ou de l'argent privé, pour financer des innovations dans le numérique, l'IA, ou encore les nanotechnologies et nanoparticules sans se poser la question de leur utilité sociétale, parce que cela rapporte, et en retour, cela nourrit les bulles spéculatives. On préfère continuer à financer l'agriculture conventionnelle et chimique avec des budgets 10 fois supérieurs à ceux alloués à l'agriculture bio, l'agro-écologie ou la permaculture, car c'est plus rentable à court terme, même si c'est moins vertueux à long terme.
En résumé, on se projette dans ce qui brille, dans la high-tech, dans un paradigme technique, qui n'offre que des réponses techniques à court terme. Évidemment, il faudra transformer ce système, le réguler. Il s'agit aussi de construire des imaginaires désirables autour d'innovations plus vertueuses, plus sobres et plus justes. Cela implique de réhabiliter certains savoirs, certains modes de production et de consommation : réparation, entretien, réemploi…
Enfin, il faut changer la gouvernance de l'innovation. Pourquoi laisserait-on le devenir de nos sociétés aux mains des seuls experts, aux innovateurs, aux entreprises ? On pourrait imaginer des "conventions collectives" sur certaines innovations comme la 5G, à l'image de la convention collective sur le climat, où l'on donnerait la parole aux ONG, qui sont extrêmement bien formées, aux représentants de la société civile. On pourrait imaginer changer le cadre juridique de ce capitalisme, en donnant un statut juridique aux communs mondiaux comme l'eau, les forêts, les sols. Mieux responsabiliser les acteurs pour qu'ils anticipent mieux leurs externalités comme avec le devoir de vigilance. Voire, pourquoi pas, changer le statut juridique des sociétés, comme on a tenté de le faire avec l'entreprise à mission… Un tas de choses pourraient être faites pour changer profondément le système. Et au fond, c'est cela innover autrement.
Propos recueillis par Clément Fournier