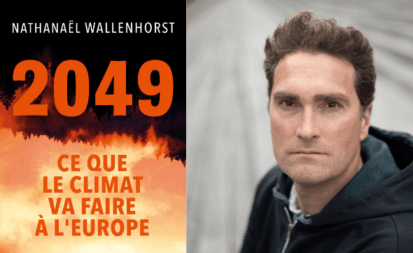Un menu qui s’est fait attendre. Avec plus de vingt mois de retard sur le calendrier prévu par la loi, le gouvernement a enfin publié, vendredi 4 avril, sa stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC). Elle était la dernière des grandes stratégies de planification écologique en attente de publication, après la stratégie nationale bas carbone (SNBC), la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC).
Initialement prévue par la loi “Climat et résilience” de 2021, à la suite des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, cette stratégie est mise en consultation pendant un mois, jusqu’au 4 mai. L’objectif ? “Déterminer les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire”, résume le document en introduction.
Six objectifs clairement chiffrés
Le texte de 54 pages a fait l’objet de nombreux allers-retours entre les ministères de l’Agriculture, de la Transition écologique et de la Santé, dans le but d’avoir une approche commune. L’alimentation reste un sujet crucial tant pour atteindre la neutralité carbone, car elle représente à elle seule le deuxième poste d’émissions de gaz à effet de serre en France, que pour la santé puisque certaines pathologies (diabète, obésité, maladies cardio-vasculaires, cancers) sont étroitement liées au contenu de nos assiettes. “Notre alimentation est devenue trop riche en calories et en produits animaux, et davantage transformée”, souligne la SNANC.
Parmi les grands principes et les quelques objectifs chiffrés, certains étaient déjà connus, comme celui de réduire de 30% par rapport à 2015 la prévalence du surpoids chez les enfants et les adolescents, ou de diminuer de 50% le gaspillage alimentaire pour la restauration collective et la distribution d’ici à 2030. Tandis que d’autres sont inédits, comme celui d’atteindre 12% de consommation de produits bio en valeur et en moyenne pour l’ensemble de la population ou encore celui d’atteindre 80% du territoire couvert par des projets alimentaires territoriaux (PAT), définissant des actions pour la restauration collective, le développement agricole ou la lutte contre la précarité alimentaire à l’échelle d’un territoire.
Pour atteindre ces objectifs, la stratégie nationale a défini 80 actions à mettre en place, dont 15 “actions phare” qui devront être mises en place d’ici à la fin de l’année. Parmi celles-ci, le lancement d’une campagne de communication et de sensibilisation du public pour une alimentation saine et durable, l’amélioration de l’information sur les données nutritionnelles et le déploiement de l’affichage environnemental volontaire pour les produits alimentaires mis sur le marché.
Une copie à revoir pour les associations
Ce texte comporte néanmoins des lacunes, dont la plus remarquée est le manque d’objectif chiffré quant à la baisse de la consommation de viande. La SNANC appelle seulement à atteindre “une consommation suffisante et limitée de poisson et de produits laitiers et une limitation de la consommation de viande et de charcuterie, en particulier importées”. Ce que déplorent les associations environnementales, car il est essentiel, si le pays souhaite respecter ses objectifs climatiques, de réduire notre consommation de viande, expliquent-elles. En effet, l’élevage est l’un des plus gros secteurs d’émission de gaz à effet de serre d’origine agricole, en raison des émissions de méthane du bétail et de la déforestation engendrée pour les nourrir.
“Ce revirement est très problématique, car seuls des objectifs chiffrés permettent de fixer une trajectoire, de déployer des moyens et des mesures pour la suivre et de procéder à une évaluation de l’atteinte des résultats”, regrette la CLCV, l’Association nationale de défense des consommateurs et usagers. Même réaction du côté du Réseau Action Climat. “La surconsommation de viande alimente les importations, qui représentent 30% de la viande consommée en France”, réagit Benoît Granier, responsable alimentation au RAC. Dans une version précédente, que Contexte s’était procurée, une diminution de 12% de la consommation de viande rouge et de 4% de la volaille d’ici à 2030, était pourtant mentionnée. Sauf que ces chiffres ont disparu dans la version finale, certainement parce qu’ils ont été jugés inacceptables par la filière de la viande.
“Le gouvernement aurait-il cédé à la pression imposée par le lobby de la charcuterie ?”, s’interroge le RAC. Sollicité sur ce point, le cabinet de la ministre de la Transition écologique précise que “la limitation de la consommation de viande est assortie d’une orientation de la consommation vers des produits durables et si possible locaux. (…) La SNANC ne fixe pas des injonctions pour les consommateurs, isolées de leur contexte, elle oriente les politiques publiques de façon à les rendre cohérentes entre elles”, précise-t-il.
L’autre grande déception de cette stratégie porte sur l’exposition des enfants aux publicités pour des produits trop gras, sucrés ou salés, alors que cela était également prévu dans une version intermédiaire. Pour le député Les Ecologistes Boris Tavernier, cela représente “une capitulation d’autant plus insensée que de nombreux autres pays adoptent des réglementations ambitieuses pour protéger les enfants de la malbouffe et de la pression publicitaire”. Cette nouvelle SNANC est donc perçue comme une nouvelle occasion manquée, comme a pu l’être avant elle le PNACC.