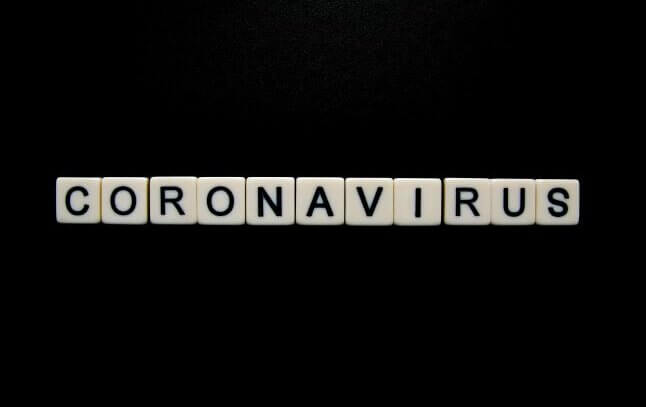Cinq ans après le début du premier confinement, le 17 mars 2020, Novethic revient sur la pandémie de Covid-19 qui a figé des millions de vie pendant plusieurs mois et fait près de 7 millions de morts dans le monde. Que faut-il retenir ? Y a-t-il un avant et un après ? Notre rapport à l’animal a-t-il changé ? Sommes-nous désormais prêts pour la prochaine pandémie ? Autant de questions que nous avons posé à Frédéric Keck, anthropologue, directeur de recherches au CNRS et auteur de “Politique des zoonoses. Vivre avec les animaux au temps des virus pandémiques”*.
Avec le recul, quelle place cette pandémie occupe-t-elle dans notre histoire collective ? Et qu’en avons-nous réellement retenu ?
Frédéric Keck : Il est évident que cette pandémie de Covid-19 a marqué la mémoire de ceux qui l’ont vécue, mais ce SARS-CoV-2 n’est finalement, selon moi, qu’une répétition et une extension de l’épidémie de SRAS en 2003, qui a été un événement marquant pour les sociétés asiatiques. C’était la première fois que celles-ci se mobilisaient pour lutter contre une épidémie, sans recevoir de leçons de l’Occident. Ce qu’il faut donc retenir de cette séquence, c’est cette affirmation progressive de la Chine dans le capitalisme mondial, mais surtout notre dépendance économique à ce pays.
Les historiens des épidémies ont toutefois observé que chaque pandémie donne lieu à un phénomène d’oubli collectif, que ce soient les souffrances ou les décisions que l’on peut prendre pendant ces périodes exceptionnelles. Et avec la Covid-19, nous n’y coupons pas. Malgré les bonnes résolutions que nous avons pu prendre à ce moment-là, on constate que les vols internationaux sont repartis comme avant et que notre volonté de limiter le réchauffement climatique est sortie de nos préoccupations avec la guerre en Ukraine, alors que nous savons que les origines de la Covid sont avant tout un problème environnemental.
En effet, l’émergence de la Covid-19 nous rappelle que les zoonoses – ces maladies infectieuses animales transmissibles à l’être humain – sont une menace et qu’elles sont extrêmement liées à nos activités. Cette prise de conscience a-t-elle suscité une réflexion environnementale ou un changement dans nos rapports avec les animaux ?
F. K. : Pendant le premier confinement, il y a eu une réelle réflexion sur notre rapport à la nature. L’opinion publique s’est emparée de l’idée que cette zoonose était une revanche de la nature sur les humains et qu’elles allaient à l’avenir se multiplier en raison de l’impact de l’homme sur les espèces animales. En effet, on a pu évoquer à cette période les conséquences de la déforestation, de l’élevage intensif ou encore du changement climatique.
La pandémie de Covid-19 n’a néanmoins pas suscité de grands changements dans nos rapports avec les animaux. Nous le voyons actuellement avec la crise de la grippe aviaire aux États-Unis, virus qui s’est transmis pour la première fois aux bovins, dont l’élevage industriel n’est pas prêt de s’arrêter. Quitte à susciter de nouvelles crises sanitaires dans les années à venir.
Les zoonoses ont-elles augmenté ces dernières années ? D’ailleurs, de nouvelles zoonoses peuvent-elles émerger ?
F. K. : C’est une hypothèse qui fait partie de ce que l’on appelle le paradigme des maladies infectieuses émergentes, qui consiste à dire que puisque nous nous sommes débarrassés d’un certain nombre de maladies que nous connaissons bien (la tuberculose, la variole, la rage, …), il va y avoir maintenant de nouvelles maladies provenant des animaux, typiquement Ebola ou le Sida qui viennent des primates d’Afrique centrale. Donc ce paradigme parie sur le fait qu’il y aura à l’avenir de plus en plus de zoonoses. La raison ? Le nombre d’humains et d’animaux se multiplie sur la planète, et notamment des animaux concentrés dans des élevages intensifs. Et bien que les mesures de biosécurité (mesures de confinement dans les élevages) augmentent, le risque que des pathogènes se transmettent au sein de ces élevages puis aux hommes augmente également fortement.
Le virus qui fait aujourd’hui le plus peur n’est pas celui de la grippe aviaire mais la dengue. Ce n’est pas exactement une zoonose, mais plutôt une arbovirose car il se transmet par l’intermédiaire des moustiques. Cette maladie fait aujourd’hui des ravages dans les pays tropicaux et arrive peu à peu dans les pays tempérés à cause du réchauffement climatique.
Comme pour la Covid-19, risque-t-on d’être à nouveau surpris par la prochaine pandémie ? Ou, au contraire, sommes-nous déjà prêts ?
F. K. : C’est très difficile d’être complètement prêts car les virus mutent, donc nos plans de préparation ne sont jamais 100% efficaces. Nous risquons d’être surpris à chaque fois. Mais ces plans de préparation sont essentiels car ils permettent de faire en sorte que la population réagisse le plus rapidement possible à l’émergence d’une nouvelle pandémie et ainsi limiter les dégâts. Pour cela, les autorités prévoient des stocks de masques, de vaccins, définissent les patients prioritaires, forment le personnel hospitalier… Mais si l’on souhaite limiter les risques aujourd’hui, il y a une réelle réflexion à avoir sur nos modes de consommation, et notamment du côté de l’alimentation.
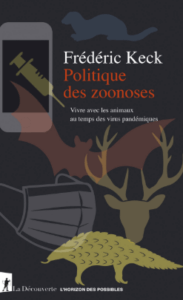
*Politique des zoonoses. Vivre avec les animaux au temps des virus pandémiques, Frédéric Keck, coll. L’horizon des possibles, éd. La Découverte, 2024.