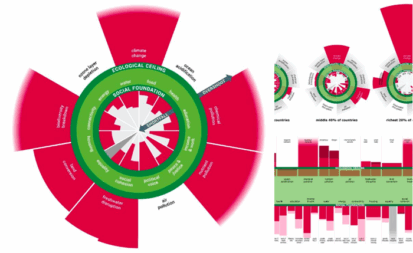C’est devenu en quelques jours l’ennemi mondial n°1. Le 14 août, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la variole simienne dite Mpox comme une urgence de santé publique de portée internationale. "Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé que la recrudescence de Mpox en République démocratique du Congo (RDC) et dans un nombre croissant de pays d’Afrique constituait une urgence de santé publique de portée internationale au titre du Règlement sanitaire international (2005) (RSI)", lit-on dans le communiqué de l’OMS.
Cette alerte - le plus haut niveau émis par l’OMS - a déjà été déclenchée pour d’autres épidémies comme Ebola, la grippe H1N1 ou encore le Covid-19. C’est la deuxième alerte en deux ans pour le Mpox. En cause : une nouvelle souche baptisée clade 1b qui a été découverte en RDC en septembre 2023. Depuis, la maladie s’est diffusée au Burundi, Kenya, Rwanda ou encore en Ouganda. Or cette souche est plus mortelle que les précédentes, le taux de mortalité atteint 5% chez les adultes et 10% chez les enfants.
Des "cas sporadiques" bientôt en France
Le premier cas hors du continent africain a été détecté en Suède le 15 août dernier chez une personne ayant effectué un séjour en Afrique. "Il est probable que d’autres cas importés de clade 1 soient enregistrés dans la région européenne au cours des prochains jours et des prochaines semaines", a dit la branche Europe de l’OMS dans un communiqué. Les symptômes sont multiples : fièvre, fatigue, boutons se répandant sur la peau, enet touchant particulièrement les muqueuses.
En France, "il y a de fortes chances que des cas sporadiques" du nouveau variant de Mpox "apparaissent, et sans doute prochainement", estime le ministre démissionnaire délégué à la Santé Frédéric Valletoux, dans une interview à la Tribune Dimanche. Le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal a annoncé le 16 août le placement du système de santé en "état de vigilance maximale", alors qu'aucun cas de Mpox n'y a encore été signalé. "Environ 150 000 personnes" ont été vaccinées en France sur les trois dernières années, suite à la vague épidémique du clade 2 de 2002, mais "il est trop pour tôt pour avoir des certitudes sur le niveau d'efficacité des vaccins" sur le nouveau variant, a expliqué Frédéric Valletoux.
Déforestation, perte d'habitat, déplacements humains
Auparavant appelé "monkey pox", la variole du singe porte mal son nom. "Malgré son nom, les primates non humains ne sont pas des réservoirs du virus de la variole du singe. Bien que le réservoir soit inconnu, les principaux candidats sont les petits rongeurs (par exemple les écureuils) dans les forêts tropicales d’Afrique, principalement en Afrique occidentale et centrale", expliquent plusieurs chercheurs français dans une étude parue en juin 2023 sur le sujet.
Selon eux, le fait que la population humaine empiète de plus en plus sur les habitats naturels des animaux sauvages porteurs du virus augmentent les cas de Mpox. "Les effets combinés de la déforestation, de la croissance démographique, de l’empiètement sur les habitats des réservoirs animaux, de l’augmentation des déplacements humains et de l’interconnexion mondiale accrue ont rendu cette éventualité envisageable", soulignent-ils.
Ce n’est pas le seul virus dont la propagation s'est accélérée en raison des activités humaines. On pense notamment à l’épidémie Ebola dont la diffusion a été aggravée par la déforestation, ou encore à la grippe aviaire pour laquelle l’élevage intensif a rendu possible la transmission du H5N1 à l’humain. "Pour réduire le risque de futures pandémies, il faut investir dans la prévention, la préparation et la réponse", alertent plus d’une vingtaine de chercheurs dans un article publié en mars dernier dans la revue Nature.
Ces derniers soutiennent "fermement" la création d’un groupe intergouvernemental sur les pandémies. S’il existe déjà une sorte de "GIEC de la santé" depuis mai 2021 ou encore l’alliance Quadripartite, "ces organismes s’attaquent tous à des questions uniques et importantes, mais aucun n’agit comme un organisme scientifique officiel qui évalue et synthétise régulièrement l’ensemble des données les plus récentes sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies", jugent les chercheurs. Ils demandent ainsi de s’inspirer du fonctionnement du GIEC sur le climat ou encore de l’IPBES, la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques dont les rapports connaissent un fort écho médiatique à chaque publication.