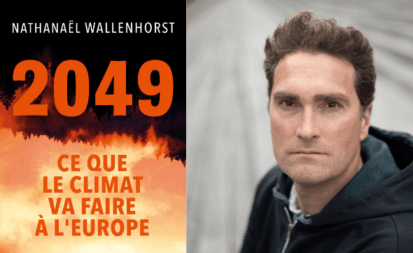Après plus d’un an de débat, l’Assemblée Nationale vient d’adopter la loi simplification. Le texte, porté par les gouvernements successifs et déjà voté au Sénat, visait à l’origine à “simplifier” la vie économique et notamment celle des PME. Ces derniers mois, les discussions autour du projet de loi simplification sont devenues le théâtre des affrontements entre les courants politiques autour de la question environnementale.
La droite et l’extrême droite notamment, ont ainsi profité des discussions parlementaires pour pousser une véritable dérégulation en matière écologique, que ce soit sur la question de l’aménagement urbain, de la mobilité ou du développement industriel. “C’est un fourre-tout, plus personne n’y comprend rien”, résumait la députée insoumise Anne Stambach-Terrenoir vendredi dernier, alors que les débats se poursuivaient dans l’hémicycle. Un fourre-tout voté mardi 17 juin à 275 voix pour, principalement issu des Républicains, de l’extrême-droite et du Modem, et 252 contre, incluant la gauche, les écologistes et Renaissance.
Régression du droit de l’environnement
Sous prétexte de simplification, plusieurs mesures emblématiques votées ces dernières années dans le domaine écologique ont ainsi été remises en cause. C’est le cas des zones à faibles émissions (ZFE), qui permettent aux communes de réguler le trafic des véhicules polluants dans les villes, afin notamment de réduire la mortalité associée à la pollution de l’air. La politique de zéro artificialisation nette (ZAN), visant à éviter la bétonisation et l’artificialisation des espaces naturels et des sols, a également été vidée de sa substance. Les obligations en matière de compensation environnementale pour les projets d’aménagement et d’urbanisme ont été allégées, tandis que les normes environnementales pour les projets industriels sont affaiblies, avec la création d’un statut “d’intérêt public majeur” exemptant certains projets industriels controversés d’évaluation environnementale, comme les data centers.
Parmi les autres mesures les plus controversées discutées à l’Assemblée Nationale, un amendement proposait la suppression de la CNDP (Commission nationale du débat public), autorité indépendante visant à l’information et la consultation des citoyens en matière environnementale, notamment pour les politiques publiques et les projets industriels. L’Ademe (Agence de la transition écologique) ou l’Office français de la biodiversité, acteurs essentiels de la transition écologique et de la protection environnementale en France, avaient aussi été dans le viseur. A l’issue de débats houleux, ces fermetures n’ont finalement pas été validées, mais d’autres instances ou agences gouvernementales ont été supprimées, dont l’Observatoire national de la politique de la ville, et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. Un ensemble de mesures décrites par les associations environnementales comme des reculs massifs, à l’image de France Nature Environnement qui s’alarmait du “régression du droit de l’environnement”.
Quant aux mesures visant à la simplification économique proprement dite, la plupart ont été finalement écartées du projet de loi. C’est le cas du dispositif “test PME” qui visait à introduire des mesures d’évaluation de l’impact sur les PME dans la fabrique de la loi, mais aussi du bulletin de paie simplifié. Plusieurs dispositions, vivement critiquées par les syndicats, ont également pour objet de modifier les règles du dialogue social en entreprise et d’affaiblir les pouvoirs des CSE (Comités sociaux et économiques).
Posture du camp présidentiel
Depuis quelques jours, le camp présidentiel, avec en tête le président Emmanuel Macron, avait fait de cette loi un totem politique. Le président avait ainsi ainsi fustigé les reculs environnementaux actés par les parlementaires, déclarant : “On ne peut pas revenir en arrière et détricoter ça”. Les députés du groupe macroniste avaient également déclaré leur intention de ne pas voter le texte, pourtant issu de leur propre camp politique, dénonçant notamment les renoncements sur les ZFE et la ZAN.
A l’issue du vote, la ministre de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a quant à elle déclaré “regretter que ce texte ait été dévoyé de ses intentions premières de simplifications légitimes pour conduire à des reculs préoccupants sur des questions environnementales”. Un paradoxe, alors que la France, notamment par la voix du parti présidentiel, pousse pour accélérer la dérégulation environnementale au niveau national et Européen, défendant notamment l’affaiblissement du Green Deal européen.
Le texte sera désormais débattu en Commission mixte paritaire à l’automne. “Il est temps d’arrêter le détricotage du droit de l’environnement. Nous appelons solennellement les membres de la commission mixte paritaire à revenir sur ces reculs, qu’ils viennent de l’Assemblée ou du Sénat”, a réagit Thomas Uthayakumar, directeur des programmes et du plaidoyer à la Fondation pour la Nature et l’Homme.