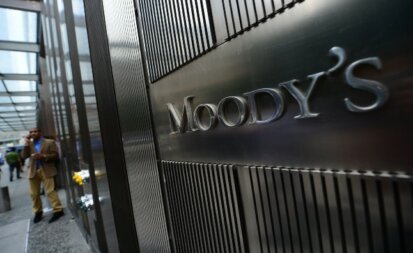Les études de santé publique le montrent : de plus en plus de travailleurs souffrent au travail. Burn-out, bore-out, dépressions et anxiété généralisée font désormais partie des maux habituels du monde du travail, et coûtent chaque année de plus en plus cher à la société et aux entreprises. Peu d'entreprises semblent pourtant aujourd'hui avoir pris la mesure de cette profonde crise de la santé mentale au travail. "Dans beaucoup de cas, les responsables en entreprise considèrent malheureusement la souffrance psychique au travail comme relevant uniquement d’une problématique individuelle, sans considérer la dimension collective du problème, c’est à dire les conditions de travail", explique ainsi Aude Caria, psychologue et directrice du site d'information sur la santé mentale Psycom.
Face à la souffrance des travailleurs, les stratégies de QVCT (Qualité de la vie et des conditions de travail) ou de RSE (Responsabilité sociale des entreprises) se contentent donc le plus souvent de mesures curatives visant à accompagner les personnes, via par exemple des dispositifs d'écoute psychologique ou des séances de coaching, mais sans remettre en cause les conditions et l'organisation du travail qui sont à la racine du problème. Pour Danièle Linhart, sociologue spécialisée directrice émérite de recherche au CNRS, les entreprises produisent ainsi une sur-responsabilisation des individus : "il y a une injonction à la bonne humeur, à la bienveillance, à la positivité dans le monde du travail, et ce alors que les travailleurs sont coincés dans des organisations du travail qui restent pathogènes" explique-t-elle. "On demande maintenant aux salariés de surveiller leur stress comme ils surveillent leur ligne" ajoute Laurence Durat, professeure à l'université de Haute-Alsace en sciences de l'éducation et de la formation.
Repenser le management et l'organisation du travail
Mais cette vision de la santé mentale passe à côté du problème. "On est dans la logique de mettre un babyfoot dans une salle amiantée" ironise ainsi Marie Pezé, docteure en psychologie et fondatrice du réseau Souffrance et Travail. Elle décrit l'empilement de mesures plus ou moins inefficaces mises en place par les entreprises pour favoriser la santé mentale de leurs travailleurs : séances de yoga, médiation, sport en entreprise, massages... La vague, il y a quelques années, des "chief happiness officer" dans les entreprises témoigne ainsi de cette incapacité paradoxale du monde du travail à se saisir vraiment de la question de la santé mentale, en agissant sur les causes réelles des souffrances.
Pour Aude Caria, le problème tient avant tout à "un manque criant de culture collective commune de la santé mentale en général, et notamment dans le milieu du travail." Beaucoup de dirigeants et de managers n'ont en effet aucune connaissance sur les enjeux de la santé mentale au travail ou sur les risques psychosociaux, encore parfois considérés comme tabous, et ne parviennent donc pas à identifier les facteurs de risques ou à mettre en place les réponses adaptées. "Les managers livrés à eux mêmes et mal formés créent beaucoup de casse humaine", abonde Diane Rakotonanahary, psychologue du travail et des organisations. "Il faudrait aujourd'hui mieux former les managers, les accompagner, pour qu'ils comprennent les véritables déterminants de la souffrance psychique, qui sont le plus souvent les conditions systémiques du travail", ajoute-t-elle. D'ailleurs, ces dernières années, "la question de la santé mentale a pris de l'importance dans les entreprises, et de plus en plus de dirigeants s'y intéressent" explique Aude Caria. Des outils se sont ainsi développés, à la fois pour aider les professionnels à mieux identifier les risques psycho-sociaux et pour libérer la parole autour de la santé mentale au travail, à l'image des ressources publiées par le site d'information Psycom. Mais il reste encore beaucoup à faire, notamment pour repenser concrètement les pratiques managériales.
Repenser le management, c'est pourtant une antienne dans le monde de l'entreprise depuis 20 ans. Management responsable, holacratie, entreprise libérée, et pourquoi pas management régénératif... Les modes managériales se sont ainsi succédées ces dernières décennies, chaque tendance prétendant résoudre les maux du travail induits par les précédentes. Mais comme l'a montré le philosophe d'entreprise Thibaud Brière dans son ouvrage "Toxic management" (éditions Robert Lafont, 2021), ces nouvelles pratiques n'ont pas, loin s'en faut, résolu la crise de la santé mentale au travail. Au contraire, en manipulant les discours sur "l'autonomie" des travailleurs, ou sur leur "engagement" au travail, ces nouveaux modes de management ont pu accroître la pression sur les travailleurs et créer des injonctions nouvelles à la performance et au dépassement de soi.
Donner du pouvoir d'agir, construire des entreprises capacitantes
"On a réinventé le management tayloriste sans rien changer ou presque", se lamente ainsi Danièle Linhart, pour qui ces nouveaux modes de management "demandent aux travailleurs de maximiser leur productivité de façon soit disant autonome, tout en restant dans des organisations très hiérarchisées, où le travail est pensé en dehors des réalités du terrain." Or ce sujet des organisations du travail et de la gestion des conditions de travail reste encore très absent des formations initiales ou continues des managers. "Plutôt que de bons techniciens que l'on nomme aux postes de managers, il faut de vrais managers de proximité, capables d'évaluer l'intensité du travail des collaborateurs, leur appétence, le sens du travail, et surtout capables d'adapter la charge de travail et l'organisation du travail en restant à l'écoute", explique Diane Rakotonanahary.
L'un des enjeux essentiels pour les entreprises est alors d'être capable de redonner du "pouvoir d'agir" à leurs travailleurs. Il s'agit de "sortir de la logique où le travail est pensé selon des principes de maximisation de la productivité sans intégrer les travailleurs", explique Marie Pezé. A la place, il faut co-construire l'organisation du travail avec ceux qui produisent au quotidien ce que les spécialistes appellent "le travail vivant". "Il faut arrêter de penser que le rôle du management est de rationaliser complètement le travail, de le planifier, de fixer des objectifs par le haut" explique Laurence Durat. Que ce soit pour l'organisation des services, le choix des outils de production, ou encore les cadences de travail, il faudrait plutôt écouter les remontées de "la base", "du terrain", c'est-à-dire des salariés eux-mêmes disent les spécialistes. Une posture d'écoute qui ne signifie pas la disparition de la hiérarchie ou du management, mais une redéfinition de leurs rôles, au service de la qualité du travail plutôt qu'au service de la rentabilité et de la production.
C'est ainsi en écoutant les salariés que les entreprises peuvent résoudre de nombreux dysfonctionnements dans les organisations du travail, bien souvent provoqués par les procédures de management et de contrôle déconnectées de la réalité du terrain. "Dès que les salariés ont plus de latitude décisionnelle, d'autonomie dans leur organisation, de soutien social, ils vivent mieux leur travail. L'objectif est donc de créer un environnement de travail capacitant" ajoute Laurence Durat. "Il est aussi fondamental de donner de la reconnaissance, car le manque de valorisation symbolique et matérielle est extrêmement pathogène", complète Diane Rakotonanahary.
Repenser le dialogue social, donner sens à l'économie
Mais justement, les entreprises ont aujourd'hui encore beaucoup de mal à dialoguer avec leurs salariés, en particulier en France. Le problème est connu et il a fait l'objet notamment de plusieurs rapports du CESE (Conseil économique, social et environnemental), qui pointent les insuffisances du dialogue social dans le pays. Les analyses Eurofound sur le dialogue social en Europe vont dans le même sens et montrent que la France est l'un des pays où le dialogue social fonctionne le moins bien sur le continent. Pour Danièle Linhart, le problème vient notamment "des dirigeants français, qui refusent cette ouverture, considérant que c'est au manager, aux dirigeants, de savoir à la place des salariés, de donner les lignes directrices". Une mythologie du "leader visionnaire" qui empêche le développement d'une forme de "démocratie participative" au travail et potentialise les conflits au sein des entreprises. Sans compter les récentes réformes du travail, notamment les ordonnances Macron de 2017, qui ont affaibli les instances de représentation des personnels en fusionnant les CSE (Comités sociaux et économiques) et les CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). "On devrait au contraire créer du dialogue avec les salariés, leur donner des espaces pour exprimer leurs besoins, identifier ce qui ne va pas" ajoute la sociologue.
Si les spécialistes appellent tous à renforcer les CSE et les instances de représentation des personnels c'est aussi pour reconnecter le travail au réel. La financiarisation de l'économie, la mondialisation, l'accélération de l'économie ont ainsi contribué à diluer le sens du travail et son utilité concrète. "Les grands cabinets de conseil ont créé les conditions d'une machine qui déshumanise le travail au service d'organisations financiarisées, qui sert surtout à rémunérer les actionnaires", lance ainsi Marie Pezé. "Tant que ces logiques de travail en flux tendu uniquement destinées à produire toujours plus perdureront, le travail pèsera sur la santé mentale" ajoute la spécialiste. Les CSE, représentants des personnels et syndicats seraient alors les seuls contre-pouvoirs capables de modérer ces dérives.
Les experts interrogés par Novethic ne cachent cependant pas que c'est une véritable révolution paradigmatique qui doit se jouer pour redonner du sens non seulement au travail mais à l'économie en général. Plusieurs posent ainsi la question qui fâche : construire des entreprises capacitantes, à l'écoute, respectueuses de la santé mentale, est-ce au fond compatible avec le capitalisme néo-libéral ? Une chose est certaine, la transformation à accomplir implique de changer profondément de modèle.