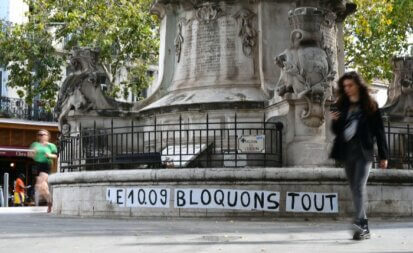L’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza au Bangladesh, le 24 avril 2013, dans lequel sont mortes plus de 1 000 ouvrières, marque le début d’une prise de conscience globale des ravages humains entraînés par l’industrie textile. En cause, un modèle économique visant à acheter toujours moins cher des vêtements produits à bas coût pour des consommateurs occidentaux avides de changements permanents. L’onde de choc, partie du Bangladesh, a eu des impacts sur toutes les marques de textile occidentales car on a retrouvé dans les décombres les étiquettes de beaucoup d’entre elles parmi les plus familières des consommateurs.
Dix ans après, certaines ont disparu ou sont menacées de disparition comme Pimkie ou Gap. Elles sont victimes de la désaffection des consommateurs qu’on peut diviser en deux grandes tendances : les amateurs d’ultra fast fashion qui achètent sur Internet le plus souvent et ceux qui sont en quête de traçabilité et de garantie sur le respect des droits humains tout au long de la chaine de production des vêtements qu’ils achètent. Entre les deux, les clients se font rares, ce qui a entrainé la chute du modèle qui a fait les grandes heures des marques françaises comme Camaïeu.
Devoir de vigilance et ultra fast fashion
Côté positif, il est vraisemblable que la loi sur le devoir de vigilance, adoptée en 2017 en France, n’aurait jamais vu le jour sans le drame du Rana Plaza. Elle a pour objectif d’obliger les grandes entreprises à prévenir et à réparer les violations liées aux droits humains et à l’environnement tout au long de leur chaine de sous-traitance en les obligeant à mettre en place un plan de vigilance. Pour le rapporteur de la loi, le député Dominique Potier, "il appartient au Parlement, à nous législateurs d’établir des rives pour canaliser les courants et éviter les marécages : ceux des sales affaires, ceux du mépris du monde et des pauvres gens".
Le devoir de vigilance est un outil juridique utilisé pour lancer des poursuites judiciaires contre les entreprises qui manquent de crédibilité sur les mécanismes mis en place. Sur la quinzaine de contentieux en cours (Teleperformance, Suez, Casino, TotalEnergies, McDonald’s… ), aucune décision sur le fond n’a encore été rendue mais les entreprises ont pris conscience des risques juridiques associés à l’exploitation d’ouvriers dans des pays où la main d’œuvre ne vaut pas cher.
Le bilan le plus négatif est le succès planétaire de l’ultra fast fashion incarnée par Shein. Le géant chinois du textile à très bas prix, promu par des influenceurs, a dépassé ses premiers concurrents que sont H&M et Zara. Les deux géants du textile tentent de s’adapter en revoyant leurs stratégies. H&M ferme ses magasins et mise sur le développement durable puisqu’elle est la première entreprise de cette taille dirigée, depuis 2020, par son ancienne directrice RSE, Helena Helmersson. De son côté, Zara tente d’échapper à son image ternie par les accusations de complicité avec le travail forcé des Ouighours. Ce qui lui vaut d’être poursuivi pour "recel de crime contre l’humanité" à la suite d’une plainte, déposée en avril 2021, par plusieurs ONG dont Sherpa et le Collectif de l’éthique sur l’étiquette.
Conditions de travail aussi épouvantables au Royaume-Uni
Tout cela n’empêche donc pas l’ultra et la fast fashion de continuer à faire reposer leurs modèles sur l’esclavage moderne mais, depuis le Rana Plaza, l’impunité reste relative. Les sanctions peuvent venir des consommateurs mais aussi des marchés financiers. La marque d’ultra fast fashion Boohoo l’a appris à ses dépens en 2020. Propriété du milliardaire anglo-indien Mahmud Kamani, elle a rapproché ses ateliers de confection des consommateurs et vente sa dimension "Made in UK".
Mais l’ONG "Labour behind the label" a révélé que les conditions de travail au sein de ses ateliers à Leicester en Grande-Bretagne, étaient aussi épouvantables qui celles qui régnaient au Rana Plaza. Le cours de bourse de Boohoo a plongé de 45% à la suite de ces révélations et n’est jamais vraiment remonté depuis. Le milliardaire, propriétaire de Boohoo, a ainsi perdu l’équivalent de 566 millions d’euros à cause de ce scandale.
La remise en cause du modèle de la fast-fashion viendra peut-être de la nécessité de baisser la production à cause des dommages environnementaux et sociaux que provoque la surproduction mondiale. Aujourd’hui elle se déverse sur les marchés africains, à commencer par ceux du Ghana qui reçoit 15 millions de vêtements par semaine dont ils jettent 40% dans des décharges à ciel ouvert. Ce circuit délétère est très bien décrit dans ce reportage d’Hugo Clément pour son émission Sur le front. D’autres monceaux de vêtements usagés jonchent le désert de l’Acatama au Chili.
Le textile est considéré comme la deuxième industrie la plus polluante au monde après les énergies fossiles. Il faudra sans doute encore une dizaine d’années pour que ses pratiques les plus destructrices soient remises en cause et que les ouvrières du Rana Plaza ne soient pas mortes pour rien en avril 2013.
Anne-Catherine Husson-Traore