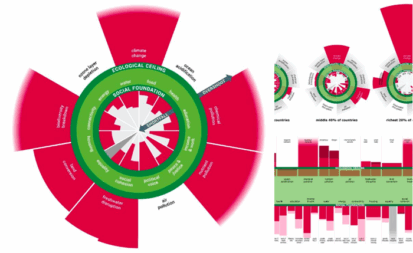Quel doit être le degré de mise en garde d’un laboratoire sur les risques sanitaires liés à un médicament donné ? Le procès de la Dépakine, ce médicament pour l’épilepsie et les troubles bipolaires produit par Sanofi, permettra dans les années à venir d’essayer de répondre à cette question. Selon les autorités sanitaires, ce traitement pris par des femmes enceintes aurait entraîné entre 2 000 et 4 000 cas de malformations et entre 16 000 et 30 000 retards de développements neurologiques chez leurs enfants. L’association de parents d’enfants victimes de ces syndromes, l’APESAC, a un décompte beaucoup plus précis : 7 647 victimes, 1 645 avortements, 179 décès.
Présidée par Marine Martin, lanceuse d’alerte, auteure de "Depakine, le scandale" et mère de deux enfants atteints, l'association a initié une action de groupe pour obtenir un procès au pénal qui ouvre les possibilités de réparation collective si le laboratoire Sanofi est condamné pour défaut d’information. C'est la conclusion à laquelle est arrivé le tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 5 janvier. Il estime que Sanofi a commis une "faute en manquant à son obligation de vigilance et à son obligation d’information" et juge donc "recevable" l’action de groupe lancée par l’association. Une première en France depuis la création de cette procédure en 2016.
Un futur procès
Les juges ont estimé que Sanofi "a produit et commercialisé un produit défectueux entre le 22 mai 1998 et janvier 2006 pour les malformations congénitales, et entre 2001 et janvier 2006 pour les troubles neurodéveloppementaux". Ils encadrent donc précisément la période de temps pendant laquelle les victimes de malformations ou de troubles neurologiques peuvent demander réparation. Pour les malformations elle s’étend de 1984 à 2006 mais seulement entre 2001 et 2006 pour les troubles neurologiques. Ces précisions de calendrier "écartent la moitié des victimes de la Dépakine" indique Marine Martin qui espère voir enfin aboutir cette procédure lancée il y a plusieurs années.
La décision du tribunal ouvre la voie à un procès mais qui ne pourra pas s’ouvrir tant que l’appel lancé dès l’annonce de la décision par Sanofi ne sera pas jugé. Marine Martin et toutes les victimes parties prenantes de l’action collective devront donc vraisemblablement attendre encore plusieurs années pour débattre de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques sur l’information fournie sur les risques spécifiques liés à la prise d'un médicament pendant la grossesse.
Des handicaps qui se transmettent aux générations suivantes
Car ce scandale comme celui du Distilbene, médicament contre les fausses couches qui a entrainé de graves malformations génitales chez les filles des femmes qui l’ont prises, montre la très mauvaise prise en compte des risques spécifiques de l’exposition des femmes à des effets secondaires très graves. C’est d’autant plus crucial que les handicaps peuvent se transmettre aux générations suivantes. Concernant la Dépakine, une étude scientifique publiée début décembre 2021 par l’épidémiologiste Catherine Hill, montre que cela semble être le cas.
Elle a travaillé avec l’association Apersa en analysant les données de 108 victimes atteintes de malformations et de troubles qui ont eu 187 enfants. Or 23 % d’entre eux présentent aussi des malformations et 44 % des troubles neurologiques. Catherine Hill lance donc une nouvelle alerte et considère à ce stade que les impacts néfastes de la Dépakine touchent au moins 14 000 personnes en France.
Anne-Catherine Husson-Traore, @AC_HT, Directrice générale de Novethic