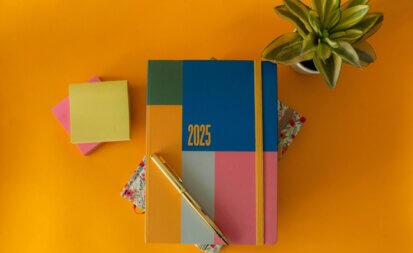En Allemagne, depuis la victoire en février dernier de la droite conservatrice de la CDU (Union chrétienne-démocrate d’Allemagne) aux élections législatives, c’est l’incertitude qui domine la scène politique. Friedrich Merz, chef de file de la CDU, a ainsi été difficilement élu chancelier au Bundestag, à la tête d’une “grande coalition” rassemblant la droite et les socio-démocrates (SPD). Ce nouveau gouvernement prend les rênes de la première économie européenne alors que de nombreux débats ont cours en Allemagne. Sur les questions énergétiques, mais aussi sur la politique de transition écologique et de transformation durable, les oppositions pourraient rapidement apparaître au sein de la coalition gouvernementale.
Premier exemple de ces dissensions qui animent déjà le nouveau gouvernement allemand, Friedrich Merz, appelait en fin de semaine dernière l’Union européenne à “supprimer” sa loi sur le devoir de vigilance des multinationales (CS3D). La directive, votée il y a à peine un an au Parlement européen dans le cadre du Green Deal, instaure de nouvelles obligations pour les grandes entreprises en matière de respect des droits humains et environnementaux sur leur chaîne de valeur, et son maintien faisait pourtant partie de l’accord de coalition signé entre les deux grandes forces gouvernementales. La preuve que déjà, les fissures apparaissent.
Des compromis à trouver pour le climat, l’énergie…
Il faut dire que le casting gouvernemental hétéroclite de la coalition présage des débats nombreux. Le nouveau ministre de l’environnement, le social-démocrate Carsten Schneider, est décrit en Allemagne comme un “novice”, à l’ambition modérée sur les questions écologiques. Celui qui s’est, au cours de sa carrière, montré plutôt réticent sur l’ambition à donner aux politiques de transition énergétique ou de taxation carbone, devra cohabiter au sein de son ministère avec Jochen Flasbarth, ancien président de l’ONG Nuba Union allemande pour la protection de la nature, au contraire très engagé et spécialiste du sujet. Ce dernier sera aux commandes des négociations climatiques internationales, en vue notamment de la COP30, qui se tiendra en novembre à Belém au Brésil. Alors que l’Union européenne est en plein débat sur une éventuelle révision de ses objectifs climatiques, la posture défendue par l’Allemagne sera déterminante, et il est impossible à ce stade de prédire qui, de Carsten Schneider ou de Jochen Flasbarth dirigera les débats.
L’incertitude pourrait aussi persister autour des questions énergétiques. Sur la question du nucléaire notamment, le nouveau chancelier cultive depuis plusieurs années une position ambigüe, jusqu’à défendre une possible relance du programme nucléaire allemand. La position n’est toutefois pas partagée par la nouvelle ministre de l’énergie issue de la CDU, Katherina Reiche. Cette dernière a d’ores et déjà annoncé qu’aucun retour du nucléaire n’était en projet. En revanche, la ministre a été claire quant à sa volonté de développer 20 gigawatts de capacités de production électrique grâce à des centrales au gaz fossile. “Nous avons besoin de centrales à gaz flexibles qui fournissent de l’électricité lorsque le vent ne souffle pas et que le soleil ne brille pas, et nous en avons besoin rapidement” déclarait cette ancienne dirigeante de l’entreprise de l’énergie Westenergie, qui exploite un réseau de distribution de gaz. Un développement du gaz qui pourrait ralentir le développement des énergies renouvelables alors que l’Allemagne doit maintenir ses efforts pour atteindre ses objectifs climatiques à 2030.
Débats autour du Green Deal
Parmi les autres débats qui risquent d’agiter la coalition : l’avenir de l’industrie automobile. Alors que l’Union européenne a adopté l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs en Europe à partir de 2035, l’industrie automobile allemande pousse depuis plusieurs mois pour revenir sur cet objectif. Le nouveau ministre des transports Patrick Schnieder, issu de la CDU pourrait bien soutenir cette position, puisque son parti avait poussé, sans succès, pour remettre en cause cette mesure dans son accord de coalition avec le SPD. Les objectifs du Green Deal sur l’automobile, qui viennent d’ailleurs d’être revus à la baisse au niveau européen, pourraient donc être menacés, alors que le secteur des transports est l’un de ceux qui se décarbone le moins vite en Europe, et particulièrement en Allemagne où cette industrie est omniprésente.
Mais c’est plus généralement le Green Deal européen dans son ensemble qui risque de cristalliser les débats. La loi omnibus actuellement discutée au niveau européen, et visant à réviser la CSRD (directive sur le reporting de durabilité), la loi sur le devoir de vigilance, ou encore la taxe carbone aux frontières européennes (MACF), est soutenue par le Parti populaire européen, et notamment la droite allemande, qui demandent d’accélérer la dérégulation… A l’inverse du côé du SPD, on souhaite maintenir les ambitions de durabilité du continent. Reste à voir si la culture allemande du compromis saura survivre, face à de telles divergences.