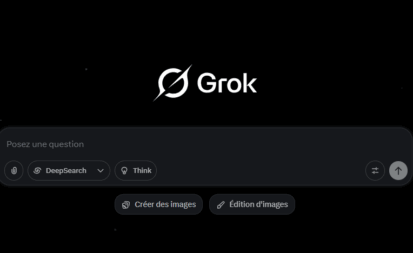Deux entreprises, deux ambiances. En moins de vingt-quatre heures, la semaine dernière, deux annonces sur un même sujet, de deux groupes majeurs français (ou en partie) et opérant dans des secteurs très proches, ont provoqué des réactions diamétralement opposées. D’un côté, Stellantis, où son directeur général, Carlos Tavares, a obtenu, avec l’approbation d’environ 70% des actionnaires, une rémunération (pour 2023) qualifiée par Gabriel Attal de somme “démesurée” et “choquante pour beaucoup de français” . On parlerait ici de 36 millions d’euros. D’un autre côté, Michelin, dont le président directeur général, Florent Menegaux a annoncé la mise en place d’un salaire décent pour l’ensemble de ses salarié.e.s au niveau mondial (tout en précisant que le SMIC n’est pas un salaire décent), déclaration saluée notamment par Bruno Le Maire.
Deux ambiances, mais aussi deux justifications. Le PDG de Michelin explique ainsi : “on ne veut pas que nos résultats s’établissent sur des salaires trop faibles”. Le DG de Stellantis, quant à lui, argumente : “quatre-vingt-dix pour cent de mon salaire est fait par les résultats de l’entreprise, (…) donc cela prouve que les résultats de l’entreprise ne sont apparemment pas trop mauvais”. Apparemment, également deux visions du résultat, c’est-à-dire du profit ou de la perte comptable, et de son rapport au salaire s’affrontent : le salaire conditionné à un “bon” résultat ou le résultat conditionné à un “bon” salaire ?
Vieux débat…
L’idée, qui s’est imposée, voudrait que les facteurs de production, dont le travail, devraient être rémunérés sur la base de leur productivité (marginale). Le coût du travail devrait ainsi être comparable à la productivité que ce travail peut dégager. Idée reprise et “relookée” avec des mots sonnant “durables” et novateurs, ceux du “capital humain“. Les salarié.e.s seraient ainsi devenu.e.s un “actif” (comptable), un investissement (le capital humain représentant l’agrégat de tous ces actifs d’un nouveau genre) : elles/ils n’apporteraient ainsi plus uniquement leur travail (coûteux), mais seraient aussi supports de compétences, de connaissances, de ‘skills’ (notion très à la mode), servant la productivité (actionnariale) et que l’on pourrait augmenter, voire contrôler, par des investissements adéquats. Le salaire serait ainsi un rendement associé à la productivité globale de la/du salarié.e, vu.e comme un actif particulier (comme une machine…) dotée de qualités spécifiques, à optimiser. De manière provocante, on pourrait ironiser en indiquant que la dernière fois que des êtres humains ont été assimilés à des actifs dans des entreprises, c’était lorsque l’esclavage existait encore et que les bilans mentionnaient effectivement la présence de tels actifs humains (littéralement).
En résumé, le travail et le/la salarié.e n’auraient d’importance que du fait de leurs impacts et apports positifs (ou négatifs) sur la performance financière (actionnariale) de l’entreprise. Cette tournure de phrase semble familière. Et pour cause, il s’agit bien d’une vision en “matérialité financière”.
Où on parle de comptabilité
Ces derniers mois ont vu en effet s’imposer dans le débat socio-économique la question comptable de la double matérialité. Ce qui est en jeu est de déterminer sur quels critères intégrer des informations non-financières dans les systèmes comptables, c’est-à-dire dans le langage des organisations. Considère-t-on que ces informations sont à prendre en compte si elles reflètent des impacts (positifs ou négatifs) :
– de l’environnement (social ou naturel) sur la performance financière ? On parle ainsi de matérialité (c’est-à-dire d’importance relative en termes comptables) financière des informations non-financières ;
– ou de l’entreprise sur l’environnement ? Ce qui correspond à la matérialité dite “à impact” de ces mêmes types d’informations.
La double matérialité consiste ainsi à tenir compte des deux matérialités et notamment de la matérialité à impact. Cette question, centrale dans l’orientation de nos économies et la définition même de la durabilité, est par ailleurs devenue un enjeu géopolitique et stratégique important. Dans ce contexte, l’Union européenne s’est imposée comme ouvrant la marche internationale à l’irrésistible ascension de la double matérialité, concrétisée notamment par l’adoption de la Corporate sustainability reporting directive (CSRD), contenant les European sustainability reporting standards (ESRS).
Et que trouve-t-on dans la CSRD ? Des points précis sur la question du salaire décent justement, au niveau de l’entreprise et de sa chaîne de valeur (ESRS S1 et S2 – S pour Social), défini comme “un salaire permettant de satisfaire aux besoins du travailleur et de sa famille compte tenu des conditions économiques et sociales du pays”. Il est ainsi demandé dans ces nouvelles obligations de reporting d’indiquer “si tous ses salariés perçoivent ou non un salaire décent et, si ce n’est pas le cas, les pays et le pourcentage de salariés concernés”.
Matérialité à impact dans le domaine social
Mais pourquoi les ESRS intègrent-ils cette question ? Car il s’agit bien de matérialité à impact dans le domaine social : le salaire décent ne parle pas d’apports productifs mais est bien centré sur les salarié.e.s eux.elles-mêmes, et sur les impacts que les activités économiques peuvent avoir sur elles et eux. Le salaire décent n’est ainsi plus la reconnaissance d’un actif (social/humain) mais d’une nouvelle forme de redevabilité sociale. Dans ce cadre, les entreprises emploient et tirent profit d’êtres humains et doivent aussi reconnaître et comptabiliser, par voie de conséquence, les incidences qu’elles ont sur elles et eux, y compris sur toute la chaîne de valeur (partie de l’‘équation’ trop longtemps ignorée).
Dans cette vision de double matérialité, le salaire est à comprendre, à la fois, du point de vue de la productivité financière mais, aussi et sans possibilité de remise en cause, comme la garantie de la préservation des besoins des salarié.e.s. Et de se demander si, en tenant compte de ces nouvelles redevabilités sociales (mais aussi naturelles mêmes si non abordées ici), Stellantis aurait eu un résultat comptable aussi “bon” et si un tel salaire pour le DG aurait pu être versé/justifié ? L’entrepreneur.se de demain n’est-il/elle pas d’ailleurs celle/celui capable, non pas de conduire des affaires, mais de les conduire en intégrant ces redevabilités ? Un questionnement pour les formations en universités et école de commerce ?
Cette notion de salaire décent peut sembler complexe et difficile à mettre en œuvre, malgré les déclarations de Michelin. Pourtant, de nombreux travaux existent et constituent un socle probant pour son développement. Que ce soit le “living wage”, défendu par le Pacte mondial des Nations unies et sur lequel s’appuie le PDG de cette entreprise, ou le budget de référence, élaboré par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en France, sur lequel s’appuie initialement le programme C.A.R.E. (Comprehensive Accounting in Respect of Ecology) porté par le Cerces, le salaire décent ne peut plus être considéré comme une fiction, mais comme le fait de “donner une mesure concrète à une ambition abstraite”, celle notamment d’une justice sociale, équilibrant apports productifs du travail et redevabilités sociales en retour.
Michelin opérationnalise dès lors l’ambition de la CSRD et de la double matérialité et que le programme C.A.R.E. participe à structurer depuis plusieurs années en tant que cadre de prise en compte de ces nouvelles redevabilités socio-environnementales. Alors coûts, actifs ou redevabilités, les salarié.e.s ? Et si la justice sociale imposait la justesse dans la comptabilisation du travail et des salarié.e.s ?