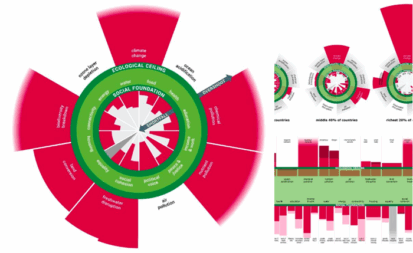Dans votre livre "Sociologie des dirigeants de grandes entreprises", co-écrit avec Antoine Vion vous étudiez le profil sociologique des grands patrons d'entreprises françaises. Or de plus en plus d'acteurs appellent ces dirigeants à être "responsables" sur le plan social et environnemental. Pouvez-vous nous dire quel rapport entretiennent les grands patrons avec cette notion de responsabilité sociale et environnementale ?
François Xavier Dudouet : La première chose qu'il faut dire, c'est que ceux que l'on appelle les "grands patrons", les dirigeants des grandes entreprises cotées, comme celles du CAC40, sont des mandataires sociaux. Ces mandataires sociaux, l'entreprise ne leur appartient pas, ils n'en sont même pas salariés, et très rarement actionnaires majoritaires. Ils se contentent de représenter l'entreprise, et d'agir en son nom, avec pour objectif de faire du profit.
Sur le plan juridique, les grands patrons n'ont aucune responsabilité personnelle sur les externalités économiques, sociales ou environnementales liées aux activités de leur entreprise. Ils ne sont responsables de rien. Par exemple, Thierry Breton, qui a été dirigeant d'Atos pendant 10 ans, ne sera jamais tenu responsable des conséquences de ses choix stratégiques et de la faillite que l'entreprise traverse aujourd'hui. Il a quitté l'entreprise après avoir touché des dizaines de millions d'euros, et ne remboursera jamais un centime. Du point de vue social et environnemental, c'est la même chose : les patrons ne sont pas responsables des dommages écologiques de leur entreprise.
On a détaché la responsabilité juridique des dirigeants de la responsabilité économique, sociale et environnementale des entreprises : cette séparation juridique est fondamentale pour comprendre le rapport des grands patrons à ce que l'on appelle la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). Du fait de cette irresponsabilité juridique, les grands patrons ne s'intéressent à la RSE que de façon opportuniste, lorsque cela sert leur carrière, ou lorsque cela est dans l'intérêt de leur organisation. Mais sinon, cela ne fait pas partie de leur mandat.
Comment expliquer que ces grands patrons ne trouvent pas d'intérêt à se saisir de ces questions stratégiques ?
Il y a plusieurs facteurs. Il y a d’abord une question de génération : les personnes qui sont aujourd'hui à la tête des grandes entreprises sont nées dans les années 50 à 70, et ont été formées à une période où ces questions n'étaient pas aussi essentielles qu'aujourd'hui. Mais surtout, il y a le moule corporatiste, le moule de la grande entreprise elle-même, qui a façonné ces patrons durant toute leur carrière. Le monde de la grande entreprise est structuré pour sélectionner celles et ceux qui posent le moins de questions, qui remettent le moins en cause le modèle dominant. Pour grimper dans une telle organisation, il faut être animé par une soif de carrière, de réussite, de pouvoir et d'argent, soif pour laquelle on doit se conformer à des règles, à une vision du monde.
Or sur le plan des valeurs, les entreprises sont très opportunistes, très plastiques. Elles s’arrogent des valeurs, en fonction de l'ère du temps, des modes : s'il faut être souverainiste, elles diront qu'elles sont souverainistes, s'il faut être engagé pour l'écologie, elles diront qu'elles sont soucieuses de l’environnement. Depuis une vingtaine d’années, l'engagement environnemental et social des entreprises est devenu une thématique importante. Elles se sont engouffrées dans cet espace, disant toutes être éco-responsables, socialement vertueuses. Ce mouvement a été porté par les dirigeants qui, au moins facialement, ne voulaient pas être en décalage avec ces valeurs montantes. Ils ont alors fait tout un tas de professions de bonne foi en lien avec l'écologie ou la justice sociale
Mais quand on regarde concrètement, on voit que les actions mises en place n'ont jamais remis en cause la rentabilité des modèles économiques de ces entreprises, elles n'ont jamais changé fondamentalement leur fonctionnement. Les grandes entreprises disent être engagées pour produire et acheter français, mais ne cessent de détruire des emplois en France. Elles disent être "vertes" mais continuent d'investir dans des modèles polluants. La réalité est que la plupart grands patrons sont choisis pour être des managers et des bureaucrates conformistes, peu originaux, et interchangeables, qui tendent à choisir des stratégies qui ont une efficacité sur le court terme pour atteindre des objectifs financiers : couper les coûts, pour dégager des marges à brève échéance, au détriment de l'innovation, de la résilience à long terme.
Certains appellent à indexer les rémunérations des grands dirigeants sur des critères extra-financiers, afin de les inciter justement à prendre en compte les enjeux de long terme comme l'écologie ou la justice sociale, qu'en pensez-vous ?
Effectivement, la question de la rémunération est intéressante, et d'ailleurs la rémunération sur des critères de performance extra-financiers existe déjà. Le problème c'est que ce sont des critères laissés à la discrétion des dirigeants eux-mêmes, donc souvent peu significatifs, peu pertinents. Tant qu'il n'y aura pas une autorité émanant des pouvoirs publics qui imposera des normes et des objectifs clairs, chaque entreprise pourra se fixer ses objectifs sociaux et environnementaux de manière discutable. La question qui se pose c'est : quelle autorité peut imposer ces normes ? Sur quels critères ? Dans le monde, la Chine, les Etats-Unis et l'Europe pourraient se permettre d'imposer des normes aux grandes entreprises. Mais la Chine et les Etats-Unis ne prennent pas vraiment ce chemin-là. Et en Europe, si on parvenait à se mettre d'accord, il faudrait encore surmonter de nombreuses difficultés, pour définir ces normes en évitant les effets pervers.
Mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas que c'est en tentant de contrôler les patrons que l'on contrôlera les grandes entreprises. Même si à titre personnel certains grands dirigeants d'entreprise peuvent éventuellement être sensibles aux questions écologiques et sociales, la mécanique du pouvoir dans ces organisations est telle que ces convictions passent généralement au second plan. Les grands dirigeants sont contraints par leur environnement : ils travaillent avec un conseil d'administration, avec des directeurs, des n-1 et des n-2, qu'ils maîtrisent plus ou moins bien, mais ils sont surtout pris dans des phénomènes économiques qui les dépassent et auxquels ils doivent s'adapter : cours de l'action, demande des actionnaires, évolutions des marchés, règles de gouvernance, reportings financiers, etc. Et surtout, leur rémunération est liée à la valorisation des actions.
C'est cette structure même des grandes entreprises, celui des sociétés par actions, qui pose problème en réalité, et qui verrouille le système économique. C'est cette structure qui impose des objectifs de rentabilité à court terme, et fait passer les enjeux sociaux et environnementaux au second plan.
Quelles pistes proposez-vous pour repenser le modèle de la grande entreprise ?
Je ne suis pas le mieux placé pour répondre : j'ai mis mon expertise dans l'identification du problème, je laisse à d'autres la lourde tâche de trouver la solution ! Néanmoins, on peut d'ores et déjà poser quelques questions : peut-être faudrait-il interroger le statut des actionnaires ? Pourquoi ont-ils tant de pouvoir sur les entreprises ?
Les actionnaires ne sont pas propriétaires des entreprises. Les actions ne sont pas des titres de propriété mais des droits perpétuels sur les entreprises : droit de vote en assemblée générale, droit de toucher des dividendes, droit de vendre et d’acheter les actions. On croit que les actionnaires "investissent" dans les entreprises mais dans les faits ils n’apportent que très peu d’argent. Les milliards qui sont échangés chaque jour sur les marchés financiers ne vont pas dans les caisses des entreprises mais restent entre les mains des actionnaires. Toutes les études le montrent, les actionnaires reçoivent beaucoup plus d’argent des firmes qu’ils ne leur en apportent. On peut donc s’interroger sur ce qui justifie une telle rémunération des actionnaires ?
Par ailleurs, la rémunération des dirigeants se faisant essentiellement en actions, ceux-ci alignent leur intérêt sur celui des actionnaires. C’est pourquoi ils ont tendance à rechercher la rentabilité à court terme au détriment d’autres considérations comme la rentabilité à long terme ou la RSE. Là aussi, on peut se demander si la rémunération en actions des dirigeants est ce qui correspond le mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses autres parties prenantes ?
Au fond, la question n'est-elle pas de redéfinir le capitalisme dans son ensemble ?
Oui ! Dans le système économique actuel, les grandes entreprises sont désormais presque en dehors de tout contrôle politique : en Europe nous n'avons plus aucune influence sur elles, alors qu'elles n'ont jamais eu autant d'influence sur nos sociétés, nos démocraties, nos vies. On peut se demander si c'est légitime et s'interroger sur ce qu'il conviendrait de faire pour les réintégrer dans la cité.
En même temps, les actionnaires ne sont plus uniquement ces capitalistes rondouillards à chapeau haut-de-forme et cigare. Le capitalisme familial est devenu minoritaire. Les actionnaires majoritaires sont des collectifs comme les fonds de pensions, les fonds de participation des salariés, les fonds mutualistes, les assureurs ou encore les États. Certes ce sont des épargnes captives au sein desquels chaque individu a peu de pouvoir mais bénéficie quand même du système. Un système qui demeure fondamentalement inégalitaire puisque tout le monde n’est pas actionnaire et certainement pas au même niveau. Toutefois, l’existence de ces collectifs d’actionnaires nous empêchent d’avoir une vision manichéenne du problème et nous invite à l’envisager dans toute sa complexité.
La plus grande mission des intellectuels du XXIe siècle sera certainement de repenser la place des grandes entreprises dans la société, en réinterrogeant le modèle de la société par actions, et en redéfinissant les manières de les contrôler et de les encadrer.