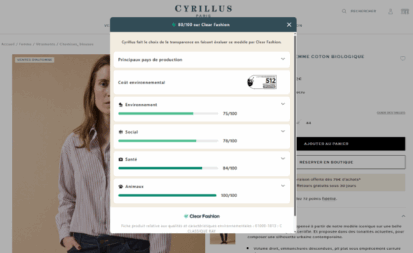Bonus-malus sur les équipements électroniques : un dispositif revu à la baisse avant même son entrée en vigueur
La mise en œuvre du dispositif était attendue depuis plus d’un an. Il sera finalement largement revu à la baisse. Fin 2023, le gouvernement avait annoncé l’instauration d’un système de bonus-malus sur l’achat de produits électroniques, comme les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs ou les lave-vaisselles. Le principe : le prix des appareils les moins réparables devait être alourdi de 20 euros, tandis que les produits disposant d’une bonne note de réparabilité pouvaient voir leur coût allégé de 40 euros.
Selon les informations du Monde, le dispositif entré en œuvre le 1er janvier 2025 affiche néanmoins une ambition amoindrie. Concernant les mobiles, particulièrement ciblés, un bonus est bel et bien prévu, mais il s’élèvera seulement à 20 euros pour les smartphones atteignant au minimum un indice de réparabilité de 9,2/10. Un périmètre réduit qui n’inclut que quelques modèles, dont ceux proposés par la marque néerlandaise Fairphone. Le malus, quant à lui, disparaît complètement. Le reste des équipements électroniques bénéficieront d’une prime de 10 à 20 euros, toujours selon la note qu’ils obtiennent.
Pour justifier ce recul, Ecologic et Ecosystem, les éco-organismes financés par les fabricants, juge la mesure initiale difficilement finançable. “Le malus aurait poussé les constructeurs à remonter les notes de réparabilité de leurs appareils, et les consommateurs à éviter les modèles pénalisés, réduisant les revenus générés par le malus”, estime auprès du Monde Bertrand Reygner, directeur des relations institutionnelles et techniques d’Ecologic. De son côté, l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP) regrette l’abandon du malus, qui“va limiter l’efficacité du dispositif.”
Tri à la source des biodéchets : moins de la moitié des Français y ont accès
Depuis quelques mois, un changement s’opère dans nos poubelles. Pelures de légumes, coquilles d’œufs et restes alimentaires doivent faire l’objet d’une collecte spécifique. Mais si ce nouveau dispositif doit permettre de valoriser les 5,5 millions de tonnes de biodéchets jetés chaque année dans l’Hexagone, l’association Zero Waste France dénonce aujourd’hui un “immense gâchis”. Moins de 40% des Français disposent en effet de solutions de tri, rapportait en juin dernier l’Agence de la transition écologique (Ademe).
“Comme nous le craignions il y a un an, l’accès au tri à la source des biodéchets demeure minoritaire, faute de solutions concrètes et adaptées déployées sur tout le territoire”, regrette dans un communiqué Pauline Debrabandere, responsable plaidoyer et campagnes de Zero Waste France. Selon les retours collectés auprès des adhérents de l’association, plusieurs facteurs expliquent ce premier état des lieux décevant, à commencer par un manque de financements, pourtant essentiels au fonctionnement et à l’accompagnement des Français au tri. Le Fonds vert sur lequel les collectivités ont pu s’appuyer pour équiper notamment les communes a subi une baisse de 20% en 2024. Une diminution qui devrait se poursuivre en 2025.
Le déploiement des équipements et solutions de tri, trop lent ou insuffisant selon les territoires, est également pointé du doigt. La sensibilisation des citoyens, pourtant l’un des enjeux majeurs permettant d’assurer le succès de la mesure, s’avère par ailleurs limitée. Un sondage dévoilé par l’Ademe montre ainsi que 38% des Français estiment “ne pas être suffisamment informés sur le tri à la source des biodéchets”. De nombreux efforts devront donc être fournis pour aboutir à un véritable changement d’échelle. Pour Zero Waste France, cela pourrait par exemple passer par l’instauration de seuils quantitatifs de réduction des biodéchets dans les ordures ménagères, allant de 39 kg par habitant et par an en 2026 à 15 kg en 2035.
Bonus réparation : deux ans après, les associations tirent un bilan mitigé
Prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec), le bonus réparation a soufflé ses deux bougies le 15 décembre dernier. La mesure permet aux consommateurs de profiter d’une réduction lors de la réparation d’un produit, qu’il s’agisse d’un vêtement, d’un appareil électronique, d’un meuble ou encore d’un article de bricolage, à condition qu’ils se rendent dans un atelier labellisé. En deux ans, près de 1,5 million d’actes de réparation ont été comptabilisés. Concernant les filières des équipements électriques et électroniques (EEE), le chiffre s’élève à 574 163 rien qu’en 2024.
Malgré tout, le bilan du dispositif s’avère encore très mitigé selon HOP. Sur l’enveloppe totale prévue pour le financement du bonus, seuls 63 millions d’euros ont ainsi été déboursés, “soit à peine plus de 30%” du budget. L’association note plusieurs freins, comme la multiplicité des bonus selon les filières qui ne permet pas la diffusion d’une information simple aux consommateurs, ou encore le faible nombre de réparateurs labellisés. “Bien que le nombre de réparateurs ait augmenté, il demeure insuffisant pour répondre à la demande croissante des consommateurs”, souligne dans un communiqué l’association Consommation logement cadre de vie (CLCV).
Pour améliorer la portée de la mesure, HOP appelle à la mise en place d’un “bonus unique et un annuaire commun”, accompagnés d’une campagne de communication nationale. De son côté, la CLCV propose d’assouplir certains critères d’éligibilité afin de prendre par exemple en compte “les opérations de maintenance et les mises à jour logicielles” lors de la réparation des équipements électroniques.