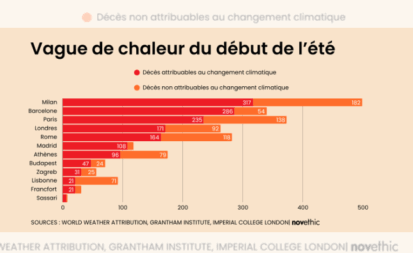Après le Pacte écologique de 2007 et le Pacte social de 2018, l’ancien ministre Nicolas d’Hulot, président d’honneur de la FNH, et Laurent Berger, secrétaire national de la CFDT, ont décidé d’unir leurs forces pour mieux se faire entendre. Avec 17 autres organisations, ils ont présenté le 5 mars dernier, un Pacte écologique et social pour le pouvoir de vivre. Une alliance inédite qui rassemble des associations de solidarité, des ONG environnementales, des fondations, des mutuelles, des syndicats…
Les 66 propositions - voir en fin d'articles - sont réunies autour de quatre grandes thématiques : le vivre-ensemble, l’économie, la transition écologique et sociale, et le partage du pouvoir. Elles ont été transmises au gouvernement dans le cadre du grand débat national. Un observatoire national du pouvoir de vivre va être mis en place. Il passera au crible les politiques publiques et rendra un premier bilan au mois de septembre.
"Le point de départ, ce n’est pas un point de déprime, a affirmé Laurent Berger, pendant la conférence de presse qui a réuni de nombreux journalistes. C’est un point de mobilisation. Vouloir traiter l’écologie sans traiter le social, c’est aller droit dans le mur. L’opposition d’une partie de la population à la hausse de la taxe carbone telle qu’elle a été proposée par le gouvernement en est le parfait exemple." 
La première partie du Grand débat national doit s’achever ce vendredi 15 mars. En deux mois, quelque 1,5 million de contributions ont été enregistrées en ligne, auxquelles s’ajoutent les 400 000 pages des cahiers citoyens. Après des conférences citoyennes régionales et une conférence dédiée à la jeunesse, l’Assemblée nationale organisera des séances du 1er au 3 avril, et le Sénat le 3 avril. À la même période, l’institut de sondage OpinionWay et le cabinet de conseil Roland Berger présenteront la restitution définitive des contributions au grand débat. Ces échanges devraient être suivis par une déclaration du gouvernement.
Mi-février, 86 députés de cinq groupes politiques plaidaient quant à eux pour une fiscalité carbone "juste socialement". Au niveau européen, le climatologue Jean Jouzel et l'économiste Pierre Larrouturou défendent le pacte finance-climat, un traité visant notamment à créer une "banque européenne du climat et de la biodiversité" (BECB), qui serait filiale de la Banque européenne d’investissement (BEI). De son côté, le parti de la majorité LREM propose une refonte globale du pacte fiscal, l’interdiction de la publicité pour les véhicules les plus polluants ou encore l’instauration de lois d’initiative citoyenne.
Concepcion Alvarez, @conce1
Les 66 propositions du pacte du pouvoir de vivre :
Garantir l’accès à un logement digne
1. Encadrer les loyers dans les zones tendues.
2. En finir avec les logements indignes et les passoires énergétiques en finançant leur rénovation et en interdisant à terme leur mise en location.
3. Investir massivement dans le logement social et très social avec l’objectif de mixité sociale, notamment en revenant sur les ponctions [des organismes] HLM.
4. Revenir sur les coupes opérées sur les aides personnalisées au logement depuis 2017.
Combattre les inégalités dans l’éducation et la formation et construire des parcours d’émancipation
5. Faire reculer le poids de l’appartenance sociale sur la réussite scolaire.
6. Investir dans les politiques publiques d’éducation populaire.
7. Développer une culture d’écoute des aspirations individuelles dans l’éducation, l’orientation et la formation tout au long de la vie.
8. Faire du compte personnel de formation un levier d’éducation permanente autant que d’adaptation aux métiers.
Un travail émancipateur
9. Généraliser les accords de qualité de vie au travail dans les entreprises et administrations.
10. Faire évoluer automatiquement les grilles salariales en fonction de l’évolution du smic dans le privé et le public.
11. Lutter contre les recours abusifs aux contrats courts et/ou au temps partiel subi.
Construire un bouclier de services publics dans tous les territoires
12. Systématiser la proposition d’accompagnement humain à l’exercice des droits.
13. Généraliser les maisons de services au public.
14. Garantir un accès à la santé, en développant notamment les maisons et centres de santé accessibles à tous.
Une solidarité intergénérationnelle
15. Garantir une protection sociale pour tous les jeunes : la « garantie jeunes universelle ».
16. Garantir une retraite par répartition avec un niveau de pension qui ne puisse pas être inférieur au smic pour une carrière pleine.
17. Donner les moyens d’une politique ambitieuse du grand âge et de la perte d’autonomie.
Construire l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
18. Construire dès le plus jeune âge une culture de l’égalité entre femmes et hommes.
19. Réévaluer les classifications pour revaloriser les métiers majoritairement occupés par des femmes.
20. Promouvoir l’orientation non genrée lors de la formation initiale.
Lutter contre les discriminations
21. Construire une politique nationale de lutte contre les discriminations.
22. Renforcer les moyens dans les territoires du défenseur des droits et de l’inspection du travail pour lutter contre les discriminations.
Accueillir dignement les migrants dans le respect des droits fondamentaux
23. Construire et garantir un régime du droit d’asile européen dans le respect de la Convention de Genève.
24. Promouvoir une politique d’intégration bienveillante qui s’inscrit dans notre devoir d’hospitalité.
Rendre accessible à tous une nourriture saine et éco-responsable
25. Généraliser les repas bio dans les établissements publics et privés.
26. Favoriser l’accès aux produits locaux éco-responsables en organisant les circuits courts sur les territoires.
Une économie et une finance vraiment responsables
27. Adosser la rémunération variable des dirigeants à la performance sociale et environnementale, et pas seulement financière.
28. Rendre les stratégies climat des entreprises réellement compatibles avec l’accord de Paris.
29. Taxer plus fortement les dividendes et taxer le rachat par les entreprises de leurs propres actions.
30. Conditionner les aides publiques aux entreprises pour les rendre solidaires de leur territoire.
31. Soutenir l’économie sociale et solidaire (coopératives, mutuelles et associations) et des modèles d’organisation d’entreprises plus responsables.
32. Porter politiquement les spécificités du modèle non-lucratif français au niveau européen.
33. Définir des services sociaux d’intérêt général préservés des logiques de marché.
Redonner du sens au partage des richesses
34. Plafonner les rémunérations des dirigeants d’entreprise, et encadrer les écarts entre les plus hautes et les plus basses rémunérations.
35. Négocier le partage de la valeur ajoutée au sein des entreprises et avec les sous-traitants.
36. Revaloriser les minimas sociaux et les faire évoluer au même rythme que les revenus du travail.
Engager une réforme de la fiscalité pour plus de justice
37. Introduire une plus grande progressivité de l’impôt (impôt sur le revenu et fiscalité indirecte).
38. Taxer les hauts patrimoines.
39. Mettre fin aux dérogations bénéficiant aux revenus du capital.
40. Evaluer, modifier et réorienter les dépenses (niches) fiscales et les aides publiques aux entreprises pour qu’elles profitent à l’emploi, à la transition écologique, à l’investissement social et à la qualité de vie.
41. Augmenter les moyens pour lutter contre l’évasion et l’optimisation fiscales, et promouvoir une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés au niveau européen.
Appliquer le principe de pollueur-payeur à tous
42. Mettre fin aux exonérations de la taxe carbone française pour certains secteurs, en particulier le transport aérien et maritime, les entreprises du marché carbone européen et le transport routier de marchandises.
Utiliser de nouveaux indicateurs de richesse
43. Concevoir, piloter et évaluer les politiques économiques en fonction de leur impact sur la qualité de vie, la justice sociale, la réduction des inégalités, l’usage sobre des ressources et leur capacité à favoriser des emplois de qualité.
Développer des mobilités plus durables et sortir de la dépendance aux énergies fossiles
44. Fixer la fin de vente des véhicules essence ou diesel neufs à un horizon compatible avec l’accord de Paris sur le climat.
45. Réengager l’Etat dans le maillage ferroviaire du territoire, pour lutter contre le dérèglement climatique et les fractures territoriales.
46. Faire respecter l’obligation de plans négociés de mobilité dans les entreprises et administrations et les territoires.
47. Instaurer le droit pour tous les salariés de bénéficier du remboursement employeur pour les frais de covoiturage ou de vélo liés aux trajets domicile-travail.
Organiser la transition écologique dans les territoires et anticiper les mutations de l’emploi
48. Créer des budgets participatifs au niveau local pour organiser la transition : 10 milliards de l’Etat, 10 % du budget des collectivités locales, 10 % du budget de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
49. S’engager résolument dans les énergies renouvelables et les économies d’énergie, créatrices d’emplois non délocalisables.
50. Garantir l’accompagnement des salariés et des entreprises quant aux conséquences de la transition écologique sur l’emploi.
Instaurer une fiscalité écologique solidaire et sociale
51. Adopter une trajectoire de la taxe carbone compatible avec l’accord de Paris et reverser l’ensemble des recettes de la fiscalité écologique aux ménages et au financement de la transition.
52. Supprimer les subventions et mesures fiscales dommageables à l’environnement et à la préservation du patrimoine naturel.
Adopter un plan d’investissement dans la transition écologique
53. Sortir les investissements verts du calcul du déficit public dans les règles européennes.
54. Définir un plan d’investissement public et privé dans la transition écologique à hauteur des 55 à 85 milliards d’euros manquants par an entre 2019 et 2023, et soumettre la politique commerciale et d’investissement de l’Union européenne aux objectifs climatiques, environnementaux et sociaux.
Permettre l’expression et la participation de tous les citoyens
55. Accroître le pouvoir d’expression des plus défavorisés.
56. Mettre en œuvre une stratégie nationale sur l’engagement citoyen tout au long de la vie.
57. Soutenir la vie associative et syndicale en renforçant ses moyens et en prenant en compte ce qu’elle représente.
58. Inclure des citoyens tirés au sort dans le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
59. Mieux inscrire le CESE dans le processus d’élaboration législatif et renforcer son rôle d’évaluation des lois et des politiques publiques.
Co-construire les politiques publiques
60. Multiplier les jurys citoyens pour l’évaluation des projets de loi, des politiques publiques, mais aussi avec un droit d’interpellation des gouvernements et institutions.
61. S’appuyer sur la vitalité associative dans les politiques publiques et l’encourager en permettant partout le déploiement des initiatives citoyennes.
62. Impliquer les citoyens et la société civile organisée dans l’élaboration des politiques de redistribution et politiques sociales.
Partager le pouvoir dans les entreprises
63. Instaurer une représentation pour moitié des salariés dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance.
64. Rendre obligatoire la négociation dans les entreprises sur leur « raison d’être » – finalités économiques, sociales, environnementales, sociétales.
Accroître le droit d’expression au travail
65. Généraliser les espaces d’expression des travailleurs et travailleuses pour intervenir sur les transformations de leur travail (cadences, évolution des tâches, conditions de travail…).
66. Faire participer tous les salariés à la définition de l’agenda social dans l’entreprise, à l’initiative des institutions représentatives du personnel.