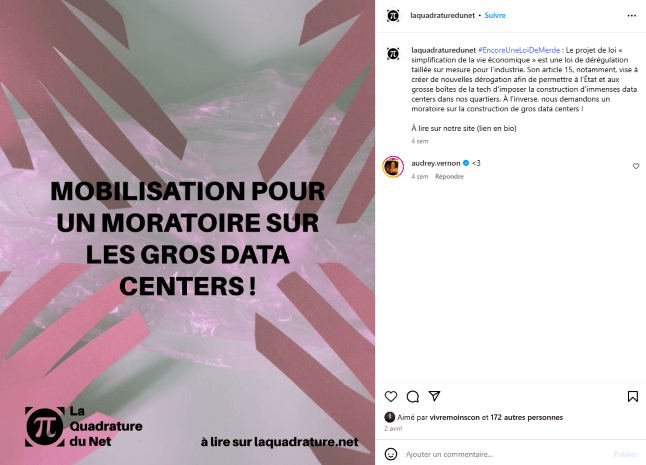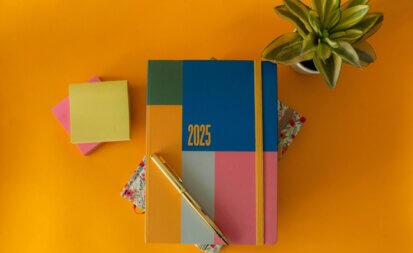Sous couvert de souveraineté nationale, la France entend devenir le nouvel eldorado des data centers dans l’unique but de s’assurer une place dans la “course à l’IA”. Pour y parvenir, le gouvernement entend défendre son projet sur le terrain législatif, et notamment via l’article 15 du projet de loi de simplification de la vie économique, actuellement en débat à l’Assemblée nationale.
Ces infrastructures d’une surface comprise entre 30 et 50 hectares (soit plus de 71 terrains de football, ndlr) obtiendront, si l’article est adopté, le statut de projets d’intérêt national majeur (PINM), issu de la loi de 2023 sur l’industrie verte. L’idée de cet article est en effet d’alléger les contraintes et les normes, notamment environnementales, afin de faciliter l’installation sur le territoire de nouveaux centres de données. Par conséquent, il sera possible de contourner certaines réglementations environnementales, notamment celles relatives aux espèces protégées, ainsi que de se passer de consultations publiques, a dénoncé l’association La Quadrature du Net.
L’argument de la souveraineté numérique critiqué
Aux côtés de plusieurs associations, dont Data for Good, GreenIT et Commown, Anne Stambach-Terrenoir, députée LFI de Haute-Garonne, et Nicolas Bonnet, député écologiste du Puy-de-Dôme, ont déposé une série d’amendements appelant au retrait de l’article 15, ainsi qu’à un moratoire de deux ans sur la construction des plus gros data centers en France et la tenue d’une concertation publique sur le sujet. Lors d’une conférence de presse à l’Assemblée nationale, le 29 avril dernier, tous ont rejeté en bloc l’argument selon lequel l’installation de data centers permettrait d’asseoir “la souveraineté nationale de la France en matière de numérique“. “Un mot-valise prononcé à tire-larigot pour nous vendre des data centers”, dénonce Nicolas Bonnet. Pour Lise Breteau, avocate en droit du numérique et représentante de l’association GreenIT, “peu importe l’endroit où est implanté le centre de données, c’est l’exploitant, celui qui en a le contrôle qui compte”, et notamment dans le cadre du règlement RGPD (à savoir le règlement européen sur la protection des données).
D’ailleurs, si l’on regarde également du côté de la création d’emplois ou de l’activité économique, autre argument avancé par les défenseurs du projet de loi, il n’en est rien. Selon une étude du Cigref, publiée le 25 avril dernier, près de 80% des dépenses européennes en matière de logiciels ou de services cloud à usage professionnel – soit 265 milliards d’euros par an – sont à destination d’entreprises américaines, conduisant à la création de millions d’emplois aux États-Unis. “En France, ces data centers vont essentiellement générer des emplois dans le BTP, dans le gardiennage et éventuellement quelques techniciens”, déplore Adrien Montagut, membre de l’association Commown.
Un impact environnemental et énergétique à ne pas négliger
Or, cette multiplication des centres de données sur le territoire, afin de répondre principalement au besoin de l’IA, est d’autant plus problématique lorsque l’on regarde du côté de leur consommation énergétique. D’après l’Agence internationale de l’énergie (AIE), celle-ci va être multipliée par deux d’ici à 2030, pour passer de 1,5% à 3% de la consommation mondiale, soit l’équivalent de celle du Japon. En France, ces infrastructures représentent déjà 2% de la consommation d’électricité, un chiffre qui devrait tripler d’ici à 2035. À titre de comparaison, en Irlande, autre terre d’accueil pour les data centers, ces derniers représentaient en 2023 21% de la demande en électricité du pays. D’ailleurs, Dublin a décrété un moratoire sur leur installation pour ne pas davantage fragiliser leur réseau électrique.
Au-delà de l’impact énergétique, les impacts environnementaux sont également nombreux. En plus de l’artificialisation des terres que sous-tend leur installation, leur consommation d’eau pour leur refroidissement est considérable. “Jusqu’à 6,5 piscines olympiques par jour, et tout cela en plus sur des territoires déjà gravement atteints par des phénomènes de sécheresse”, explique la députée Anne Stambach-Terrenoir. “Il y a une véritable menace sur notre accès collectif à l’eau potable et à la poursuite de nos activités agricoles”, alerte-t-elle. C’est pour cette raison que collectivement, députés et associations appellent aujourd’hui à une réflexion sur ces centres de données, et plus largement sur l’usage que nous avons de l’IA, surtout si cette technologie est utilisée pour réaliser des “starter packs” ou son portrait à la manière de Miyazaki.