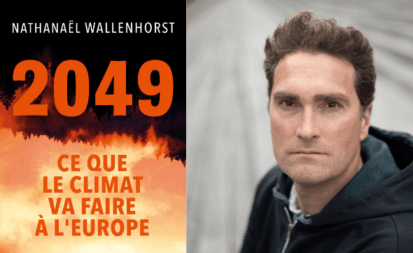C’est la douche froide. Au lendemain du passage de la proposition de loi (PPL) “anti fast-fashion” en Commission développement durable au Sénat, associations et acteurs français de la mode dénoncent d’importants reculs. Adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 14 mars 2024, le texte avait esquissé les premiers pas vers un encadrement législatif des géants de la mode rapide. Le but : réduire la pression exercée par l’industrie textile sur l’environnement. Des impacts qui se sont intensifiés ces dernières années avec l’arrivée en force des plateformes de e-commerce chinoises.
Si la proposition a été adoptée par la Commission, les sénateurs ont en revanche amendé plusieurs articles, à commencer par celui permettant de définir les entreprises relevant de la fast-fashion, une question clé déjà sujette à critique lors du passage de la PPL à l’Assemblée nationale. C’est en effet le nombre de modèles mis en vente – et non de produits – qui a été ici retenu. Cette notion permettra de cibler principalement les plateformes d’ultra fast-fashion Shein et Temu, mais une grande partie des autres enseignes seront épargnées. Les amendements rédigés par les sénateurs excluent en effet les plateformes multimarques, comme Asos, et les entreprises françaises et européennes, à l’instar de Zara, Kiabi ou H&M.
Disparition du bonus-malus
“Je ne veux pas reproduire ce qu’il s’est passé avec la fermeture de Camaïeu. On peut dire ce que l’on veut, mais ces marques font vivre des centres-villes”, affirme Sylvie Valente-Le Hir, la rapporteure du texte. “Les sénateurs cherchent avant tout à encadrer les enseignes qui viennent de l’international et préserver une fast-fashion européenne, alors même que leurs vêtements sont fabriqués à l’autre bout du monde et ne préservent absolument pas les emplois localement”, rétorque à Novethic Pauline Debrabandere, coordinatrice de campagnes pour Zero Waste.
Les seuils de mise en vente devront par ailleurs être déterminés par décret, un point qui fragilise l’application de la loi. “Ce n’est plus la loi qui impose les seuils”, note Thomas Ebélé, co-fondateur de SloWeAre, label RSE dédié aux marques de mode. Or, “il y a un risque que les décrets d’application ne sortent jamais”, précise-t-il.
Autre retour en arrière, alors que les députés avaient établi un système de bonus-malus indexé sur l’affichage environnemental développé à partir des travaux de l’Ademe, ce dispositif semble remis en question. En lieu et place, le texte évoque des pénalités associées à des “pratiques industrielles et commerciales”. Problème, les contours de ces dernières ne sont à ce jour pas définies. “Il n’y a même pas de renvoi vers un décret. En l’état c’est inapplicable, cela nous alerte beaucoup”, explique Pauline Debrabandere.
“Vers une loi cosmétique”
Enfin, l’article 3 prévoyant l’interdiction de la publicité par les marques de mode rapide a été purement et simplement retiré. Ne sera finalement encadré que l’appel à des influenceurs afin de promouvoir les produits issus de la fast-fashion. Pour justifier ce choix, les sénateurs pointent un risque d’inconstitutionnalité et d’incompatibilité avec le droit européen. “C’est une sécurité juridique. Nous avons supprimé cette interdiction globale car elle aurait pu être interprétée par Bruxelles comme une entrave à la liberté d’entreprendre”, précise Sylvie Valente-Le Hir.
Tandis que la rapporteure et le président de la Commission, Jean-François Longeot, y voient un texte “plus solide juridiquement”, les associations dénoncent de leur côté un détricotage en règle. Dans un communiqué, la coalition Stop fast-fashion qui rassemble une douzaine d’organisations, estime que la commission sénatoriale “a fait le choix de vider la loi de sa substance”. “On s’oriente vraiment vers une loi cosmétique, abonde Thomas Ebélé. Personne ne veut se saisir de la responsabilité de règlementer la fast-fashion”.
A cela s’ajoute l’absence de mesures protégeant les droits humains. “Nous regrettons que les impacts sociaux, qu’ils concernent les travailleurs ou les consommateurs, ne soient pas intégrés au texte”, observe auprès de Novethic Catherine Dauriac, présidente de l’association Fashion Revolution France.
Un examen prévu mi-mai ?
Les membres de la coalition Stop fast-fashion y voient le résultat d’un lobbying intensif de l’industrie textile auprès des sénateurs, mais aussi du gouvernement. Le nouveau géant de la mode jetable Shein a par exemple accentué ces derniers mois la pression médiatique et politique. Après avoir recruté l’ancien ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, au sein de son comité RSE, son patron, Donald Tang, s’est exprimé mi-mars dans le JDD, réfutant faire de la fast-fashion. Résultat, en parallèle des modifications apportées à la PPL en commission, l’examen du texte par le Sénat se fait attendre. D’abord annoncé pour le 26 mars, le processus n’a toujours pas eu lieu. Le vote pourrait se dérouler le 19 mai prochain, mais cette date n’a toujours pas été confirmée officiellement.
L’encadrement de la mode rapide ne ferait en outre pas partie des priorités du Premier ministre. En privé, François Bayrou aurait affirmé ne pas vouloir “nuire au pouvoir d’achat des Français les plus modestes”, selon France Inter. Pour protester contre ce blocage, les milieux associatifs sont fortement mobilisés : dix tonnes de déchets textiles ont été déversées près du Sénat le 14 mars dernier et des manifestations ont été organisées aux quatre coins de la France. “Nous demandons aux sénateurs et sénatrices de faire le choix d’une industrie textile française juste, créatrice d’emplois locaux, en pénalisant les marques dont les prix bas cachent des pratiques désastreuses pour l’environnement et les droits humains”, exhorte Stop fast-fashion. Selon la coalition, “près de 300 000 emplois” ont été détruits en France depuis les années 90, suite à “l’arrivée de la fast-fashion”.