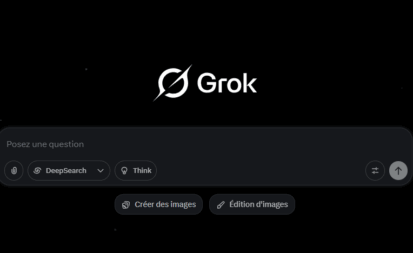“Les gens arrivent à bout, épuisés, prêts à craquer”. C’est ainsi que le docteur Paul Clément, médecin généraliste au Centre du burn-out, décrit les patients qu’il accompagne, des salariés en burn-out, victimes de troubles anxieux généralisés, parfois dépressifs, qui ont été écrasés par leurs conditions de travail, les conflits managériaux ou des situations de harcèlement. Ils sont de plus en plus nombreux chaque année en France à subir cette crise de la santé mentale au travail qui continue d’enfler : selon le ministère du Travail, près d’un tiers des salariés affichent un mauvais score d’état de santé mentale.
Pourtant, les troubles psychologiques liés au travail sont encore assez méconnus et mal traités en France. “En général, les employeurs ne veulent pas voir en face le lien avec les conditions de travail ou l’organisation managériale, et considèrent que la souffrance psychique de leurs salariés relève d’un problème personnel”, explique ainsi à Novethic Loïc Lerouge, directeur de recherche au CNRS et au Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale. Selon lui, les managers et dirigeants, mal formés sur les risques psycho-sociaux, tendent à ignorer les alertes des salariés, et laissent donc la situation s’envenimer. Mais c’est plus globalement le sujet de la santé mentale au travail qui est mal compris par l’ensemble des acteurs. “Les patients, mais aussi les médecins, ne sont pas toujours bien informés sur le sujet, ce qui retarde les prises en charge“, explique ainsi à Novethic Marie Pezé, docteure en psychologie et fondatrice du réseau Souffrance et Travail. Par peur d’être jugé ou par crainte de se mettre à dos son employeur ou de se retrouver en difficultés économiques, beaucoup de salariés en souffrance attendent des mois avant d’aller voir leur médecin. Et lorsqu’ils le font, il est souvent difficile de voir leur souffrance reconnue.
Santé mentale au travail : l’urgence de construire des entreprises capacitantes
La santé mentale au travail encore mal connue
“La psychopathologie du travail n’est pas encore suffisamment bien connue dans le milieu médical”, explique ainsi Marie Pezé. Beaucoup de médecins rechignent encore à placer en arrêt de travail des salariés épuisés ou en situation de détresse psychologique, soit par méconnaissance du sujet, soit par peur d’être attaqués. “Il faut savoir que les médecins se font poursuivre devant l’Ordre des médecins par les avocats des entreprises ou de leurs assurances lorsqu’ils disent que des salariés sont en souffrance au travail”, explique le docteur Paul Clément. Arguant que les médecins généralistes ou psychiatres ne sont pas compétents pour juger des liens entre le travail et la souffrance de leurs patients sans avoir examiné in situ les conditions de travail ou sans avoir eu l’avis d’un médecin du travail, les employeurs contestent les arrêts maladie dès lors qu’ils mentionnent un lien avec le travail. Résultat : des médecins suspendus par leur ordre pour avoir constaté la souffrance de leurs patients liée à leur travail.
Une aberration pour Marie Pezé. “La classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé reconnaît le burn-out, les psychiatres reconnaissent le burn-out, mais si un médecin l’écrit dans un arrêt de travail, il se retrouve suspendu… C‘est la science qui se couche devant les avocats des entreprises”, lance la spécialiste. Si, dans un jugement de mai 2024 qui devrait faire évoluer les pratiques, le Conseil d’Etat a pourtant validé la compétence des médecins dans la reconnaissance de la souffrance psychologique et de l’épuisement professionnel, la prise en charge reste souvent difficile pour les patients.
Parcours du combattant
Pour les travailleurs qui parviennent malgré tout à être arrêtés pour des pathologies liées à la santé mentale au travail, un autre chemin de croix s’ouvre : celui de la reconnaissance par l’Assurance maladie. En principe, les malaises ou les chocs psychologiques liés au travail, ou les syndromes d’épuisement ou les dépressions liés au travail doivent être déclarés par les médecins comme des accidents du travail ou des maladies d’origine professionnelle, afin de permettre de bénéficier de meilleures conditions d’indemnisation et d’accompagnement médical adapté. Or “peu de médecins savent qu’ils peuvent faire ces déclarations pour des problèmes de santé mentale”, explique Marie Pezé, qui a publié un guide pour les médecins généralistes sur le sujet.
Surtout, la reconnaissance par l’Assurance maladie peut demander beaucoup de temps et d’énergie. “Les troubles psychologiques font partie de ce que l’on appelle les “maladies hors tableau””, explique le docteur Paul Clément. Autrement dit, ils ne font pas partie de la liste des pathologies qui font l’objet d’une reconnaissance présumée comme étant liée au travail par l’Assurance Maladie, comme peut l’être par exemple un cancer lié à l’amiante pour un ouvrier du bâtiment. “Il faut donc prouver le lien entre le travail et le trouble, ce qui peut être complexe médicalement”, résume le médecin. Les travailleurs victimes doivent alors démontrer, au cours d’une enquête diligentée par l’Assurance maladie, les causes de leur souffrance et ses liens avec le travail. Une épreuve psychologique, alors qu’il peut être difficile de prouver concrètement un management toxique, des conditions de travail dégradées, ou même une situation de harcèlement. “C’est un vrai parcours du combattant, à un moment où les patients sont en pleine détresse cognitive”, explique Marie Pezé, qui conseille aux patients de se faire accompagner par leur avocat, ou des personnes spécialisées comme celles du réseau Souffrance et Travail. “Lors de ces démarches, les employeurs font preuve d’une véritable maltraitance institutionnelle, ils contestent violemment, ils tentent de faire porter la responsabilité aux patients, se défaussent en parlant de problèmes personnels…”, explique de son côté le docteur Paul Clément.
Si accidents du travail comme les malaises ou les chocs (appelés “états de stress aigus”) ainsi que les dépressions, les troubles anxieux généralisés ou les syndromes de stress post-traumatique tendent à être de mieux en mieux reconnus par les comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), c’est encore difficile pour le burn-out. “Il y a eu 30 000 accidents du travail d’origine psychique reconnus l’an dernier par l’Assurance Maladie”, explique Marie Pezé. Pour les maladies professionnelles comme le burn-out, c’est moins de 2 000.
Faire évoluer le cadre institutionnel ?
Les grandes difficultés à faire reconnaître la souffrance psychique au travail sont pourtant connues de longue date. En 2010 déjà, un rapport sénatorial sur le sujet rappelait l’urgence de s’attaquer à la crise de la santé mentale au travail, tout en reconnaissant que l’Assurance maladie prenait “faiblement en compte les accidents ou les pathologies résultant du stress ou d’autres troubles psychosociaux”. Dans ses recommandations, la mission sénatoriale préconisait d’assouplir les critères de reconnaissance des maladies professionnelles liées à la dégradation de la santé mentale, et s’interrogeait même sur la pertinence d’ajouter les maladies psychiques au tableau des maladies reconnues comme pouvant être d’origine professionnelle. Une hypothèse qui n’a jamais vu le jour. “Ce tableau est établi de façon paritaire avec les organisations patronales, dont le Medef… Bien entendu, ces dernières ne veulent pas entendre parler d’une reconnaissance des burn-out”, explique Marie Pezé.
Depuis une dizaine d’années malgré tout, la France a fait évoluer son cadre institutionnel sur la reconnaissance de la crise de la santé mentale au travail. “En 2016, avec la loi Rebsamen, puis en 2021 avec loi “Santé au travail”, la France a essayé de renforcer la prévention, et d’assouplir le droit de la sécurité sociale en essayant de favoriser la reconnaissance des pathologies psychiques”, explique ainsi Loïc Lerouge. Des lois qui visent également à augmenter la compétence des instances de représentation du personnel en matière de santé, ou à renforcer le rôle des médecins du travail dans l’identification et la reconnaissance des maladies psychiques professionnelles. Pourtant, les progrès restent lents : quelques milliers de dossiers seulement sont déposés à l’Assurance maladie pour reconnaissance de maladie professionnelle psychique chaque année, et à peine un sur deux reçoit un avis favorable. “Il y a pourtant déjà tout dans la loi depuis la loi de 2002 sur la modernisation sociale, le problème, c’est que rien n’est fait pour faire appliquer le cadre juridique”, se lamente Marie Pezé, qui pointe le manque de moyens de la médecine du travail, l’affaiblissement des instances de représentation des personnels depuis les ordonnances Macron de 2017, l’absence de contrôles dans les entreprises ou encore le manque d’information des salariés et des médecins.
Pour les travailleurs victimes, les procédures restent donc difficiles et finissent bien souvent devant la justice. “Les travailleurs qui obtiennent gain de cause doivent en général aller aux prud’hommes et cela a un coût, à la fois financier mais aussi psychologique, puisqu’il faut tenir des années de procédures”, explique le docteur Paul Clément. “Il faudrait mieux informer les salariés de leurs droits, leur expliquer leurs recours, les jurisprudences, leur donner les armes pour se défendre”, clame quant à elle Marie Pezé, qui a justement édité un guide sur le sujet à destination des travailleurs. “Donner des armes” aux salariés, une formule qui illustre à quel point la quête d’une meilleure prise en compte de la santé mentale au travail reste, malgré tout, une véritable bataille.