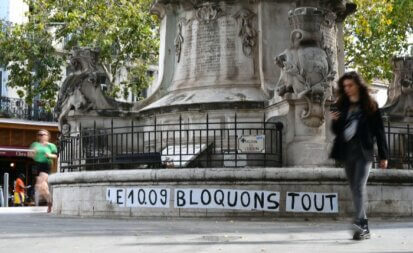“Il y a forcément un loupé si on en est là”, admet auprès de Novethic Anne Bringault, directrice des programmes au sein du Réseau action climat, qui fédère en France 27 associations environnementales. Dans certains territoires, l’écologie est devenue un sujet tabou, à bannir des conversations. “Les écologistes, il y en a marre.” “Ils sont trop dans les extrêmes.” “J’ai horreur de ces gens-là”. C’est le genre de témoignages que l’on peut entendre de la part des électeurs du Rassemblement national, arrivé en tête des élections européennes en France. Comment en est-on arrivé là alors que les impacts du changement climatique sont de plus en plus intenses et fréquents ?
“Nous avons probablement ignoré le RN, fait comme s’il n’existait pas. On a décrypté les programmes de chaque candidat, y compris celui du RN, mais on est rarement rentrés dans le débat médiatico-politique et sur les réseaux sociaux pour le confronter à ses incohérences. Ce n’était pas notre priorité mais ça va le devenir”, explique Anne Bringault. La place laissée par les associations mais aussi par les partis de gauche et de droite a été comblée par le RN.
“Ce vote était très prévisible car les derniers à faire encore du porte-à-porte, du tractage et à être présents sur les marchés dans certains territoires ruraux, c’est le Rassemblement national“, constate Julien Fosse, fonctionnaire d’Etat, membre du comité d’orientation du Lierre, le réseau écologiste des professionnels de l’action publique, créé en 2019. “Cet abandon de la puissance publique et d’un certain nombre d’acteurs associatifs, économiques et politiques a laissé un boulevard au parti d’extrême-droite”, poursuit-il.
Le défi de l’acceptabilité sociale
La victoire du RN aux Européennes est donc avant tout le résultat d’un vote de contestation. Mais il ne signifie pas forcément un rejet du sujet écologique. Les nombreux sondages publiés avant les élections européennes montraient ainsi que la majorité des Français – sans prendre en compte leur orientation politique – était préoccupés par le changement climatique et appelaient à des mesures fortes. Neuf Français sur dix estiment par exemple qu’il faudra changer nos habitudes de vie pour faire face aux effets du changement climatique, révélait un sondage commandé par le ministère de la Transition écologique en début d’année. Pour Théodore Tallent, chercheur doctorant et enseignant en science politique à Sciences Po Paris, ce qui ressort de son travail de terrain, réalisé principalement hors des grandes villes, c’est bien “une préoccupation environnementale et un soutien général à l’action climatique, mais également un réel scepticisme à l’égard de la transition écologique telle qu’elle est conçue ou envisagée”, explique-t-il dans une note publiée en avril dernier pour la fondation Jean Jaurès.
Le défi, après celui de la prise de conscience, est donc désormais celui de l’acceptabilité sociale de la transition écologique. “Alors que nous sommes maintenant dans la fabrique de la transition, et qu’on commence à en sentir ses contraintes (taxe carbone, zones à faible émissions, rénovation énergétique…), il faut plus encore qu’avant, raconter comment elle va se traduire dans le quotidien et changer la vie des gens positivement”, défend-il auprès de Novethic. Et de citer l’indépendance énergétique, les emplois créés, l’amélioration de la qualité de l’air et de la nourriture, les effets sur la santé, la baisse de la facture d’énergie…Tout autant d’éléments qui peinent à émerger dans le débat pour dessiner un futur désirable autour de la transition. Parmi les 12 pistes qu’il propose pour rassembler autour de la transition, il y a ainsi le fait de travailler sur les imaginaires et les discours, mais aussi sur la répartition de l’effort et des coûts.
Transition juste
La question de la transition juste doit ainsi être placée au cœur des discours et les politiques sociales venir en complément des politiques climatiques pour que celles-ci soient acceptées, défendent les spécialistes. “En Espagne par exemple, la fermeture des mines de charbon s’est accompagnée de bonnes mesures compensatoires mises en place par le Parti socialiste. Cela lui a permis de gagner des voix aux élections“, pointe Bruno Palier, directeur de recherche du CNRS à Sciences Po. A contrario à Milan, des chercheurs italiens ont démontré une corrélation entre la mise en place d’une taxe sur les véhicules polluants sans compensation et une hausse du vote d’extrême droite.
Mais ça ne suffit pas. Il faut que ces mesures compensatoires et d’accompagnement soient bien ciblées. Dans une étude sur le coût de la transition environnementale, publiée en début d’année dans la Revue française des affaires sociales, Bruno Palier démontre que les coûts indirects liés aux politiques d’adaptation et d’atténuation vont proportionnellement peser le plus sur “les juste au-dessus”, ceux qui se situent entre les franges supérieures des classes populaires et la classe moyenne la moins aisée. Et pourtant, lorsqu’il y a des mesures compensatoires, elles ne visent que les populations les plus pauvres.
Le chercheur propose plusieurs exemples, parmi lesquels la fin des véhicules thermiques. “La moitié des populations les plus pauvres n’ont pas de voiture. En revanche, les “juste au-dessus”, qui sont très dépendants de leurs voitures, n’ont pas les moyens de passer à l’électrique et vivent généralement loin des transports en commun”, explique-t-il. En ce qui concerne la rénovation énergétique, “pour ceux qui sont dans le parc locatif privé, la réalisation de travaux va renchérir le coût du loyer. Les “juste au-dessus” sont aussi ceux qui occupent les emplois les plus carbonés (dans le pétrole, la chimie, l’industrie)”, détaille Bruno Palier.
Exister socialement autrement
Ces “juste au-dessus”, qui vont être les grands perdants de la transition, étaient déjà les grands perdants de l’automatisation et de la globalisation et se situent au cœur de l’électorat du RN, caractérisé par des populations rurales ou périurbaines à cheval entre les franges supérieures des classes populaires et la classe moyenne la moins aisée. Mais pour réussir à les embarquer, “renforcer le volet social ne suffira pas car ce n’est pas juste une question financière”, complète Jean-Baptiste Comby, sociologue, maître de conférences à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, auteur de “Ecolos mais pas trop. Les classes sociales face à l’enjeu environnemental” (avril 2024). “L’écologie rebute l’électorat RN parce qu’elle remet en cause sa manière de vivre, de se divertir, de se nourrir… sa manière d’exister dans la société. Elle le dévalorise socialement. Il faut donc d’abord redonner de la dignité à ces groupes sociaux “, explique-t-il.
La colère des Gilets jaunes, née de la hausse de la taxe carbone, avait permis de tirer une première alerte et de lier davantage la question climatique et sociale. “Mais cela n’a pas entrainé une refonte des politiques écologiques qui doivent passer par une transformation en profondeur de notre organisation sociale”, poursuit Jean-Baptiste Comby. Il appelle à une alliance entre les classes moyennes dites culturelles (avec un fort capital culturel, des ressources culturelles valorisées en société) et les classes populaires afin de créer un nouveau rapport de forces autour d’un nouveau contrat social. “Plutôt que des manifestations, même massives, dans les villes, cela implique d’investir les territoires, d’aller voir les électeurs du RN et de faire preuve d’un peu de modestie en disant “ok, on s’est plantés, comment peut-on travailler ensemble ?”, lance Jean-Baptiste Comby qui invite à “déplacer la conflictualité du terrain culturel (migrants vs Français ; écolos cultivés vs pollueurs non cultivés) vers celui des classes sociales (ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l’ont pas)”.
Du côté des associations, si la mobilisation est pour l’instant concentrée sur la critique du programme du RN et l’importance de faire barrage aux prochaines législatives, la question de mieux s’adresser à ces électeurs va se poser dans les prochaines semaines. “Notre discours ne sort pas des cercles habituels. Au sein du RAC, nous allons travailler pour aller davantage sur le terrain afin de dialoguer avec l’électorat d’extrême-droite et construire ensemble des solutions comme l’avait fait la Convention citoyenne sur le climat”, assure Anne Bringault. La volonté d’allier climat et social se retrouve aussi dans le lancement, le 19 juin, de la “Coalition 2024″ qui rassemble pour la première fois les organisations d’associations, syndicats et ONG du Pacte de Pouvoir de Vivre et de l’Alliance Écologique et Sociale. Elles proposent 16 mesures à mettre en œuvre en un an pour “améliorer concrètement la vie des gens, notamment les plus vulnérables, et être enfin à la hauteur de la crise climatique et environnementale.” La vague brune du 9 juin aura au moins permis de relancer cette prise de conscience.