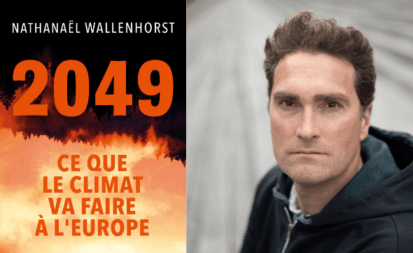Le « biochar » est une forme de charbon végétal produit par la pyrolyse de matières organiques telles que les sous-produits de la filière bois, résidus agricoles, déjections solides, déchets verts ou déchets alimentaires. Ce processus de conversion thermique se déroule en l’absence d’oxygène, transformant la biomasse en un matériau carboné stable. Le biochar pourrait avoir des propriétés bénéfiques en agriculture et en gestion durable des sols : en tant qu’amendement du sol, le biochar améliore en effet la rétention d’eau, la fertilité et la séquestration du carbone, contribuant ainsi à la lutte contre les changements climatiques.
Composition du biochar
Sa composition varie en fonction des matières premières utilisées, mais en général, le biochar est composé principalement de carbone (environ 60-80 %). C’est le carbone qui rend le biochar stable et résistant à la décomposition biologique. En plus du carbone, le biochar peut contenir des traces de matière organique résiduelle provenant des matières premières utilisées pour sa production. Cela peut inclure des composés organiques complexes qui n’ont pas été complètement décomposés lors du processus de pyrolyse. Le biochar peut aussi contenir des minéraux provenant des matières premières utilisées ou formés pendant le processus de pyrolyse. Ces minéraux peuvent contribuer aux propriétés physiques et chimiques du biochar, ainsi qu’à son interaction avec le sol. Enfin, le biochar peut contenir une certaine quantité d’eau adsorbée, qui peut varier en fonction des conditions environnementales et de stockage.
Utilité et avantages dans la transition écologique
Le biochar est considéré comme utile pour la transition écologique et la transition vers une économie décarbonée pour plusieurs raisons. D’abord, il pourrait permettre la séquestration du carbone, notamment dans les sols lorsqu’il est utilisé comme amendement sur les sols agricoles. Le biochar permettrait de capturer et de stocker durablement le carbone organique dans le sol, réduisant ainsi les émissions de CO2 dans l’atmosphère et contribuant à la lutte contre le changement climatique. En raison de ses capacités et de sa stabilité – une tonne de biochar permettrait de séquestrer entre 1,3 et 3 tonnes de CO2 dans le sol pendant des siècles – le biochar est considéré comme un puissant puits de carbone à empreinte négative.
En ajoutant du biochar au sol, il serait également possible d’améliorer sa structure, sa fertilité et sa capacité à retenir l’eau et les éléments nutritifs, ce qui favorise la croissance des plantes et la biodiversité du sol. Le biochar pourrait donc être utilisé pour renforcer la qualité des sols, par exemple dans le cadre de l’agro-écologie, voire de ce que certains appellent l’agriculture régénératrice. Le biochar pourrait permettre de réduire la dépendance aux engrais chimiques. En outre, l’utilisation de déchets agricoles pour produire du biochar permet de valoriser ces déchets et de réduire la pression sur les décharges.
Inconvénients du biochar et controverses
Cependant, le biochar présente également des inconvénients potentiels. D’abord, un coût initial élevé : La production de biochar peut être coûteuse en termes de matériel et d’énergie, ce qui peut limiter son adoption à grande échelle. Ensuite, le biochar pourrait avoir un impact sur les ressources naturelles. La production à grande échelle de biochar pourrait en effet nécessiter des quantités importantes de biomasse, ce qui pourrait avoir un impact sur les ressources naturelles si elle n’est pas gérée de manière durable. Enfin, il y a avec le biochar un risque de pollution. Si le biochar est produit à partir de matières premières contaminées ou s’il est mal appliqué dans le sol, il pourrait entraîner une pollution des sols ou des eaux souterraines.
D’autre part, l’impact positif du biochar est encore controversé dans la littérature scientifique. En effet, les effets du biochar sur les sols et les écosystèmes peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, tels que les conditions environnementales, les types de sols, les méthodes d’application et les types de matières premières utilisées. Cette variabilité rend difficile la généralisation des résultats et conduit parfois à des conclusions contradictoires dans les études scientifiques. Certaines études scientifiques doutent aussi de l’impact du biochar à plus long terme, et notamment en ce qui concerne sa capacité à stocker le carbone : ces avantages pourraient en effet diminuer ou même s’inverser avec le temps en raison de processus de décomposition, de dynamiques microbiennes ou d’autres facteurs. Les sols sont en effet des systèmes complexes avec de nombreuses interactions entre les composants biotiques et abiotiques. Le biochar peut interagir de manière complexe avec ces composants, ce qui rend difficile la prédiction de ses effets à long terme et la compréhension de ses impacts sur les processus écologiques.
Il n’y a donc pas de consensus clair dans la littérature scientifique sur les effets du biochar.