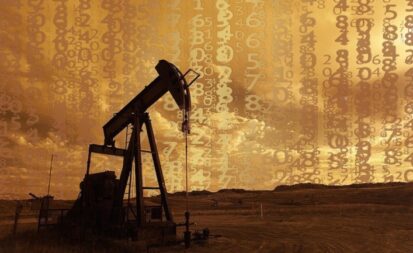L’ampleur de la colère des agriculteurs est colossale. Tout comme l’endettement de cette profession confrontée à tous les problèmes environnementaux et sociaux de l’époque. L’économie agricole est devenue une économie d’endettement après la seconde guerre mondiale. Une étude de 1988 intitulée "Crédit Agricole et agriculture en France au XXème siècle" précise que "dans la valeur ajoutée de la branche, la part de l'endettement est passée de 16 à 145% entre 1935 et 1983. Le Crédit Agricole a accompagné cette évolution, l'accélérant parfois. Il couvre la dette agricole à hauteur de 80% en 1985 contre 40% en 1935". Cette tendance n’a cessé de se renforcer. Selon les résultats publiés par le Crédit Agricole depuis dix ans, le niveau annuel de prêts au secteur agricole dépasse les 7 milliards d’euros. En 2022, il a atteint 9,3 milliards d’euros soit une augmentation de 13% par rapport à 2021 qui concerne plus particulièrement la viticulture et les céréales. Le matériel agricole est bien le premier poste qui augmente surtout en fonction du coût de ces équipements.
Les tracteurs les plus chers et les plus sophistiqués peuvent coûter jusqu’à 600 000 euros avec toutes les options, même les entrées de gamme sont au prix minimum neuf de 40 000 euros. Leur taille a progressé tout comme celle des exploitations. Côté moteur, ils avaient 30 CV en moyenne dans les années 60. Ils peuvent aujourd’hui atteindre les 420 CV et ont une taille toujours plus imposante. Compte tenu du revenu de base des petits agriculteurs qui n’atteint pas les 700 euros par mois, seuls des crédits étalés sur des dizaines d’années peuvent permettre de les acheter.
L’endettement, racine du mal des campagnes françaises
C’est pourquoi les défenseurs de modèles alternatifs agricoles mettent en cause l’endettement comme une des racines du mal profond qui rongent les campagnes françaises, sans que soit mis en place de vrais moyens de limiter cette fuite en avant. Selon le mouvement Solidarité Paysans qui accompagne les agriculteurs en difficultés, l’endettement moyen a été multiplié par trois depuis les années 80 plus particulièrement pour les activités de maraîchage comme d’élevage porcins et de volailles. Pour lui, "si les organisations professionnelles ne parlent pas plus du problème de l’endettement, si l’État ne se mobilise pas c’est parce que la fonction de l’endettement est de placer les agriculteurs sous dépendance de l’agro-industrie et des banques".
L’ONG L214 qui combat l’élevage intensif est du même avis. Elle précise que l’endettement moyen des éleveurs de volaille est de 257 100 euros et que celui des éleveurs de cochons est de 431 400 euros. Dans sa rubrique endettement, elle met et en exergue le témoignage de Guillaume, un éleveur de 48 ans qui déclare : "je suis un esclave moderne, je ne travaille que pour rembourser mes dettes. [...] Je suis une victime de ce système productiviste, qui met sous pression les paysans, les animaux et la terre, et dans lequel nous embarquent et nous emprisonnent les banques, les coopératives... Tout le monde nous pousse à sans cesse nous agrandir, à surinvestir dans du matériel et donc à nous endetter".
Le rôle de la PAC
Ce taux d’endettement, très largement supérieur à ce qui est autorisé en France pour le crédit aux particuliers, est en tous cas un frein aux transformations qui pourraient avoir une influence sur les modes de calcul des capacités de remboursement des agriculteurs. Elles sont indissolublement liées aujourd’hui d’une part aux conditions d’attribution de la Politique agricole commune (PAC), véritable financeur de cette dette et des modèles d’agriculture intensive supposés entraîner une augmentation constante des rendements à l’hectare.
Si l’attribution des subventions de la PAC, répond à de nouvelles normes environnementales, cela modifie un premier paramètre. Le second concerne l’impact du changement climatique et de la dégradation des sols sur la qualité et l’intensité des récoltes. Cela devrait conduire à une refonte complète du système pour y introduire des nouvelles variables plus réalistes et basées sur des scénarios climatiques et agricoles conformes au Green Deal, version initiale. Jusqu’à maintenant les banques basent leurs calculs de probabilité sur l’historique de la productivité d’une exploitation qui fait enchaîner deux bonnes années, deux mauvaises années et une année neutre sur des cycles de cinq ans. Or ce modèle est plus que bousculé par la nouvelle donne climatique, l’épuisement des sols gorgés de pesticides sans compter l’exposition des agriculteurs aux maladies liées à leur usage qui contribuent à diminuer encore le nombre d’exploitants agricoles.
La question de l’aménagement de la dette n’émerge pas encore
Comme l’expliquait le sociologue Jean Viard sur France Info ce week-end, "la France est la seule grande démocratie à avoir bâti sa modernité sur l’agriculture en faisant une agriculture technique à base de tracteurs diesel et de chimie". Cette modernité reposait sur des cultures de plus en plus menacées, à l’image du maïs très gourmand en eau, et de moins en moins adaptées aux périodes de sécheresse. Les financements seront-ils au rendez-vous de ce nouveau pacte que les agriculteurs voudraient signer, à condition de ne pas être ceux qui payeront le prix fort d’une transformation dans laquelle ils ne seraient pas accompagnés à la hauteur de l’effort ? Le Crédit Agricole, acteur historique du financement de l’agriculture française, diversifie de son côté son offre de prêts. A côté "d’investir dans du matériel et des équipements agricoles", il propose aussi de "changer de système de production" et de "diversifier son activité soit vers l’agro tourisme, soit vers les circuits courts".
La question de l’aménagement de l’endettement des agriculteurs et des impacts financiers sur toute la filière, banques comprises, n’émerge pas pour l’instant. Mais si les financeurs de l’agriculture intensive et toujours plus chimique et technique prennent conscience du prix qu’ils devront payer pour l’insoutenabilité climatique, environnementale et économique de l’agriculture européenne telle qu’elle est, cela pourrait changer.■