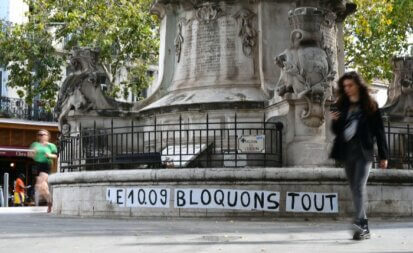Le géant suisse de l’agroalimentaire, Nestlé, tolère-t-il le travail forcé de l’un de ses fournisseurs d’aliments pour animaux thaïlandais, Thai Union Frozen Products PCL ? C’est en tout cas ce que dénonce le cabinet d’avocats américain Hagens Berman qui vient de lancer une class action devant le tribunal fédéral du centre de Californie contre la firme.
"Des acheteurs de produits pour animaux ont porté plainte aujourd’hui [28 août 2015, NDLR] contre Nestlé, accusant le fabricant d’aliments de soutenir en toute connaissance de cause un système d’esclavage et de trafic d’êtres humains pour produire les aliments pour chats de la marque Fancy Feast, tout en cachant sa complicité avec des violations des droits de l’Homme", détaille le cabinet dans un communiqué.
Selon la plainte, "Nestlé importe via un fournisseur thaïlandais, Thai Union Frozen Products PCL, plus de 28 millions de livres (12 000 tonnes) d’aliments pour animaux à base de fruits de mer pour de grandes marques vendues en Amérique, dont une partie est produite dans des conditions d’esclavage". Celles-ci sont détaillées par le cabinet d’avocats, qui dit s’appuyer sur des enquêtes de medias comme The New York Times, et sur ses propres investigations : des Cambodgiens et des Birmans sont vendus à des capitaines de bateaux comme membres d’équipages. Ils doivent y effectuer un travail épuisant jusqu’à 20 heures par jour, avec peu ou pas de salaire, et peuvent être battus voire tués en cas de refus.
Des consommateurs trompés ?
Or, en vertu des lois en vigueur (California Consumer Legal Remedies Act et Unfair Competition Law and False Advertising) en Californie, Nestlé devrait dénoncer les pratiques de son fournisseur, estime le cabinet d’avocats, qui invite les consommateurs des produits de la marque à se rallier à sa plainte.
"En cachant cela au public, Nestlé a effectivement trompé des millions de consommateurs en soutenant et en encourageant le travail d’esclaves sur les prisons flottantes (…). Il est un fait que les milliers d’acheteurs de ses produits (…) n’auraient pas acheté cette marque s’ils avaient su la vérité", a déclaré l’associé gérant de Hagens Berman, Steve Berman. Nestlé a "échoué à assurer sa responsabilité de veiller à l’absence de travail forcé dans ses chaînes d’approvisionnement – et pire encore, Nestlé a non seulement soutenu ces violations des droits humains, mais a contraint les consommateurs à faire la même chose", estime encore le cabinet d’avocats.
Cependant, Nestlé nie toutes ces accusations : "Le travail forcé n’a aucune place dans notre chaîne d’approvisionnement. Le code des fournisseurs de Nestlé, et les lignes directrices du sourcing responsable sur les poissons et fruits de mer, obligent nos fournisseurs à respecter les droits humains et les législations du travail en vigueur", a ainsi affirmé le groupe suisse dans un e-mail à Novethic.
Nestlé nie en bloc
Nestlé précise également travailler avec les parties prenantes aux niveaux mondial et local pour éliminer toute possibilité de travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement. C’est notamment le sens de sa collaboration avec l’OIT (Organisation internationale du travail) sur la définition de lignes directrices dans le secteur, ou avec Achilles, un cabinet de conseil indépendant, avec qui le groupe travaille depuis 12 mois pour "mieux comprendre les strates multiples de la chaînes d’approvisionnement dans l’industrie thaïlandaise des fruits de mer". Mais aussi de son partenariat avec Vérité, une ONG spécialisée dans la lutte contre le travail forcé et le trafic d’êtres humains, a souligné Nestlé.
Selon le groupe, l’ONG a collecté des informations sur les navires de pêche, les usines et les fermes piscicoles de Thaïlande et des ports d’Asie du Sud-Est, afin d’identifier les lieux de travail forcé et des violations des droits de l’Homme. Ses conclusions, ainsi qu’un plan d’action, seront publiées durant le quatrième trimestre, précise Nestlé.
La pêche thaïlandaise connue pour le travail forcé
Le problème réside dans le fait que la Thaïlande est connue depuis des années pour le travail forcé qui a cours dans certaines de ses pêcheries. Depuis des années, l’OIT et l’ONU dénoncent de "graves abus " à bord des bateaux de pêche de la région.
Et plusieurs ONG (voir le rapport d’Environmental Justice foundation et ses suites) ainsi que de nombreux medias (lire dans The New York Times ou The Guardian) publient régulièrement des enquêtes et reportages sur les conditions de travail qui ont cours dans ce secteur. Selon les propres chiffres de 2014 du gouvernement thaïlandais, près de 300 000 esclaves travaillent dans l’industrie de la pêche.
L’an dernier, un reportage du Guardian avait déjà fait grand bruit sur le sujet. Les auteurs, qui avaient enquêté 6 mois sur place, révélaient que l’un des fournisseurs de crevettes (Charoen Pokphand Foods) de grands distributeurs occidentaux (Tesco, Walmart…) achetait de la nourriture pour ses élevages à des fournisseurs impliqués dans un vaste réseau d’esclavage de migrants venus de Birmanie ou du Cambodge.
Après les révélations du Guardian, certains distributeurs comme Carrefour avaient alors suspendu toute relation commerciale avec l’entreprise.
Depuis, le gouvernement issu du coup d’État militaire du 22 mai 2014, affirme mettre en œuvre tous les moyens contre le trafic d’êtres humains dans ce secteur. Mais ceux-ci restent sous-dimensionnés et atténués par la corruption endémique qui ronge le pays, soulignent plusieurs associations de droits de l’Homme dans un rapport publié en février 2015. La Thaïlande est aujourd’hui rangée dans le plus bas niveau du classement du traitement des travailleurs par pays établi par le département d’État des États–Unis (Traffincking in Persons reports).
Cette action collective remet aussi au goût du jour la question du niveau de responsabilité des donneurs d’ordres sur leur chaîne d’approvisionnement. L’an dernier, une proposition de loi française sur le devoir de vigilance avait été adoptée par l’Assemblée nationale après de multiples rebondissements. Mais elle n’a pas eu de suite : sa date d’examen par le Sénat n’est toujours pas connue et son principe est vivement critiqué par les organisations patronales.
Mais au niveau international (Convention sur le travail forcé de l’OIT) ou dans certains pays comme les États-Unis (une loi contre le trafic des personnes en Californie a été adoptée en 2012, et proposée au niveau fédéral en juillet 2015) ou l’Angleterre (loi contre l’esclavage moderne), de nouvelles lois créent déjà un risque juridique très concret pour les entreprises qui ne prendraient pas suffisamment de mesures visant à prévenir ce type de violations des droits humains. Tant et si bien que des investisseurs demandent déjà des comptes aux entreprises dont ils sont actionnaires sur ces sujets.