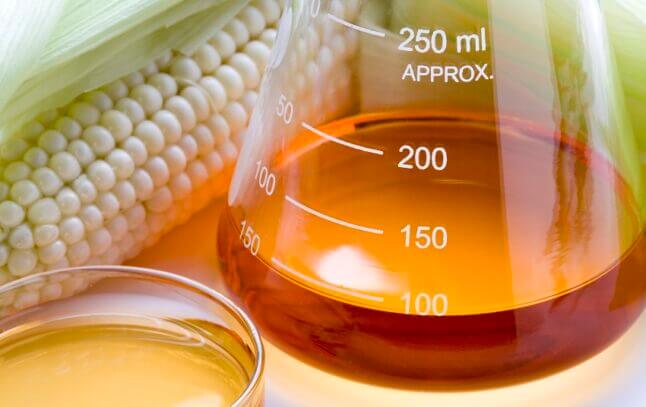Les agrocarburants de première génération n’ont plus la cote. Depuis plusieurs années, des Nations-Unies à l'OCDE, en passant par l’Ademe, les cris d’alarme se multiplient pour dénoncer leurs effets négatifs : déforestation accélérée, hausse du prix des denrées alimentaires, bilan d’émissions de gaz à effet de serre décevant.
Ces carburants d’origine végétale, qui devaient nous permettre de rouler plus propre, apparaissent au final très chers, avec un bénéfice environnemental douteux.
Forte attractivité et manque d'alternatives aux combustibles fossiles
Mais jusqu’ici, l’Union européenne a fermé les yeux. Malgré les premières mises en garde lancées par les ONG et certains scientifiques, elle s’est fixé en 2009 un objectif contraignant : atteindre 10% d’énergie renouvelable dans les transports d’ici 2020.
Dans l'esprit des dirigeants européens, ce pourcentage vise essentiellement les agrocarburants de "première génération", c’est-à-dire produits à partir de cultures agricoles (colza, maïs, tournesol, palme, canne à sucre...). Hormis la voiture électrique qui reste marginale, c’est la seule alternative sur le marché aux combustibles fossiles d’ici 2020.
"On a alerté autant qu’on pouvait les gouvernements européens et les eurodéputés sur les effets dévastateurs des agrocarburants. Mais l’attraction était trop grande", se souvient Robbie Blake, de l’ONG les Amis de la Terre. "Pour les responsables politiques européens, les agrocarburants apparaissaient comme la solution rêvée : pas besoin de changer de technologie ou d’infrastructures, pas besoin de modifier les comportements des gens. Il suffisait de mélanger la mixture végétale à l’essence ou au gazole pour soi-disant moins polluer", précise-t-il.
Tout miser sur les agrocarburants : une erreur difficile à réparer
Pour distinguer les "bons" et les "mauvais" agrocarburants, les Européens ont définis des critères de durabilité, notamment des gains en termes de gaz à effet de serre au minimum de 35 % en 2010, puis de 50 % en 2017. Mais ils ont fait l’impasse sur ce que l’on appelle le "changement d’affectation des sols indirects" (CASI). Une manière de mesurer l’effet de la déforestation engendrée par les cultures destinées aux agrocarburants et la perte d’écosystèmes (forêts, prairies, tourbières) en captant le dioxyde de carbone qui en résulte. Complexe à calculer, le facteur CASI, s’il était intégré, ferait basculer le bilan carbone de nombreux agrocarburants.
"C’était une erreur de miser autant dans les agrocarburants", reconnaît un diplomate. Les dirigeants européens sont désormais convaincus qu’il faut les consommer avec modération. Mais politiquement, il est difficile de faire marche arrière du jour au lendemain sans déstabiliser la filière. Surtout quand elle a été créée de toute pièce par des politiques publiques de soutien.
Après trois ans et demi de négociations et un lobbying intense des industriels, une réforme européenne est toutefois sur le point d’aboutir. Les eurodéputés et les États membres discutent encore des détails du compromis mais sur les deux mesures phares, l’affaire est entendue.
Plafonnement des GES et publication des données, une réforme à double tranchant
La réforme législative va introduire un plafond de 7% pour la première génération et une obligation de "reporting" pour la filière. Les industriels du secteur seront désormais tenus de publier des données sur les émissions de gaz à effet de serre liées au changement d’affectation des sols indirects. Cependant, il n’en sera tiré aucune conséquence concrète. Les eurodéputés étaient prêts à aller plus loin, mais pas les État membres.
Est-ce la fin des agrocarburants de première génération ? "Le signal est clair, mais la réforme est trop timide", estime Robbie Blake. "Avec un plafond de 7%, la consommation d’agrocarburants va continuer d’augmenter", ajoute-t-il. Aujourd’hui, la part des agrocarburants est de 4,5% au niveau européen. "Les agrocarburants sont nocifs, il faut régler le problème maintenant au lieu de prendre des demi-mesures", regrette l’eurodéputé vert Bas Eickhout.
Autre lacune, la réforme ne s’attaque pas aux subventions dont bénéficient les agrocarburants. Elles s’élevaient à plus de 5,5 milliards d’euros en 2011, selon l’institut international du développement durable.
Il n’en reste pas moins que pour le secteur, c’est un coup dur. Les investissements, qui stagnent depuis quelques années, pourraient ne jamais repartir. Rendre publiques les données sur le CASI, c’est "entrouvrir une porte qui est extrêmement dangereuse", assure une source proche des industriels. Particulièrement en ce qui concerne le biodiesel, pour lequel le facteur CASI alourdit considérablement les émissions de CO2. La filière française, qui est l’une des plus importantes en Europe, est particulièrement inquiète. Certains prédisent déjà "sa mort pure et simple".
Actualisation: le 28 avril 2015, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la limitation des agrocarburants à 7% maximum de la consommation d'énergie du secteur des transports en 2020. Ce vote, en deuxième lecture, permet donc d'adopter définitivement la proposition de directive sur les biocarburants modifiant les directives relatives à la qualité des carburants et aux énergies renouvelables du paquet énergie-climat 2020 de 2009.