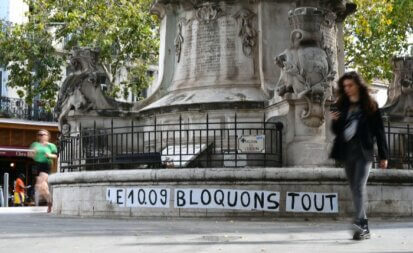En imposant brutalement ses nouvelles politiques de droits de douane au monde, Donald Trump illustre à l’extrême l’émergence d’une nouvelle façon de faire de la politique : le deal. Rapport de force, tractations, bluff, coups de pression… Donald Trump utilise les méthodes de gestion issues du monde du business pour mener à bien sa feuille de route. Avec Elon Musk, Javier Milei et bien d’autres, il incarne en quelque sorte l’importation des codes du secteur privé dans la sphère publique. Gérer la société comme on gère une société privée ? C’est l’idée de ces nouvelles figures dont le vocabulaire est colonisé par les termes issus du management : efficacité, autorité, optimisation…
Le phénomène n’est pas nouveau, puisqu’il est identifié par les chercheurs en sciences sociales depuis plusieurs décennies. Mais il trouve aujourd’hui son expression paradigmatique dans la bouche de ces nouveaux leaders, qui entendent sortir la tronçonneuse pour gérer les services publics, et se servent des tableaux Excel comme boussole politique. “L’idée que les dirigeants publics doivent s’inspirer de la gestion des entreprises remonte au moins aux années 1970, quand les chocs pétroliers ont commencé à affaiblir les ressources des Etats, et que le personnel politique s’est dit qu’il allait falloir optimiser la gestion de ces ressources”, explique à Novethic Ibrahima Fall, docteur en sciences de gestion, président du cabinet Hommes et Décisions et de l’Institut du Travail Réel.
Un emballement de tendances managériales
Avec en filigrane l’idée d’une action publique plus optimale, les gestionnaires publics commencent alors à s’inspirer des modes de gestion du secteur privé, réputés plus efficaces. Parallèlement, le management, lui, se professionnalise et affine ses méthodes. Les cabinets de consultants qui se développent massivement après la seconde guerre mondiale vont tenter de vendre leur savoir-faire à un personnel politique en demande d’efficacité. “Le business du management consiste à mettre sur le marché des méthodes, des progiciels, des bonnes pratiques et, comme tout business, il a eu besoin de renouveler en permanence son marché”, explique à Novethic Marie-Anne Dujarier, sociologue du travail managérial et professeure à l’Université Paris Cité. La chercheuse décrit ainsi la succession et l’emballement des tendances managériales, en particulier depuis les années 70, et leur “importation” dans la sphère publique. “En général, ces méthodes émergent dans l’industrie, puis sont vendues dans le secteur des services, avant de finir dans la fonction publique”, ajoute-t-elle. Progressivement, les théories du management imprègnent le monde politique : réforme, optimisation, process, monitoring, reporting…
Les managers inventent ainsi successivement le néo-taylorisme, les méthodes qualité, puis le lean management, les méthodes agiles, etc. “Chaque méthode managériale vise en théorie à corriger les imperfections des précédentes”, explique Marie-Anne Dujarier. Et chacune finira par s’imposer, plus ou moins, dans la sphère publique et dans l’ensemble de la société. “On voit aujourd’hui émerger dans le monde universitaire des powerpoints avec les mêmes éléments de langage que dans le management industriel des années 1990”, commente la chercheuse. Les années 1980 voient même l’émergence de ce que l’on appelle le “new public management” (nouveau management public) visant à augmenter l’efficacité de l’action publique, grâce à des méthodes empruntées au secteur privé, et notamment des mécanismes de marché. Des méthodes poussées par les cabinets de conseil, avec qui les Etats travaillent de plus en plus étroitement.
L’hégémonie de la gestion
“C’est un phénomène structurel, lié au développement du capitalisme néo-libéral financiarisé”, analyse Thomas Coutrot, chercheur associé à l’Institut de recherche économique et sociale (Ires). “Dans l’entreprise comme dans la sphère publique, sous la pression des marchés financiers, on a vu apparaître une généralisation du management par les chiffres, les process, le reporting”, explique le chercheur. Marie-Anne Dujarier parle ainsi d’une “hégémonie de la “gestion”. “On gère son couple, son stress, ses vacances, son régime, ses enfants… “Gérer” devient le mot à tout faire de notre société”, lance-t-elle. Les hommes et femmes politiques deviennent alors eux-aussi des “gestionnaires”, qui doivent gérer la dette, gérer la croissance, gérer l’emploi. “Les mondes privés et financiers ont imposé leur logique au corps social, notamment par leur omniprésence médiatique : on répète matin, midi et soir que l’Etat doit gérer un budget en bon père de famille, qu’il doit tout optimiser, ne doit pas s’endetter, etc.”, analyse Thomas Courtot.
La logique est devenue si omniprésente que des figures gestionnaires issues du monde des affaires commencent même à s’imposer, à l’aube des années 2000, lors des échéances électorales. Silvio Berlusconi, promoteur immobilier, devient ainsi l’un des premiers symboles de ce mouvement, en devenant président du Conseil des ministres italien à la fin des années 1990. Puis c’est au tour, en France, de Nicolas Sarkozy, avocat d’affaires proche des milieux business, devenu Président en 2007, tandis qu’au Chili, c’est le milliardaire et businessman Sebastian Pinera qui remporte l’élection présidentielle en 2010. “Aujourd’hui, nous avons Donald Trump, Elon Musk, Javier Milei, Emmanuel Macron, tous issus du monde des affaires, cela devient habituel dans les sociétés démocratiques”, commente Marie-Anne Dujarier. Preuve de ce basculement, “sept Français sur 10 accueillent favorablement l’idée qu’un entrepreneur soit candidat à l’élection présidentielle”, selon un sondage Harris Interactive publié en février. Objectif : toujours plus d’efficacité, d’optimisation, de performance, selon les sondés.
Une violence croissante du management en politique
Or, cette recherche d’efficacité comporte bien souvent sa part de violence. “Le jargon du management s’est véritablement imposé dans la manière de formaliser des politiques publiques, et cela devient si omniprésent que l’on peut désormais tout faire sous l’égide de l’efficacité”, analyse Ibrahima Fall. Preuve en sont les actions brutales mises en place par Elon Musk au nom de son Doge, Département de l’efficacité gouvernementale. Licenciements massifs, coupes budgétaires, censure sémantique deviennent alors des manières acceptables de gérer les politiques publiques. “Ce sont des méthodes qui s’appliquent en réalité depuis des décennies dans l’industrie et dans le monde de l’entreprise”, analyse Thomas Courtot, qui rappelle notamment le cas des procès France Telecom. Elles s’appliquent désormais un peu partout : à l’hôpital, dans l’enseignement, dans la santé ou encore dans la recherche, et pas seulement aux Etats-Unis. En France, Christelle Morançais, ex-businesswoman de l’immobilier désormais présidente du Conseil régional des Pays de Loire en est un exemple. Celle qui est surnommée la Javier Milei française assume ainsi de mener des coupes budgétaires massives et de provoquer une casse sociale majeure dans le secteur de la culture de la région. Pour Ibrahima Fall, “ce management est violent car il fait fi de la complexité du corps social, des relations humaines, du travail, il déshumanise. Il est aussi violent car il sacrifie le long terme au nom du court terme”.
Au nom de l’efficacité, cette violence semble toutefois avoir changé de degré : alors qu’elle s’exprimait de manière plus ou moins larvée dans le monde de l’entreprise, où les logiques de compétition, de guerre, et de coercition sont largement internalisées, elle est aujourd’hui de plus en plus visible. “On passe d’une violence structurelle, masquée, à une violence qui s’exprime plus librement et ouvertement. Il y a Donald Trump et Elon Musk bien sûr, mais toute une génération de figures nouvelles, des patrons comme Vincent Bolloré, Carlos Tavares, ou Bernard Arnault, dont l’expression autoritaire est de plus en plus débridée”, explique Thomas Coutrot. Qu’ils blacklistent certains médias comme Bernard Arnault, ou appliquent des méthodes de management brutales comme Carlos Tavares, ces nouvelles figures assument désormais publiquement leurs positions dures, au nom de la performance. Tout comme les dirigeants politiques de plus en plus autoritaires, qui assument l’austérité, les coupes budgétaires et la dérégulation, avec un vocabulaire de plus en plus dur, de la tronçonneuse au coup de rabot… Toujours au nom de la performance.