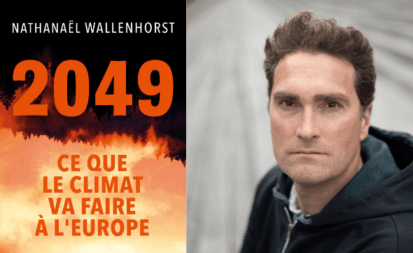Le principe de précaution est un concept juridique et éthique qui vise à prévenir les risques pour l’environnement ou la santé, même en l’absence de certitude scientifique sur leur gravité ou leur probabilité. Le principe de précaution est ancré dans plusieurs textes importants.
Définition et fondements du principe de précaution
Le principe de précaution est une disposition consacrée lors du sommet de Rio de 1992. Rapidement, il fut inscrit dans le droit français par la loi Barnier du 2 février 1995. Le principe de précaution est élevé au rang constitutionnel en 2004.
Le principe de précaution repose sur l’idée que l’absence de certitudes en raison du manque de connaissances techniques et scientifiques à un moment donné doit toutefois conduire à prendre des mesures de gestion de risques appropriées à l’égard de potentiels dommages à l’environnement et sur la santé. Il est question de risques incertains mais suffisamment plausibles pour les anticiper. En cas de problème, le principe doit permettre, à l’autre bout de la chaîne de l’action, d’opérer une résilience effective tant sur le plan sanitaire qu’environnemental. Plusieurs affaires et questions ont favorisé son déploiement : les OGM, le bisphénol A, le sang contaminé ou encore la « vache folle ».
L’objectif du principe de précaution est de protéger les générations présentes et futures en adoptant une approche dite préventive face à des menaces potentielles. Le principe de précaution peut être mis en contraste avec le principe de prévention par exemple, lequel repose sur la gestion d’un risque déjà identifié et scientifiquement prouvé.
Applications du principe de précaution
Le principe de précaution s’applique à divers domaines :
- La santé publique : débat autour de certaines substances chimiques, médicaments ou aliments.
- L’environnement : risques liés au changement climatique, à la dégradation de la biodiversité.
- La technologie : débat autour des OGM, des nanotechnologies ou de l’IA et des impacts à long terme.
La loi Barnier et le principe de précaution
Le principe de précaution a été introduit dans le droit français par la loi Barnier en 1995, étape clé dans l’intégration du principe dans la législation. La loi porte le nom de Michel Barnier, alors ministre de l’environnement, qui luttait pour la protection de l’environnement face aux incertitudes scientifiques.
Le principe de précaution est alors introduit comme principe général du droit de l’environnement à l’article L.110-1 du Code de l’environnement. La loi Barnier est un pilier juridique aujourd’hui.
Qu’est ce que le principe de précaution selon la Charte de l’environnement ?
En 2004, le principe de précaution est inscrit dans la Charte de l’environnement, ayant valeur constitutionnelle. En son article 5, la Charte de l’environnement a étendu la responsabilité de la mise en œuvre de ce principe, qui ne concerne désormais plus seulement l’administration mais également le législateur : “Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.”
Le Conseil constitutionnel a de ce fait rappelé que le principe de précaution dépasse la simple jurisprudence et se hisse au niveau constitutionnel.
Débats autour du principe de précaution
Malgré son implémentation, le principe de précaution suscite toujours des débats voire des oppositions.
Le principe de précaution empêcherait l’innovation et aurait par exemple, s’il avait été appliqué plus tôt, empêché la fabrication des vaccins ; il limiterait la liberté des individus et des entreprises ; il porterait atteinte aux échanges internationaux ; etc.
À ce titre, la notion de « principe d’innovation », dénuée de base juridique malgré son nom, tente depuis peu de contourner le principe de précaution. Émanant de groupes de pression industriels, il demande que « chaque fois que des décisions politiques ou réglementaires sont à l’étude, l’impact sur l’innovation devrait être évalué et pris en compte » et est actuellement inscrit dans la proposition de règlement Horizon Europe 2021-2027, l’un des programmes cadres de l’Union Européenne.