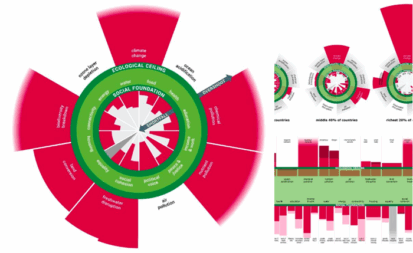On parle souvent d'une crise dans le monde du travail, de la hausse du mal-être et de l'épuisement des salariés, d'une perte de sens. Le management n'est-il pas responsable de cette situation ?
Brigitte Nivet : Le sujet est vaste, mais le management a évidemment une grande part de responsabilité dans ce que l'on appelle la crise du travail. Cela fait 30 ans que je travaille sur la question du management que j'observe les entreprises et leurs modes de management. Ce que je constate c'est qu'il y a une véritable déconnexion entre les managers et le travail réel, et cela crée inévitablement un malaise dans le travail. On voit que les managers ont tendance à penser le travail uniquement en termes d'objectifs à atteindre, de procédures, de contrôles des résultats, de reporting visant à répondre aux objectifs financiers. On a développé dans les entreprises une vision mécaniste et simpliste du management des travailleurs, où l'on cherche le plus possible à encadrer et surveiller le travail, pour éviter les aléas, maîtriser les risques et l'incertitude.
Mais cette vision du travail ignore ce que les sciences du travail appellent le "travail vivant", c'est-à-dire le travail du quotidien, et sa dimension humaine. En réalité, le travail est fait d'imprévus, d'interactions sociales, de subjectivité ; les travailleurs coopèrent, improvisent, réagissent, pensent, ressentent. Tout ça, les managers voudraient le réguler d'en haut, sans l'accepter et le prendre en compte. De ce fait, ils oublient que ce sont les travailleurs qui sont confrontés aux réalités du travail, sur le terrain, et qu'ils sont donc la meilleure ressource pour comprendre le travail, pour éclairer les conditions de la production. Le mal-être survient lorsque la volonté de contrôle du management est en décalage avec la subjectivité des travailleurs, avec l'expérience vécue, quand le management impose une procédure qui n'est pas adaptée aux réalités quotidiennes, un outil pas approprié aux besoins ou des objectifs irréalistes.
Or depuis les années 1980, la financiarisation des entreprises et de l’économie a accentué cette déconnexion entre le management et l’activité réelle du travail en situation. Les méthodes de management inspirées du taylorisme ont encombré les salariés avec des prescriptions, des normes émanant de grands cabinets de conseil et visant à maximiser la performance, à accélérer le travail. Le lean management quant à lui se voulait une alternative au taylorisme, mais il en a repris les caractéristiques avec la rationalisation et standardisation des procédures. Progressivement, les gens se sentent donc de plus en plus méprisés, car ils ne sont pas consultés lorsqu'il faut mettre en place de nouvelles régulations et ajustements. L'omniprésence du numérique contribue également à fragmenter encore le travail, en ajoutant de nouvelles contraintes, de nouvelles procédures, de nouvelles surveillances. Ces modes de management ont paradoxalement rendu les salariés dépendants, tout en appauvrissant leur travail et en évacuant complètement leur subjectivité.
Est-ce un problème lié à la formation des managers ?
B.N : En partie oui. Historiquement, on a formé les managers de façon élitiste, déconnectée du réel. On a beaucoup entretenu le mythe du chef d'entreprise héroïque, du manager messianique, avec cette idée que les dirigeants doivent, du fait de leur statut, être porteurs d'une forme de vérité, prescrire, imposer des méthodes, une vision. On a donc installé une dualité entre le travailleur et les managers et dirigeants : il y a ceux qui prescrivent et ceux qui exécutent. Or cette vision nie le fait que les organisations du travail se créent collectivement, dans l'interaction et avec une vision processuelle.
Si l'on veut que la relation entre les managers et les salariés progresse, il faudrait former les managers en se fondant sur les sciences humaines (sociologie, philosophie, psychologie, ergonomie...) pour penser le travail réel et construire la pratique managériale sur des cas concrets. Cela peut paraître abstrait, mais il s'agit de comprendre que le travail c'est des ajustements permanents, faire face à des choses qui sont imprescriptibles. Il faut donc développer l'intelligence des situations plutôt que de croire dans l'existence de "bonnes pratiques" universelles. Cela implique aussi de faire confiance à l'intelligence des équipes pour se réguler, trouver des solutions, expérimenter, et reconnaître qu'ils sont une richesse de l'organisation. Il s'agit aussi d'enseigner une forme d'humilité aux managers, car une grande partie de la réalité d'une entreprise échappe complètement aux dirigeants et ne se trouve pas dans des algorithmes ou des tableaux Excel. En fait, les managers devraient passer du contrôle au débat et à l'écoute, accepter la contradiction, accepter que parfois, les travailleurs savent mieux que personne comment gérer le travail.
D'une manière générale, le manager ne doit plus seulement être au service de la productivité, des résultats, des investisseurs, mais surtout au service des équipes. D'ailleurs, les travailleurs sont aussi des investisseurs, des "investisseurs en compétences" dont les conditions de réalisation de leur travail et sa reconnaissance dépendent en grande partie du travail des managers.
De plus en plus d'entreprises parlent pourtant de ces nouveaux modes de management, plus humains, basés sur l'autonomie, la confiance. Pourquoi n'arrivent-elles pas à transformer vraiment le management ?
B.N : Pour les entreprises, l'enjeu devient de plus en plus important. On voit évidemment que les salariés aujourd'hui, notamment les jeunes, ne veulent plus être "gouvernés" comme cela. Ils ont envie de participer à la vie de l'entreprise, que leur singularité soit reconnue et valorisée. Cette tension crée énormément de turn-over et de défiance. Forcément, cela amène les entreprises à réfléchir. Avec la pandémie de Covid, beaucoup ont entamé des efforts. Il y a eu un certain nombre de discussions engagées avec les partenaires sociaux sur ces sujets, pour repenser le contenu du travail.
Mais on est encore loin du compte. D'abord, dès la fin des confinements, on est très vite retombés dans les anciens réflexes : prescrire, ignorer le contenu du travail, contrôler, accélérer, intensifier le travail. Surtout, trop d'entreprises semblent encore croire que la réponse à cette crise du travail se trouve dans des gadgets tels que des tables de ping-pong, des séances de massages ou de sophrologie. Des réponses faciles, qui ne coûtent pas grand-chose et évitent de repenser les conditions de travail. Or, l'enjeu, c'est justement de donner des conditions de travail dignes de ce nom, de créer une organisation du travail ergonomique, adaptée, avec pour chacun des capacités à agir. Par exemple, on parle beaucoup de management par la confiance, par l'autonomie, mais il s'agit souvent d'injonctions : "soyez autonomes" disent les managers. L'autonomie, ça ne se décrète pas ! Il faut que l'organisation donne aux travailleurs les moyens et les ressources pour bien faire leur travail, et soit à l'écoute de leurs besoins. Or aujourd'hui, les entreprises écoutent plutôt les consultants, les certificateurs, qui imposent des normes de l'extérieur.
Surtout, même si les entreprises parlent de management humain, agile, participatif, elles ont en réalité du mal à remettre en cause certaines structures dysfonctionnelles dans leur organisation du travail. On continue avec le mythe de la performance, du dépassement de soi. Il y a même une psychologisation à outrance des relations de travail, avec, sous couvert de bienveillance, une véritable injonction à trouver le bonheur au travail. Et si on ne le trouve pas, la responsabilité pèse sur le salarié et non pas à l’entreprise ! On continue aussi à mettre les individus en compétition dans l'organisation, au service de la productivité. Or, on sait que la seule ressource qui nous permettra de sortir par le haut des crises contemporaines, c'est la coopération et l’entraide, pouvoir parler de son travail et débattre de ses conditions… La démocratie au travail en quelque sorte.
Concrètement, que peuvent mettre en place les entreprises pour avancer dans la bonne direction ?
B.N : Encore une fois, il faut savoir écouter les salariés. Dans une entreprise, les travailleurs qui partent, les personnes en burn-out, les gens qui craquent sont des lanceurs d'alerte, qui révèlent que le système est malade et dysfonctionne. Il faut faire attention à ces signes, écouter et comprendre ce que ressentent les travailleurs. On peut imaginer créer des pôles d'enquête, pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, des comités avec les travailleurs, pour explorer de nouvelles manières de faire. Pour cela, évidemment, il est important de mobiliser davantage les représentants des salariés, les CSE, les délégués syndicaux, afin qu'ils fassent remonter la parole des salariés. En d'autres termes, il faut revaloriser le dialogue social.
Cela implique aussi de revoir les équilibres en termes de reconnaissance et de rémunération. Les écarts de rémunération dans l'entreprise entretiennent le mythe des dirigeants qui réussissent seuls grâce à leur talent et cela renforce la défiance des travailleurs. C'est un mythe qu'il faut entièrement reconstruire, et pour cela il faut s'attaquer à la justice des rémunérations. Dans les très grandes entreprises, la proposition de limiter l'écart des rémunérations à 1 à 20 serait déjà un début. On en est loin.
Enfin, il faut avoir en tête que la transition écologique et sociale va mettre à l'épreuve nos modes de travail. Beaucoup de choses sont amenées à changer dans les prochaines années, et il va falloir les anticiper collectivement. C'est l'occasion pour les entreprises de donner de la capacité d'agir à leurs travailleurs, d'écouter leurs voix, pour faire émerger des organisations résilientes à même de surmonter les enjeux de demain.
Propos recueillis par Clément Fournier.