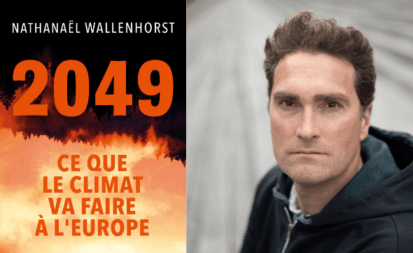C’est un texte perfectible mais de l’avis des ONG environnementales, il s’agit d’un “premier pas historique”. Jeudi 14 mars, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité des mesures visant à “réduire l’impact environnemental de l’industrie textile”.
🙌🙌Vote historique contre la fast-fashion : la loi vient d’être adoptée à l’unanimité.
Notre réaction à venir avec les assos de la coalition #StopFastFashion 👇 pic.twitter.com/eII5RF4o2h
— Les Amis de la Terre FR (@amisdelaterre) March 14, 2024
Première question et pas des moindres : quelles sont les enseignes concernées ? L’article 1 du texte de loi définit la fast-fashion par un “nombre de modèles de produits neufs”, qui sera fixé plus tard par décret. Autrement dit, le seuil reste à fixer mais c’est donc le nombre de modèles et non de produits mis sur le marché par jour qui définit selon cette loi une marque de fast-fashion. Or cet argument pourrait permettre aux enseignes historiques de la fast-fashion comme Zara, H&M ou Primark de passer entre les mailles du filet.
Selon les estimations de Pierre Condamine, chargé de campagne surproduction aux Amis de la Terre France, qui reste prudent tant l’accès aux données est compliqué, Zara mettrait 500 nouveaux modèles par semaine sur le marché contre 7 200 par jour pour le géant Shein. Cela signifie-t-il que Shein produit plus de vêtements que Zara ? “Non, cela dépend du nombre de vêtements fabriqués par modèle”, explique Pierre Condamine. Un argument que la plateforme Shein a maintes fois répété, estimant que le nombre de références “n’est pas un indicateur pertinent” pour définir la “fast fashion”, plutôt liée selon la marque à l’ampleur des invendus.
“Pas une taxe”
Sur le fond, la mesure principale est le renforcement du système de “bonus-malus” dans le secteur textile, pour tenir compte des “coûts environnementaux” d’une production excessive. La pénalité serait liée à l’affichage environnemental des produits qui est en cours de finalisation par l’Agence de la transition écologique (Ademe). Or cette nouvelle méthode de notation des produits est très satisfaisante, selon Pierre Condamine.
Son montant, à fixer par décret, pourrait atteindre progressivement jusqu’à 10 euros par produit en 2030, avec un plafond de 50% du prix de vente. Un amendement a prévu des paliers pour atteindre ces 10 euros, notamment un premier à 5 euros en 2025. “Il ne s’agit pas d’une taxe”, a insisté la députée Anne-Cécile Violland, qui a porté la loi, les contributions devant être redistribuées en faveur des producteurs de vêtements durables, dans l’objectif que leurs prix baissent.
Interdiction de la publicité
L’autre mesure phare est l’“interdiction de la publicité pour les produits et entreprises” relevant de la définition de la “fast fashion”, coutumières d’un marketing agressif. Shein par exemple, est une star en la matière. En 2023, elle a été la marque la plus promue sur le réseau social TikTok. Le géant s’est beaucoup appuyé sur les “haul”, ces vidéos dans lesquelles des influenceurs se filment en train de déballer leurs achats. Une pratique qui a déjà été limitée par la loi sur les influenceurs de 2023 visant à encadrer les pratiques du métier.
Reste que la loi ne vise que les impacts environnementaux de la fast-fashion. Un manque pour Catherine Dauriac, présidente de l’association Fashion Revolution France qui milite pour l’adoption d’un “affichage social”. Hasard du calendrier, le devoir de vigilance européen, qui vise à prévenir les risques humains et environnementaux sur l’ensemble des chaines de valeur des entreprises, pourrait être adopté dans les jours qui viennent. Et contrairement à la loi française, il concernerait tout autant les impacts environnementaux que les droits des millions de travailleurs de l’industrie de la mode.