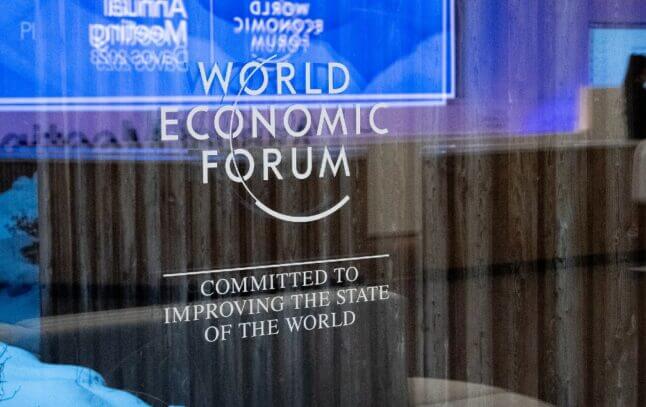"La crise énergétique, et plus important encore, la réponse structurelle que vont lui apporter les pays qui tentent d’allier économie, sécurité, et climat sera LE thème de nos débats, de l’année et sans doute de la décennie", explique Alessandro Blasi, conseiller spécial du Directeur de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui participe pour la dixième fois au Forum de Davos. Vu de l’intérieur, le Forum semble effectivement mobilisé sur les grandes crises de l’époque à travers des débats sur l’accélération de la transition verte, le plastique et la nature, l’Ukraine ou l’agriculture et l’alimentation. Vu de l’extérieur, en revanche, c’est un monde déconnecté qui se réunit à Davos où le changement climatique et la répartition des richesses restent des sujets de conversation, pas d’action.
Oxfam a profité de l’ouverture du Forum pour publier son étude annuelle sur la répartition des richesses dans le monde et rappeler que, de son point de vue, la meilleure solution pour financer la lutte contre la précarité des plus pauvres est d’établir un barème de taxation de solidarité des plus riches. Sur le plan environnemental, ce n’est pas mieux puisque le principal mode de transport à Davos reste le jet privé. Et là, c’est Greenpeace qui monte au créneau. L’ONG a publié une étude sur les plans de vols de l’édition 2022. Elle estime que le Forum de Davos génère le vol de plus de 1000 jets privés dont l’un n’a fait un parcours que de 21 km. Cela représente 7400 tonnes de CO2, soit près de 800 ans d’empreinte carbone d’un Français ! Du coup, des activistes ont occupé les pistes.
Difficulté à repenser les business models
Cette absence de remise en cause de leurs propres modes de déplacement est un signal parmi d’autres de la difficulté des dirigeants du monde à repenser leur business model, comme leurs modes de vie, pour faire face à la montée des risques environnementaux et sociaux que le Forum chronique depuis 17 ans à travers son étude annuelle de perception des risques. Cette année les personnes interrogées disent redouter que la crise sociale aggravée par l’inflation puisse remettre en question la montée en puissance de préoccupations de plus long terme.
Encore faudrait-il faire face aux enjeux de court terme. Le Directeur du Programme alimentaire de l’ONU, David Beasley, est à Davos pour appeler les participants à financer la lutte contre la faim dans le monde "pour que l’enfer ne règne pas sur terre". Il rappelle que "l’Ukraine et le réchauffement climatique aggravent encore une situation déjà dégradée et 50 millions de personnes sont exposées au risque de mourir de faim dans le monde". Pas sûr que le programme proposé par Walmart, l’une des entreprises engagées dans le programme sur l’amélioration du système alimentaire mondial, réponde à cet objectif. Kathleen McLaughlin, chief sustainability officer du distributeur américain et présidente de sa fondation, explique sur fond d’un étal de marché indien que "Walmart s’est donné comme priorités l’accès à une nourriture abordable et équilibrée, la décarbonisation de la distribution et la production de sa chaîne de sous-traitance, protéger, restaurer et mieux gérer les écosystèmes naturels, réduire le gâchis alimentaire et les déchets d’emballage et améliorer les conditions de vie des agriculteurs qui produisent l’alimentation que nous aimons".
La crédibilité du baromètre sur la confiance dans les institutions attaquée
Longtemps le Forum de Davos a été considéré comme l’endroit où se dessinaient les tendances porteuses de l’économie, puisque ceux qui la pilotent y partagent leur vision du monde. Une pratique résumée ainsi par un fidèle de Davos, Jamie Dimon qui dirige la banque américaine JP Morgan : "Davos est l’endroit où des milliardaires expliquent à des millionnaires ce que les classes moyennes ressentent".
L’idée d’un soutien massif à la stratégie économique selon Davos est nourrie par le baromètre sur la confiance dans les institutions qu’y publie chaque année la firme de relations publiques Edelman. L’édition 2023 explique que, dans un monde polarisé et en pleine crise, les entreprises restent l’institution en qui les 32 000 personnes interrogées dans 28 pays ont le plus confiance, devant les ONG et les États. Selon Edelman, c’est parce qu’elles sont "éthiques, compétentes et qu’elles ont eu une bonne conduite pendant la pandémie, la crise russe et sur l’ESG”. À peine publiée, l’étude était attaquée de toute part. Ses détracteurs s’interrogent sur la crédibilité d’une étude sur la confiance réalisée par une spécialiste de l’instillation du doute scientifique sur les conséquences climatiques de l’activité pétrolière.
Comme dit Paul Polman, chantre de la Net Positive Economy et ancien dirigeant d’Unilever, invité à Davos pour parler de la refonte du système alimentaire mondial : "il faudrait quand même que la prise de conscience des leaders mondiaux de la nécessité de changer de modèle aille plus vite que la montée des eaux !"■