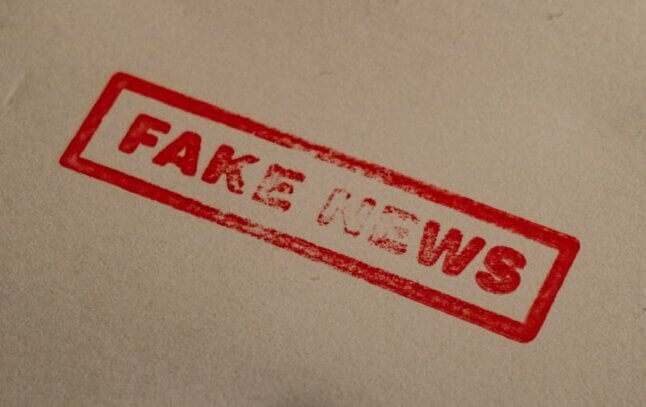Alors que la crise climatique continue de s’amplifier, et que ses conséquences sociales et économiques se font sentir de manière de plus en plus pressante, les grands médias français ne semblent toujours pas à la hauteur de l’enjeu. Selon un récent rapport publié par un consortium d’associations sur la base des données de l’Observatoire des médias sur l’écologie, la désinformation climatique n’est plus seulement omniprésente sur les réseaux sociaux, mais elle s’installe également dans de grands médias. Au programme : remise en cause des connaissances scientifiques sur l’origine du réchauffement climatique, négation des risques liés à la crise climatique, fausses informations sur les solutions liées à la crise climatique, etc.
En s’appuyant sur l’intelligence artificielle et une équipe de fact-checkers, les ONG Data For Good, QuotaClimat et Science Feedback ont en effet mis au point un outil de détection automatisé de désinformation climatique dans les médias, et leurs résultats sont alarmants. Au cours du premier trimestre 2025, les associations ont ainsi recensé 128 cas de désinformation climatique dans les médias audiovisuels et radiophoniques français. Une grande partie des plus grands médias du pays sont concernés : Sud Radio (40 cas de désinformation repérés), CNews (26 cas), LCI (11 cas), RMC (11 cas), BFM TV (10 cas) Europe 1 (10 cas), et même France Info (9 cas).
Certains médias concentrent la désinformation climatique
En plus de ces cas de désinformation climatique, le rapport recense 373 cas où les médias incriminés diffusent des messages contribuant à l’inaction climatique. En particulier, certains médias relaient des discours décrédibilisant les solutions liées à la transition écologique, ou remettant en cause la légitimité des acteurs de la transition, qu’ils soient des scientifiques, des ONG, des journalistes ou des institutions spécialisées, contribuant ainsi à créer le doute sur l’urgence climatique. “Dans un paysage médiatique où 69% des Français font confiance aux journaux télévisés, les affirmations inexactes, erronées ou trompeuses présentent un risque fort d’induire le public en erreur sur des faits établis en lien avec les crises environnementales en cours et de ralentir l’adhésion aux mesures nécessaires à la transition”, commente Lou Welgryn, co-présidente de Data for Good.
La désinformation climatique semble toutefois plus concentrée dans certains médias que dans d’autres. Sud Radio, condamnée pour désinformation climatique par le gendarme de l’audiovisuel (Arcom) en juin dernier, et CNews, également condamnée en juillet dernier, représentent à eux seuls la moitié des cas de désinformation décelés. En ligne de mire notamment, le relais par ces médias des discours climatosceptiques de l’extrême-droite, des lobbys des industries carbonées ou de figures complotistes, désignés comme les premières sources de la désinformation climatique. Au contraire, certains médias (RFI, France24, France 3 Ile-de-France) sont identifiés comme des “remparts” contre la désinformation climatique. RFI, par exemple, accorde près de 6% de son temps d’antenne aux sujets environnementaux, sans qu’aucun cas de désinformation n’ait été mis en lumière sur la période observée.
Une désinformation particulièrement liée aux enjeux politiques
Parmi les thématiques les plus sujettes aux discours de désinformation ou d’inaction climatique, on retrouve notamment les questions énergétiques et celles liées aux transports et à la mobilité. Les énergies renouvelables et les véhicules électriques font l’objet de très nombreuses “fake news” visant à discréditer ces solutions de transition énergétique. Les secteurs de l’énergie et du transport sont pourtant, avec l’agriculture, les plus critiques en matière de décarbonation. Les données montrent également que la désinformation climatique est particulièrement notable à proximité des grands événements politiques. L’investiture de Donald Trump à la Maison blanche, ou encore les grandes consultations liées à des politiques publiques climatiques ont ainsi été marquées par des hausses plus significatives de fausses nouvelles.
Dans son dernier rapport, l’Ademe montrait que le climatoscepticisme était en hausse dans la population française. En 2024, près de 30% des Français remettaient ainsi en cause l’ampleur de la crise climatique ou son origine humaine, un chiffre qui a doublé en 20 ans et qui représente une hausse de 12 points par rapport à 2020. Le traitement médiatique des questions climatiques joue forcément un rôle essentiel dans cette dynamique. “Quand la désinformation climatique existe dans les médias traditionnels, elle se normalise et nous entrons dans l’ère de la post-vérité, le débat cesse d’être éclairé et informé, et la confusion faits/opinions naît”, conclut Jean Sauvignon, responsable des données chez QuotaClimat. Face à cette désinformation, les auteurs du rapport appellent le législateur à mieux encadrer le respect par les médias de l’état des connaissances scientifiques sur le climat, et de renforcer les autorités de régulation comme l’Arcom.