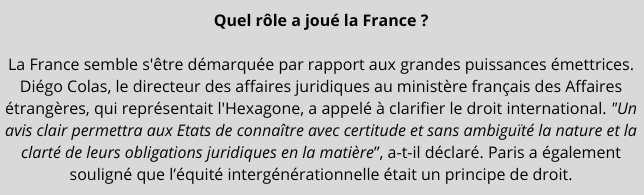Quelles sont les obligations d'action et de réparation des Etats en matière climatique ? C'est à ces deux questions que les quinze juges de la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction au sein de l'ONU, vont devoir répondre après avoir entendu une centaine d'Etats pendant deux semaines, du 2 au 13 décembre. Un procès inédit. Jamais une affaire n'avait conduit autant de pays et d'organisations à défiler devant la cour.
A la barre, une ligne de fracture oppose deux camps. D'un côté, la plupart des grandes économies, dont les Etats-Unis, la Chine et l'Inde, défendent le cadre juridique existant en matière climatique, à savoir la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l'Accord de Paris, et appellent à s'en tenir à cela. De l'autre, les nations vulnérables, plaident pour aller bien au-delà.
Se cacher derrière l'Accord de Paris
La Chine, qui a pris la parole dès les premiers jours (les prises de parole se faisaient par ordre alphabétique), a déclaré que les traités existants de l'ONU devraient "servir de base aux obligations juridiques des États pour lutter contre le réchauffement climatique et faire face aux conséquences de leurs contributions historiques". La CCNUCC est "l'expression la plus actuelle du consentement des Etats à être liés par le droit international en ce qui concerne le changement climatique", a de son côté affirmé la représentante de Washington, Margaret Taylor.
Une opinion également partagée par l'Australie, l'Allemagne, le Royaume-Uni mais aussi l'Inde. "La cour devrait éviter de créer des obligations nouvelles ou supplémentaires au-delà de celles déjà existantes", a indiqué le représentant de l'Inde, Luther Rangreji. Des déclarations qui ont suscité la colère des militants, qui accusent ces pays de "se cacher derrière" les accords existants comme l'Accord de Paris de 2015, considérés comme insuffisants car composés d'engagements principalement volontaires. "Nous assistons à une véritable bataille entre David et Goliath", a lancé Joie Chowdhury, juriste au Centre pour le droit international de l'environnement (Ciel), basé aux Etats-Unis et en Suisse.
"Nous ne pouvons permettre à quiconque d’utiliser à mauvais escient l’Accord de Paris pour diluer ses responsabilités et sa reddition de comptes en matière de climat. L’Accord de Paris a été créé comme un outil qui oblige juridiquement les pays à afficher des politiques et des actions à court et à long terme, qui sont cohérentes avec la limite de température de 1,5 °C. Il ne suffit pas d’annoncer des CDN (contributions nationales déterminées) qui, trop souvent, ne répondent pas à ces objectifs", a également dénoncé Laurance Tubiana, PDG de la Fondation européenne pour le climat et architecte de l’Accord de Paris.
"Un héritage de responsabilité"
En se cachant derrière l'Accord de Paris, ces Etats estiment ainsi que les autres textes du droit comme la Déclaration universelle des droits de l'Homme ne s'appliquent pas au changement climatique. Ils estiment dès lors que ces textes ne peuvent pas être brandis pour obliger des États à réduire leurs émissions ou à éliminer progressivement les combustibles fossiles, ni à accorder aux individus le droit de déposer des plaintes liées au climat. Mais, pour les pays vulnérables et de nombreux experts, le changement climatique est incontestablement une crise des droits de l’Homme.
Au sujet de la réparation, les plus grands pollueurs rejettent également toute responsabilité. Ils affirment que les dommages climatiques étant le résultat des émissions cumulatives de plusieurs États, aucun d’entre eux ne peut être tenu responsable. "Le droit international est très explicite sur le fait que lorsque plusieurs États sont responsables du même préjudice, chaque État peut être tenu responsable individuellement", précise au contraire le Centre pour le droit international de l'environnement.
"C'est une crise de survie. C'est aussi une crise d'équité", a déclaré le représentant des îles Fidji, Luke Daunivalu. "Notre peuple (...) paie injustement et à tort la facture d'une crise qu'il n'a pas créée. Il attend de cette cour de justice, clarté et un esprit de décision", a ajouté Luke Daunivalu. "Vos conseils juridiques résonneront à travers les générations, façonnant un héritage de responsabilité, de protection et d'espoir pour tous", a-t-il poursuivi devant les juges.
Des grands pollueurs "isolés"
Pour Nikki Reisch, directrice du programme Climat et énergie du Center for International Environmental Law (Ciel), ce qui apparaît aux termes de ce procès hors-normes, c'est que "les grands pollueurs se sont retrouvés isolés dans leurs tentatives de balayer sous le tapis leur responsabilité historique dans la crise climatique et d’affirmer que leurs obligations juridiques commencent et se terminent avec l’Accord de Paris". "La majorité des pays ont exhorté la Cour à affirmer que le devoir de prévenir les dommages environnementaux au-delà des frontières est bien antérieur au régime climatique (CCNUCC et Accord de Paris, ndr), que les grands pollueurs qui alimentent la crise climatique manquent à ce devoir depuis des décennies et qu’ils ont l’obligation claire de cesser leur comportement destructeur du climat et de remédier à ses conséquences catastrophiques", ajoute-t-elle.
"Nous avons fait valoir, déclaration après déclaration, que le droit international de l'environnement et les droits fondamentaux de l'Homme sont des obligations juridiques internationales applicables qui ne doivent pas être exclues des responsabilités des États dans le contexte des changements climatiques", a également souligné Arnold Kiel Loughman, le Procureur général de la République de Vanuatu, en clôture des audiences le 13 décembre. "Le peuple marshallais a un dicton : "Wa kuk wa jimor", qui signifie "nous sommes tous dans le même canoë", a ajouté M. Silk. Aujourd'hui, j'étends ce principe à notre communauté internationale".
La Cour devra rendre son délibéré dans le courant de l'année prochaine. Mais d'ores et déjà, les spécialistes estiment que "les audiences sur le climat à la CIJ ont marqué un tournant pour la responsabilité climatique" et que "leur impact est déjà perceptible, avant même que l’avis ne soit rendu". "La vague de demandes de justice climatique ne fera que s’intensifier à mesure que les enjeux s’accroissent", prévient Nikki Reisch.