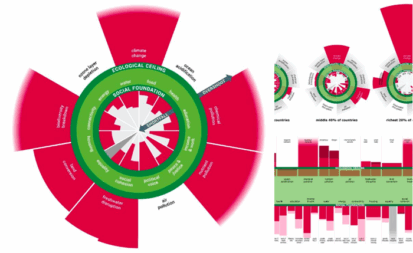Vos travaux récents invitent à "ringardiser la performance", notamment (mais pas que) dans les entreprises, pouvez-vous expliquer ce que cela signifie ?
Aujourd'hui, le système économique semble focalisé sur la recherche de performance, et son corolaire, la rentabilité financière. La recherche de la performance, c'est l'idée de mettre toutes les ressources à disposition pour maximiser les rendements, rendre les processus les plus efficients possibles, optimiser, réduire les coûts et limiter les redondances. Toutes ces méthodes visant la performance se fondent sur la division du travail, ou chacun accomplit sa tache de façon la plus efficace possible, avec des fonctionnements en silos ultra-spécialisés.
Sur le papier, l'idée peut séduire, mais dans la pratique, cette vision de la performance ne fonctionne que dans un monde stable, prévisible, avec des ressources abondantes et disponibles. Or aujourd'hui, on entre dans un monde qui n'est plus stable, et qui devient de plus en plus imprévisible à cause de la multiplicité des crises sociales, écologiques, géopolitiques, énergétiques et autres. Les ressources sont moins facilement accessibles, moins abondantes, et donc il est beaucoup plus difficile, et beaucoup plus risqué d'organiser sa stratégie au prisme de la performance et de l'optimisation.
Prenons un exemple : dans un paradigme de performance, les grandes entreprises se concentrent sur la stratégie jugée la plus efficiente, et pour cela recherchent en général le fournisseur les plus performant, le moins cher. Mais que se passe-t-il, par exemple, si ce fournisseur spécialisé n'est soudain plus disponible parce qu'il subit une catastrophe naturelle ? Dans ce cas, c'est toute l'activité de l'entreprise qui est paralysée parce que l'organisation n'avait pas prévu d'alternative, de redondance. C'est ce qui est arrivé à Audi ou Porsche ces derniers mois. En fait, le culte de la performance oblige en général à s'enferrer dans une voie étroite, à réduire ses marges de manœuvre. Et ça, ça ne fonctionne plus dans le monde d'aujourd'hui. Les fluctuations nous obligent à prévoir des alternatives, des redondances. La performance est donc en train de devenir "ringarde" au sens où elle n'est plus adaptée aux enjeux de notre époque.
Crise climatique : Porsche, impacté par des inondations, annonce des pénuries
Vous défendez l'idée de passer du primat à la performance au primat à la robustesse, pouvez-vous expliquer de quoi il s'agit ?
La robustesse, c'est la capacité à maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations, la capacité à s'adapter, à résister à des chocs, à des variations imprévues du système. C'est aujourd'hui fondamental car tous les organismes internationaux comme le Giec, l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la CIA, nous disent tous que le monde va subir des turbulences majeurs, difficiles voire impossibles à anticiper. Il faut donc que nos systèmes soient robustes pour encaisser ces fortes fluctuations et rester viables. C'est une notion qui est très différente, et même opposée à celle de performance.
Si on prend une image dans le monde du vivant, le paradigme de la performance c'est le mode de fonctionnement des parasites. Ils dépendent de leur hôte, consomment ses ressources pour se développer, détruisent leurs compétiteurs, et quand ils ont consommé toutes les ressources ils meurent avec leur hôte. A l'inverse, la robustesse, c'est le roseau dans le vent, qui résiste aux fluctuations, plie et arrive à se maintenir, ce sont les bactéries de notre organisme qui co-évoluent avec nous, les mycorhize qui interagissent avec les racines des végétaux, etc. D'une manière générale, les êtres vivants fonctionnent selon des logiques de robustesse : ils coopèrent, ils s'adaptent, ils se régulent, parce que la plupart d'entre eux vivent dans des environnements instables ou pénuriques.
L'idée, c'est de s'inspirer de ces modes de fonctionnement pour développer des organisations (économiques, sociales, politiques) plus robustes, et donc plus capables de survivre aux chocs d'un monde en bifurcation.
Selon vous, robustesse et performance sont donc incompatibles ?
En tout cas, construire sa robustesse a toujours un coût en matière de performance, puisqu'il faut parfois sacrifier de l'efficacité. Le néolibéralisme a généralisé un catéchisme de la performance, qu'on retrouve dans le taylorisme, les nouvelles méthodes de management à la McKinsey, les fonctionnements en flux tendu, la suroptimisation. Tant qu'on est dans ce paradigme, focalisé sur des indicateurs de performance, les fameux KPI, il est très difficile de se réorienter vers la robustesse.
On le voit bien dans le capitalisme contemporain, en particulier dans le monde d'inspiration anglo-saxonne. Des entreprises comme Boeing, ou Stellantis, par exemple, se sont enfermées dans des logiques de performance, de réduction des coûts ces dernières années. Face à une baisse de leurs performances, ils ont répondu avec encore plus de logiques de performance, au lieu de changer de modèle. Cela a fonctionné à court terme, mais là, ça ne marche plus, ce sont des modèles qui sont à bout de souffle.
Au contraire, on voit que des modèles jugés autrefois moins performants font désormais leurs preuves. Par exemple, en Italie du Nord, les entreprises mettent leurs ressources en commun, créent des coopérations, relocalisent. Ces adaptations ont un coût, mais rendent les entreprises du territoire plus robustes, notamment à la tentation de la délocalisation. Les politiques de compétitivité en France ont surtout alimenté la désindustrialisation du territoire national ! On voit aussi que certains acteurs plus petits et plus connectés à leurs territoires, finissent par mieux s'en sortir que les grosses multinationales. On peut prendre l'exemple de Pocheco (fabricant de packagings écologiques, ndlr), vers Lille, qui a fait de son ancrage territorial, social et écologique son modèle économique. Certaines activités autrefois peu rentables commencent à devenir pertinentes. Citons par exemple Breizhelec en Bretagne : cette petite entreprise existe depuis les années 1970 et propose de la réparation électronique pour les machines agricoles. A mesure que la réparabilité devient un enjeu d'autonomie et de souveraineté, son modèle se décline maintenant en Australie et aux Etats-Unis.
Concrètement, à quoi ressemble un système économique plus robuste ?
C'est un vrai changement de modèle, qui doit concerner le système de production, le système économique, le système social. On doit passer d'une société très extractiviste, très individualiste, avec peu d'interactions, à une société avec moins d'extractions et plus d'interactions. Les entreprises, de leur côté, vont devoir transformer profondément leurs modèles d'affaires. Construire leur robustesse, cela veut dire construire des systèmes de production locaux et concevoir des produits plus adaptables et réparables, avec les formations et les services associés. Au départ, cela va évidemment sembler inefficace, car on va se lancer dans des productions qui ne seront pas optimisées, avec des coûts plus importants, on produira peut-être des objets plus lourds. Mais finalement, cela permettra de développer des produits réparables localement, dans des organisations à taille humaine et donc de développer de la robustesse sociale, écologique et économique.
En fait, les dirigeants doivent comprendre que le temps des entreprises ultra performantes, pyramidales, optimisées arrive à sa fin. Les chaînes de production ultra-mondialisées, déconnectées de leurs territoires, déconnectées des travailleurs, ne seront pas viables dans le monde de demain. Sans même évoquer les catastrophes naturelles, les crises géopolitiques actuelles le démontrent d’ores et déjà. Et c'est justement le rôle d'un PDG dirigeant de prévoir et d'organiser cette transitionbifurcation, en appréhendant le compromis entre performance et robustesse.
Et en pratique, comment organiser cette transformation dans les entreprises ?
D'abord, les dirigeants doivent arrêter de voir le monde avec un fichier Excel de coûts et de recettes devant les yeux. Ils doivent avoir conscience que dans tous les cas, le système va basculer, et que c'est leur responsabilité d'organiser cette bascule en évitant la casse sociale. A partir de là, il faut organiser des projets pilotes, capables de monter en échelle rapidement, qui mobilisent par exemple 1 à 2% du chiffre d'affaires, pour tenter de développer d'autres modèles plus robustes, plus adaptés. Installer un atelier de réparation en est un exemple.
En parallèle, on peut organiser ce que j'appelle des "audits de robustesse" : il s'agit de lister les contre-performances de l'entreprise et, au lieu de les supprimer, d'identifier en quoi elles servent la robustesse de l'entreprise. L'exemple parfait, c'est la pause café. C'est un moment improductif, mais en réalité cela créé du lien social, un sentiment d'appartenance, et c'est parfois aussi le moment où l'on innove grâce à des dialogues imprévus. Il faut aussi cartographier ses liens aux territoires, aux ressources, pour identifier les points faibles, c'est-à-dire les endroits où l'organisation n'a pas de redondances et beaucoup de vulnérabilités.
A partir de ce diagnostic, on peut mettre en place des stress-tests, en imaginant des scénarios de transformation. "Et si la Chine envahit Taiwan ?", "Et si la crise climatique paralyse mes fournisseurs clés à l'autre bout du monde ?", "Et si les bouleversements écologiques multiplient mes coûts de production par deux ?", "Et si les inégalités sociales déstabilisent mes marchés ?". Autant de questions qui permettent de se projeter dans un avenir "business as unusual", et de s'y préparer, en intégrant les risques économiques, mais aussi sociaux, écologiques, de gouvernance, géopolitiques. Car la robustesse,doit être présente à tous les échelons de la chaîne de valeur : le maillon faible dans un monde instable, c'est le maillon le plus performant parce qu'il est aussi le plus fragile.
Comment convaincre les acteurs économiques de la nécessité de cette transformation ?
C'est une révolution culturelle ! C'est pour cela que je parle de "ringardiser" la performance. Il faut réussir à montrer aux dirigeants économiques, mais aussi aux dirigeants politiques, que ces logiques sont obsolètes, et même dangereuses à moyen terme. Faire comprendre que si on ne met pas un pied dans cette transformation, c'est qu'on décide de mourir. Aujourd'hui, une organisation qui veut être pérenne doit absolument organiser une partie de son activité dans une transformation vers des modèles de robustesse, pour se préparer aux bascules à venir. Cela peut être 5% de son chiffre d'affaires, 10% 30% pour commencer.
Cela signifie aussi que le système financier actuel devra être repensé, car il ne fonctionne surtout sur le modèle de la performance. Il va falloir encadrer ce système, lui donner de nouveaux indicateurs, de nouvelles règles. C'est une très bonne nouvelle, car ce système est en réalité très violent. En fait, la performance est une violence, puisqu'elle valorise la compétition où ce sont toujours les plus violents qui gagnent. D'ailleurs, dans la bifurcation vers la robustesse, ce sont ces mêmes compétiteurs, les ultra-performants, qui refusent aujourd'hui d'abandonner les vieilles logiques, pour continuer à écraser la concurrence. Forcément, cela créé de la casse sociale et de la souffrance, car beaucoup de travailleurs pauvres sont coincés par ces entreprises et ces modèles dépassés. Comme le dit le rapporteur des Nations Unies, Olivier de Schutter, "Il est choquant de constater que dans l'économie [des petits boulots] actuelle, on court moins de risques de santé mentale en étant au chômage qu'en acceptant un emploi."
Ces changement devront nécessairement s'organiser dans le dialogue, autour de ce que le philosophe Patrick Viveret appelle le désaccord fécond. C'est-à-dire des endroits dans les entreprises, dans le système économique et politique, où les désaccords et les contradictions pourront s'exprimer, pour identifier les blocages et les vulnérabilités. Le dialogue social est alors essentiel, tout comme les Conventions Citoyennes. Concrètement, la bifurcation devra s'organiser de manière participative. C'est évidemment plus lent, plus complexe, plus imprévisible... Mais c'est aussi plus robuste !