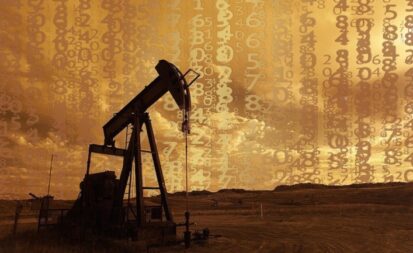Fin avril, l’International Sustainability Standards Board (ISSB) a mis à jour son agenda de recherche pour y inclure les risques et les opportunités liés à la nature et au capital humain.
Rappelons que jusqu’à présent l’ISSB, dont la finalité est de proposer une extension des normes IFRS (International Financial Reporting Standards) aux enjeux non pris en compte par ces dernières, ne s’était intéressé qu’au climat (IFRS S2), au risque de rester dans le tunnel “carbone” (tendance à se concentrer uniquement sur les émissions de gaz à effets de serre, notamment de CO2, dans le cadre des questions de durabilité, en omettant ainsi l’ensemble des limites planétaires, les enjeux sociaux et l’interdépendance entre tous ces enjeux).
La matérialité financière comme orientation confirmée de l’ISSB
On constatera que, comme prévu, la perspective de l’ISSB reste totalement centrée sur la matérialité financière pour la prise en compte de la nature. Cet organisme confirme donc bien son orientation, qui diffère de manière radicale de celle de l’Union européenne et de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), directive qui, d’ailleurs, s’est attelée à couvrir l’ensemble des sujets ESG (Environnement, Social et Gouvernance).
Concrètement, aucune mention n’est faite de la prise en considération des impacts de l’entreprise sur la nature dans le projet de l’ISSB : la nature est vue comme importante (matérielle) uniquement du fait de ses conséquences financières. Et même les mentions faites au cadre de la TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) n’y changent rien, ce dispositif étant lui-même embourbé dans la question de la matérialité, laissant trop de flexibilité à la fois sur la définition de la “matérialité à impact” et sur sa mise en œuvre par les entreprises.
On pourrait à ce stade revenir sur le fait que la matérialité financière est en porte-à-faux avec la science et que la conception de la durabilité qu’elle véhicule est délétère dans ces conditions, mais explorons un autre point, peut-être plus sensible car plus au cœur de la rationalité défendue par l’ISSB.
Les besoins des investisseurs… mais quels investisseurs ?
En effet, l’ISSB fait reposer ses choix sur une raison fondamentale : les besoins des investisseurs. Cet organisme semble ainsi connaître parfaitement ces fameux “besoins”, qui reposeraient sur une seule préoccupation, apparemment, celle de la maximisation de la valeur financière des investissements.
Et pourtant… Pourtant, cette doxa de la maximisation des dividendes et de la focalisation sur la valorisation du capital est loin d’être “normale”. D’un point de vue historique, la finance n’a pas fonctionné ainsi. Ce qu’on peut appeler la finance “classique” repose sur l’idée d’accompagnement de l’entreprise : la finance se confond avec le financement, tandis que l’entreprise existe en tant qu’entité à part entière, ayant des finalités propres. Le profit est compris dès lors sur le long terme et dans une certaine stabilité : des profits stables sur une durée longue. En écho à l’adage qu’il ne faut pas vivre pour manger mais manger pour vivre, l’entreprise doit ainsi être rentable pour vivre longtemps mais ne vit pas pour être rentable…
Le renversement des fins et des moyens concernant l’entreprise et la finance a été opéré au milieu du 20e siècle, même si des prémices existaient avant. Cette “révolution” intellectuelle, où on retrouve Milton Friedman, entre autres, et toute la théorie dite moderne de la finance, a conduit à changer le regard sur l’entreprise et l’investissement. La finance s’est ainsi développée autour du présupposé, et insistons vraiment sur le fait qu’il s’agit bien d’un postulat, qu’il existerait des marchés efficients et que le but de la finance serait de permettre d’estimer la valeur “objectivée” des actifs, que ces marchés devraient révéler – et en particulier celle des entreprises vues, non plus comme projets à accompagner, mais comme lignes dans un portefeuille de titres. Dans cette perspective, l’entreprise devient une simple ombre en tant qu’organisation humaine : son existence se trouve conditionnée à la maximisation de sa valeur.
Les IFRS, et leur philosophie d’une comptabilité basée sur la valeur de marché (Juste Valeur), ont pleinement contribué à rendre opératoires ces présupposés. S’est ainsi progressivement construite l’idée que ce mode de fonctionnement pouvait être considéré comme “normal” et constituer la base de l’enseignement de la finance, voire de la comptabilité. Et d’aucuns de s’interroger d’ailleurs sur les raisons de l’imposition de ce mode de pensée : un accaparement par “certains” intérêts financiers particuliers ?
Cependant cette réalité, presque alternative, est loin de s’être imposée dans l’économie “réelle”, voire nuit au financement même des entreprises. Des acteurs comme l’Association Française des Investisseurs Institutionnels exhortent ainsi à “moins se focaliser sur la valorisation du capital” et plus sur “la génération régulière de revenus [à long terme]“, sur le “portage d’actifs à long terme“, dans une perspective classique de la finance, tout en expliquant que les “dirigeants sont trop liés aux performances“.
C’est ainsi que l’Asia Investing Group on Climate Change a rappelé à l’ISSB en 2022, lors de la consultation internationale sur les futures normes IFRS S1 et S2, que “plusieurs investisseurs ont des mandats plus holistiques [que ceux retenus par l’ISSB], qui vont au-delà de la seule création de valeur financière“. Cette position a d’ailleurs contribué à l’adoption en Chine d’une réglementation forçant les entreprises cotées chinoises à rendre compte de leurs activités dans un rapport de durabilité basé sur la double matérialité, d’ici au 30 avril 2026. Et oui, sur la double matérialité, pierre angulaire d’une démarche d’investissement authentiquement durable. Apparemment, la Chine a une autre lecture des besoins des investisseurs que celle de l’ISSB.
Un “vernis vert” ?
Dès lors, de quels investisseurs parle cet organisme ? Si on regarde un peu plus en détails leur publication sur la mise à jour de leur agenda de recherche, peut-être ceux qui ont poussé l’ISSB à ne pas s’engager dans des projets liés aux risques et opportunités associés aux droits de l’homme, ni à les intégrer dans leur vision du reporting pour l’instant. Et cela, en contradiction directe avec les Objectifs de développement durable (ODD) notamment. En effet, selon l’ISSB cette décision découlerait d’informations données par le “marché” (“market feedback”)… mais quel marché ? Celui qui conduirait à investir toujours plus dans les énergies fossiles, tout en souhaitant afficher un vernis “vert”, comme ce que des activistes ont mis en évidence lors d’un “happening” dans le cadre d’un sommet de l’ISSB en février ? En effet, ces derniers ont dénoncé le fait que Bank of America applaudissait le travail de l’ISSB, tout en revenant sur ses engagements de ne plus financer directement des projets de forage dans l’Arctique et d’exploitation du charbon : on peut être ainsi aligné sur IFRS S2, sur la matérialité financière et continuer à financer de tels projets, apparemment.
Et si la défense coûte que coûte de la matérialité financière par l’ISSB ne relevait pas d’un pragmatisme raisonnable pour répondre aux “besoins” du marché, mais simplement de l’accaparement des enjeux de durabilité par les seuls “besoins” d’un (très) petit nombre d’acteurs, n’ayant aucun intérêt au changement et à la réorientation réelle du financement des entreprises, vers de nouveaux buts plus écologiques ?