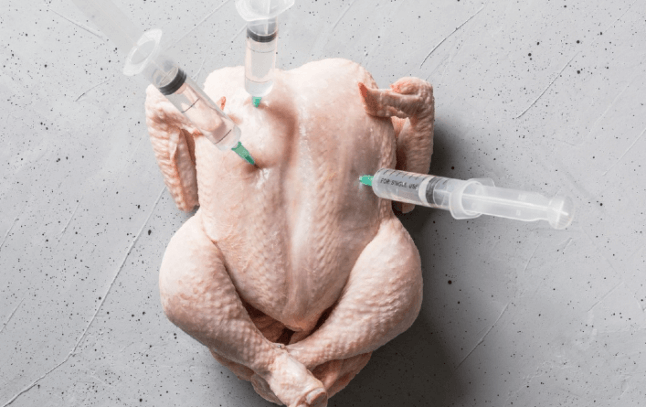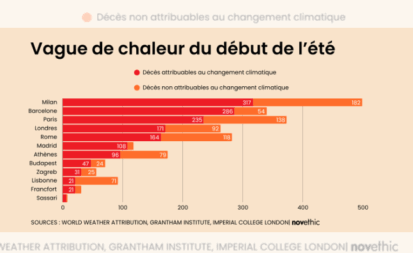Des kiwis bio français qui sont en réalité des fruits italiens cultivés dans des champs conventionnels, du parmesan qui ressemble étrangement à du gruyère, des épices contenant du sable… La fraude alimentaire est un véritablement fléau que les autorités n’arrivent pas à endiguer. C’est la conclusion d’une enquête publiée par la présidente de l’ONG Foodwatch dans un nouveau livre baptisé “Manger du faux pour de vrai”. Au cours de ces 400 pages, l’autrice a passé au crible la fraude alimentaire, issue de réseaux criminels ultra-organisés.
“Adeptes du bio, locavores, clients du hard discount ou bobos avertis, soyez-en sûrs : la fraude alimentaire nous concerne toutes et tous, riches ou pauvres”, prévient Ingrid Kragl. Et les chiffres illustrent parfaitement l’ampleur du phénomène. Une épice sur deux est frauduleuse. Le pire étant le safran dont 81 % de la commercialisation est touchée. “On a vu du safran vendu comme de la fleur de safran constitué à 100 % de fleur de carthame, 500 fois moins cher”, explique Foodwatch. Côté poivre, deux sur trois sont touchés par la fraude. Le miel est aussi concerné. 
Du thon plus rouge et moins odorant
Alors que la production de miel s’effondre avec le déclin des abeilles, les importations explosent, et avec elles, les fraudes. Ajout de glucose, du miel sans miel créé chimiquement, falsification de l’origine… un miel sur deux serait touché par la fraude. Ce n’est guère mieux du côté du poisson, dont 50 % présentent des anomalies comme des soucis d’hygiène ou des fraudes sur l’étiquette. Ingrid Kragl raconte ainsi comment, pour maquiller le thon, le rendre plus rouge, moins odorant, les fraudeurs s’équipent : “Des aiguilles s’enfoncent dans le poisson et y injectent des nitrates, nitrites et/ou du monoxyde de carbone, voire un mélange d’extraits végétaux couplés à un cocktail d’antioxydants (acide citrique et ascorbique“. Des procédés interdits par le règlement européen et posant des problèmes de santé publique.
Quant aux produits bio, pour l’instant, la fraude n’est pas aussi étendue mais le marché, en plein boom, attire de plus en plus les opérateurs peu scrupuleux. Ainsi, aujourd’hui, un produit bio sur douze n’est pas ce qu’il prétend. Dans les Alpes Maritimes, c’est 30 % des produits bio qui sont frauduleux. Une autre enquête, menée par un ancien cadre de l’agroalimentaire, Christophe Brusset, avait déjà raconté les coulisses de ce marché. Dans “Les imposteurs du bio “, il dévoilait notamment le développement de véritables mafias autour de la labellisation de produits bio qui ne l’étaient pas vraiment.
Explosion de la fraude avec le Covid-19
Face à l’ampleur de la fraude alimentaire, l’ONG Foodwatch a lancé une campagne pour obtenir des autorités françaises davantage de transparence et de contrôle. “Rien ne justifie l’opacité actuelle. Il s’agit avant tout d’un choix politique, aujourd’hui entre vos mains”, écrit l’organisation dans une lettre, rendue publique, adressée au ministre de l’Économie Bruno Le Maire et à celui de l’Agriculture Julien Denormandie. “La fraude alimentaire est un phénomène croissant mais savamment occulté tant par nos autorités que l’industrie agroalimentaire et la grande distribution qui sont parfaitement au courant”, affirme Ingrid Kragl.
D’autant que la fraude ne cesse de progresser. Le risque de falsification aurait même augmenté de 94 % avec le Covid-19 à cause notamment, de la baisse de la surveillance pendant la pandémie. “Les restrictions aux frontières ont fortement perturbé les chaînes d’approvisionnement. Chez les industriels agroalimentaires, des audits programmés -parfois pour des denrées provenant de très loin – n’ont tout simplement pas eu lieu à cause de la pandémie et des limitations des déplacements. Les organisations criminelles de type mafieux y ont illico vu des opportunités profitant de la peur des gens face à l’insécurité alimentaire (…)”, explique Ingrid Kragl.
Marina Fabre, @fabre_marina