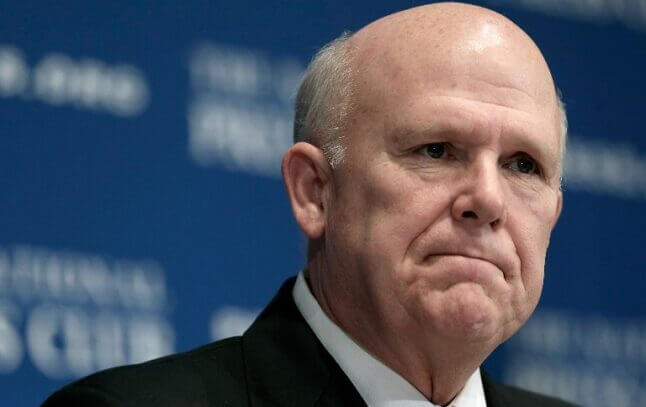"Ce qui met les gens en colère – et à raison –, c’est que ces dirigeants sont récompensés pour des échecs. Et particulièrement quand ces récompenses sont subventionnées par les contribuables américains", lançait Barack Obama le 4 février 2009.
Il s’engageait alors à plafonner à 500 000 dollars par an les rémunérations dans les entreprises sauvées de la faillite par l’Etat. Dans le cadre du TARP, un plan d’aide voté en pleine tempête financière, des centaines de milliards de dollars avaient été injectés dans des banques, des assureurs ou des constructeurs automobiles.
Six ans plus tard, la contrepartie exigée par le président américain s’est muée en chimère, avec des dérapages pointés du doigt par celui que les Américains appellent le "chien de garde", l’inspecteur général chargé de surveiller la mise en œuvre du TARP.
Un plan de sauvetage qui lèse le contribuable
Dans un rapport publié fin septembre, deux entreprises sont dans le viseur: General Motors et son bras financier, Ally Financial. En 2013, chacun de leurs 25 top managers a perçu un salaire supérieur à 1 million. Les dérapages ne datent pas d’hier: entre 2009 et 2013, le nombre de salariés percevant plus de 500 000 dollars de rémunération a triplé.
Le Trésor américain est lui aussi mis en accusation. L’inspecteur général le tance pour avoir validé ces rémunérations. "Il a trop fait pencher la balance du côté de la compétitivité des entreprises (…) perdant, au passage, une chance de réformer en profondeur une des causes de la crise financière", peut-on lire dans ce rapport qui ne mâche pas ses mots.
Pour le "chien de garde" du TARP, ces dérapages sont d’autant plus graves qu’ils lèsent le contribuable. Parce qu’au moment où ces salaires ont été octroyés, GM et Ally Financial n’avaient pas totalement soldé leurs dettes. Combien d’argent public a ainsi été perdu ? Le Trésor, prenant en compte toutes les entreprises aidées, affirme que le TARP a rapporté plus qu’il a coûté, 15 milliards gagnés pour 425 milliards injectés. L’inspecteur général lui répond que le sauvetage de GM représente à lui seul une perte de 11 milliards.
Au-delà des chiffres, l’enjeu est moral. Et politique. Le plafonnement des salaires, ce n’était que des "promesses d’élus", juge Mark Calabria, directeur de recherche du think tank Cato. "La loi créant le TARP contenait une ligne de conduite vague, analyse-t-il. Elle est écrite d’une manière si générale qu’elle est presque vidée de son sens, ce qui explique en grande partie son impact si limité."