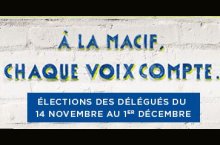« S'il y a des gènes qui prédisposent les mutuelles et les coopératives à être socialement responsables, ce n'est pas suffisant pour l'être réellement », affirme d'emblée Michel Capron,chercheur à l'Institut de recherche en Gestion de l'Université Paris Est.
Selon le Guide de la gouvernance des coopératives et des mutuelles édité par l'Institut français des administrateurs (IFA), ces gênes sont au nombre de 3 : les coopératives et mutuelles sont gouvernées par des sociétaires ou des adhérents ; la prise de décision répond au principe démocratique « une personne-une voix » (a contrario du principe « une action égale une voix ») , lequel sous-tend une culture du débat, de respect des avis opposés et de recherche d'équilibre et de consensus ; et enfin, la conciliation d'une activité économique au service de leurs membres et d'un objectif d'intérêt collectif.
Mais pour aboutir à une posture RSE cela ne suffit pas : « Il faut vérifier la cohérence entre les trois éléments que sont le respect des principes fondateurs, les modes d'organisation et la concordance entre les pratiques et la théorie », explique Etienne Pflimlin président d'honneur du Crédit mutuel et auteur, avec Daniel Lebègue, du Guide de la gouvernance des coopératives et des mutuelles.
Coopérative égoïstes ?
« On peut très bien avoir des coopérateurs qui se recroquevillent dans une forme d'égoïsme tourné vers leur coopérative sans se préoccuper de son environnement extérieur », explique Michel Capron. En France, la plus importante entreprise coopérative n'est autre que l'enseigne de grande distribution E.Leclerc. Les magasins sont membres de la coopérative de commerçants ADLEC qui leur donne accès, notamment, aux services d'une centrale d'achat réputée pour la pression qu'elle exerce sur ses fournisseurs...
Pour Philippe Frémeaux, auteur de « La Nouvelle alternative ? Enquête sur l'économie sociale et solidaire » et éditorialiste à Alternatives Economiques, un magazine qui est lui-même édité par une coopérative : « L'enjeu majeur, si on veut parler de gouvernance plus démocratique, est de trouver les moyens d'associer plus de parties prenantes au-delà de la seule catégorie concernée. Un statut permettant d'asseoir autour d'une même table des parties prenantes aux intérêts différents existe bien. Il s'agit de la Société coopérative d'intérêt collectif mais ce statut reste encore confidentiel.» Dans leur grande majorité, les mutuelles ou les coopératives ne font, elles, participer qu'une seule catégorie des parties prenantes au processus de décision : les agriculteurs dans les coopératives agricoles, les salariés dans une société coopérative de production (Scop) ou les assurés dans une mutuelle.
Manque de transparence
De plus, à force de croissance, la question de la construction juridique des groupes coopératifs, constitués de nombreuses filiales, peut parfois poser problème. D'autant que depuis quelques années, les coopératives rachètent de grosses entreprises privées. Ce fut le cas pour Spanghero, une société de droit commun détenue à 90% par la coopérative Lur Berri par exemple, le président était en même temps vice-président de Lur Berri ! « D'où la confusion des pouvoirs et le manque de transparence. Les statuts actuels ne sont pas suffisamment clairs. Tout est prévu sur les coopératives elles-mêmes, mais rien en ce qui concerne la gouvernance des filiales. Les textes ont été écrits en 1947. Depuis cette époque les structures des entreprises ont complètement changé !», expliquait ainsi Philippe Mangin, le président de Coop de France aux Echos. Coop de France a d'ailleurs écrit un guide de l'administrateur sur la responsabilité du conseil d'administration et le contrôle des filiales.
Publié le 24 février 2014
Le secteur coopératif français prend de l'ampleur. Aujourd'hui sur le territoire, 23 000 coopératives emploient plus d'un million de salariés (4,5 % de l'emploi salarié) pour un chiffre d'affaires de 300 milliards d'euros. En plus de cette belle santé économique, le secteur est souvent présenté comme un modèle de gouvernance. Or la démocratie en entreprise n'est pas forcément assortie d'un comportement socialement responsable. Cela suppose des engagements spécifiques.
Découvrir gratuitement
l'univers Novethic
- 2 newsletters hebdomadaires
- Alertes quotidiennes
- Etudes