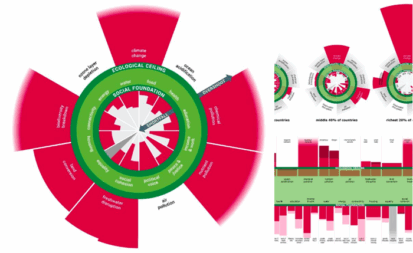Après le licenciement de Rosa Abramoff aux Etats-Unis pour avoir évoqué le changement climatique, ne craignez-vous pas vous aussi de perdre votre emploi ?
Ce qu’ont fait Rose Abramoff et Peter Klamus a déjà été fait en France, avec des occupations de bâtiments institutionnels, et personne n’a été licencié. Valérie Masson-Delmotte fait cent fois plus que Rose Abramoff et elle n’a pas été licenciée. Les conditions sociales ne sont pas les mêmes entre la France et les États-Unis, mais au-delà de ça, vu le nombre de scientifiques engagés, je ne vois pas comment on pourrait décider de licencier un tel plutôt qu’un autre. Je pense que la plupart des scientifiques mobilisés, qui vivent une angoisse très forte, sont prêts à aller au bout. Rationnellement, ça s’impose parce que c’est ça qui est éthique, c’est nécessaire. Nous n’avons pas de raisons de reculer. Mais si je me fais licencier, j’ai envie de dire et alors. La catastrophe sera la même pour tout le monde. En revanche, j’aurais plus peur pour mon avenir si j’étais un cadre de TotalEnergies qu’un scientifique engagé parce qu’un jour on va lui demander des comptes pour toutes les morts provoquées par le changement climatique.
Est-ce nouveau que les scientifiques s’engagent ?
Historiquement non, il était logique que les scientifiques s’engagent dans l’espace public. Mais aujourd’hui, ça peut paraître déroutant parce qu’on a l’image du scientifique qui ne sort pas de son laboratoire, dans sa tour d'ivoire, qui se cache derrière sa neutralité. C’est un phénomène culturel récent. Mais, pour nous scientifiques, il est très difficile de documenter, de participer à des rapports qui mettent en évidence que nos sociétés sont en péril, et puis après plus rien. Tout ce travail pour lequel nous avons été payé, tous ces savoirs sont mis dans un tiroir sans influencer la puissance publique. Quand vous savez que vous êtes dans une situation d’urgence climatique, ça devient intenable. L’éthique du scientifique, ce n’est pas juste de publier des articles dans des revues prestigieuses, d’être un bon élève. Il s’agit de produire et diffuser des connaissances pour servir l’intérêt général. C’est là qu’il y a une confusion.
Comment est né le collectif "Scientifiques en rébellion" que vous coordonnez avec d'autres collègues ?
C’était l’étape d'après, face aux échecs du Giec et à l’inaction climatique des gouvernements et de certaines institutions scientifiques. Certains ont jugé nécessaire, pour faire leur mission, de s’engager plus radicalement dans l’espace public et de prôner des actions de désobéissance civile pour alerter et peser sur les politiques publiques. C’est une autre forme de mobilisation. Tout est parti d’une tribune, publiée dans Le Monde, et signée par 1 000 puis 2 000 scientifiques. Tout à coup, il y a eu une résonance, il y avait une attente pour redonner du sens à notre métier, dans un moment charnière de crise où il faut faire des choix, où on peut encore changer les choses. C’est pour ça qu’il faut aller dans la rue et partager nos connaissances.
À l’étranger, on a vu des scientifiques s’enchaîner à la banque JP Morgan ou participer au blocage d’une mine de lignite à Lützerath en Allemagne. Pourquoi ne voit-on pas de telles actions en France ?
En France, nous avons moins cette culture de la désobéissance civile telle qu’elle existe dans le monde anglo-saxon et je pense qu’il est important de maintenir une diversité dans les formes d’actions. Il faut arriver à trouver des espaces de médiatisation de la crise et de mise en réflexion, d’autant que notre parole peut faire bouger les choses. Nous ne sommes pas des jeunes de l’ultragauche avec une image de radicalité. Nous sommes les "bons élèves", et quand des scientifiques décident de mettre leur vie en danger, ou du moins leur carrière, ils sont écoutés du grand public. Mais notre message s'adresse aussi aux politiques pour leur dire qu’on n’est pas dupes sur le fait qu'on n’en fait pas assez pour le climat, et on le fait savoir.
Comment jugez-vous la position des institutions financières, pour l’instant plutôt silencieuses en France ?
Elles ont fait l’objet de fortes restructurations ces dernières décennies avec une pénétration de plus en plus forte de l'esprit managérial dans le monde de la recherche, une forme de verticalité et de hiérarchisation se sont mises en place. Les institutions scientifiques vont donc devoir choisir entre poursuivre leur mission qui est la diffusion des connaissances, et une inféodation de plus en plus forte aux pouvoirs publics qui n’ont pas les mêmes objectifs. Elles sont coincées entre ces deux univers. Et le débat n’est pas tranché. On commence néanmoins à voir des signaux. Le comité éthique du CNRS a récemment publié des recommandations dans lesquelles il indique que "la prise en compte des impacts environnementaux de la recherche doit être considérée comme relevant de l’éthique de la recherche, au même titre que le respect de la personne humaine ou de l’animal d’expérimentation". C’est une avancée.
Propos recueillis par Concepcion Alvarez @conce1