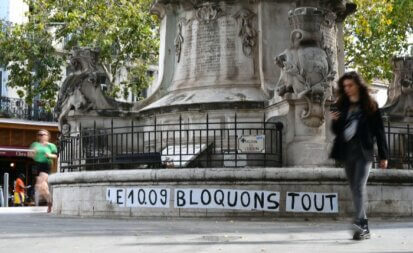Le management est partout, et depuis l’avènement du néolibéralisme, il s’est implanté de façon parfois brutale dans l’ensemble de la société. Dans les entreprises, bien sûr, où les méthodes de management imposent leurs cadres, parfois aux dépens des réalités du travail vivant. Mais le management a également contaminé la société, en s’important dans les politiques publiques, dans les services publics, dans la vie quotidienne : tout doit désormais être “géré”, “managé”. Symbole de cette “hégémonie de la gestion” comme l’appelle la sociologue du travail managérial et professeure à l’Université Paris Cité, Marie-Anne Dujarier : l’émergence des personnalités issues du monde de l’entreprise comme figures politiques, “gérant” la société comme on gère un business ou une start-up, à l’image de Donald Trump, Elon Musk, ou même Emmanuel Macron.
Mais derrière le constat de cette omniprésence, c’est une évolution structurelle du corps social qui se dessine en creux, comme le montrent de plus en plus de scientifiques. “La sociologie politique a une longue lignée de travaux autour de la théorie du débordement (ou spillover), qui montrent que les rapports sociaux au sein de l’économie débordent dans la société, et façonnent des comportements, des normes politiques et sociales”, explique ainsi Thomas Coutrot, chercheur associé à l’Institut de recherche économique et sociale (Ires). Au point que certains voient dans la contamination des méthodes managériales, souvent brutales, l’une des causes des crises sociales et politiques que traversent les sociétés contemporaines.
Services publics sacrifiés
Pour Ibrahima Fall, docteur en sciences de gestion, président du cabinet Hommes et Décisions et de l’Institut du Travail Réel, cette hégémonie de la gestion, qui trouve son auto-justification dans la recherche d’efficacité et d’optimisation, a ainsi des conséquences majeures sur le plan social. “Lorsque l’on gère un service public ou une politique publique comme une entreprise, en cherchant à maximiser les gains en minimisant les coûts, on tend à réduire la notion d’efficacité à ce qui est visible et facilement mesurable : le profit, la rentabilité“, explique Ibrahima Fall. “En contrepartie, on néglige ce qui ne se mesure pas facilement, comme les dimensions humaines, sociales, écologiques… “, poursuit le spécialiste. Or, la société est désormais traversée de ces débats où, pour des raisons d’efficacité managériale, certains expliquent qu’il faudrait “réduire”, ou “supprimer” telle ou telle disposition, tel service, telle dépense.
Les débats récurrents autour du coût supposément trop élevé des agences de l’Etat en matière de protection sanitaire ou environnementale, comme l’ADEME (Agence de la Transition écologique) ou l’OFB (Office Français de la Biodiversité), ou des dépenses liées aux aides sociales, illustrent ainsi la tension créée par l’illusion managériale. Sous prétexte d’efficacité, on cherche à réduire les coûts, mais en sacrifiant des services publics entiers, sans que les dommages collatéraux et le coût “extra-financier” n’en soient réellement mesurés.
“Par exemple, lorsqu’Elon Musk met par terre l’USAID (Agence des États-Unis pour le développement international, qui contribue notamment à l’aide humanitaire mondiale, ndlr), à court terme il récupère des milliards, mais à long terme les Etats-Unis risquent d’y perdre beaucoup : c’est le soft power américain qui disparaît, c’est une hausse des impacts sociaux, des coûts sanitaires, ou de ceux liés à l’immigration forcée…”, explique le chercheur. Les mêmes logiques s’appliquent à l’hôpital, dans l’enseignement ou la protection de l’environnement, qui sont ainsi progressivement soumis à des logiques budgétaires qui les empêchent de remplir leurs missions premières d’intérêt général. “On observe une extension des logiques propres aux entreprises capitalistes, qui cherchent à accroître les profits, souvent quel que soit le coût écologique, humain et social, au domaine public”, ajoute Marie-Anne Dujarier.
Une usure du corps social
Or cette logique, finit par créer “une véritable usure du corps social”, comme l’explique Thomas Coutrot. Pour Marie-Anne Dujarier, “à force de voir toute la société évaluée au filtre des résultats chiffrés, les individus éprouvent plus que jamais ce que c’est que d’être traité comme une “ressource humaine” à optimiser.” La crise de la santé mentale observée dans le monde du travail ne dit pas autre chose : de plus en plus de travailleurs disent perdre le sens de leur travail, ne plus se sentir utiles, ne plus se sentir considérés. Ils vivent aussi, en tant que citoyen, la détérioration de leurs conditions de vie. “La gestion austéritaire de la société provoque évidemment une forme de précarisation généralisée, une stagnation ou une dégradation des revenus ou des conditions d’existence, pour les travailleurs mais aussi pour l’ensemble des citoyens”, ajoute Thomas Coutrot.
La dégradation des services publics, et le sentiment d’abandon dans une société où tout est fait pour maximiser le PIB, contribuent ainsi à alimenter un sentiment de perte de confiance, et de perte de sens. Quelques chiffres permettent de saisir l’ampleur de cette usure. Selon un récent sondage Odoxa, 83% des citoyens disent ne plus avoir confiance dans l’avenir économique, et beaucoup craignent un déclassement général : près de deux Français sur trois pensent que leurs enfants vivront moins bien qu’eux. Six Français sur dix disent ne pas être satisfaits de leurs services publics selon une étude réalisée par Opinion Way pour Le Sens du Service Public.
“On a voulu gérer les nations et les sociétés comme des entreprises, ce qui est une aberration. Contrairement aux entreprises qui doivent simplement maximiser les dividendes des actionnaires, la vie sociale est un but en soi. Elle implique pour les gouvernants de trouver des compromis entre des intérêts divergents et de faire des médiations fines pour que le tissus social tienne”, analyse Marie-Anne Dujarier. Or à force de négliger ces dimensions sociales et humaines, et de donner aux citoyens le sentiment d’être en permanence exposé à un management déconnecté, parfois violent, que ce soit dans le travail ou dans la vie sociale, ce système alimente une forme de colère sociale, qui fait le lit des populismes, et notamment de l’extrême droite. “Les études statistiques montrent que les citoyens qui sont le plus exposés au mépris, au travail ou en dehors, votent plus à l’extrême droite”, constate Thomas Coutrot. “Lorsque l’on est en permanence soumis à une hiérarchie pesante, à un déni de ses compétences, de son autonomie, de sa personnalité, on développe des traits et une culture politique de soumission, de passivité, qui s’articule avec le vote autoritaire”, ajoute l’expert.
Rhétorique autoritaire, déconsolidation démocratique
L’hégémonie du management comme mode de fonctionnement social alimente aussi un imaginaire politique autoritaire. La culture managériale est ainsi imprégnée des notions de “leadership”, où l’on vante le caractère “charismatique” des gestionnaires. La figure mystifiée de l’entrepreneur, présenté comme un génie inspirant, capable d’imposer ses idées, parfois radicales mais toujours au nom de l’efficacité et de la performance, contribue, comme l’ont montré les travaux de l’historien Anthony Galluzzo, à légitimer un ordre politique fondé sur le conservatisme méritocratique et sur l’autorité. Plus d’autorité pour plus d’efficacité, quitte même à sacrifier la démocratie ? Près d’un Français sur deux estime en tout cas qu’“en démocratie rien n’avance, il vaudrait mieux moins de démocratie mais plus d’efficacité”, selon un sondage publié en février dernier par OpinionWay pour le Cevipof (Centre de recherches politiques de Sciences Po).
Musk, Milei, Trump : comment les dérives d’un management violent contaminent la société
Ce phénomène alarmant de crise de confiance dans la démocratie n’est pas spécifiquement français, puisque les historiens Roberto Stefan Foa et Yascha Mounk, auteurs de plusieurs travaux de recherche sur le sujet, montrent que dans de nombreuses démocraties modernes dans le monde, on observe une même dynamique de “déconsolidation démocratique”. Autrement dit, les indicateurs de soutien à la démocratie diminuent, la confiance dans les systèmes démocratiques s’affaisse, ce qui alimente la montée des populismes. C’est tout le paradoxe : l’obsession managériale participe à transformer la vie démocratique en une accumulation de problèmes technocratiques à “gérer”, et alimente le sentiment de “déconnexion” du personnel politique.
En retour, les citoyens se tournent vers des populismes encore plus radicaux, plus autoritaires, supposément plus “efficaces”. Des populismes dont Donald Trump, gestionnaire et businessman par excellence, est l’incarnation. “La force de ces figures et de réussir à détourner l’attention, à trouver des bouc émissaires, tout en surfant sur les malheurs qu’ils ont eux-même provoqués”, conclut Thomas Coutrot. Et le paradigme gestionnaire en continuant d’ignorer les causes profondes de ces malheurs, et notamment leurs dimensions humaines et sociales, ne fait que les renforcer. Au point que la colère, la frustration et la désespérance semblent aujourd’hui au cœur d’une crise sociale et politique si profonde, qu’on ne sait désormais plus si elle pourra être “gérée”.