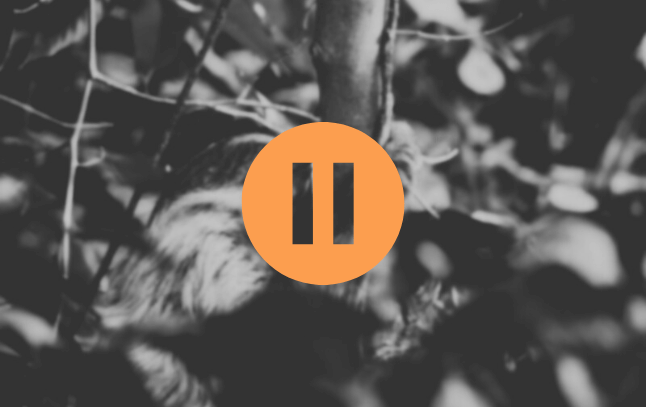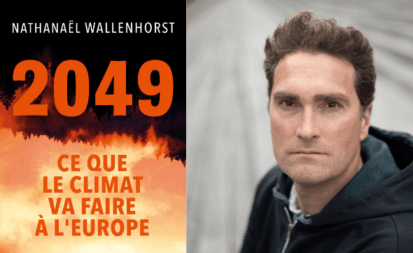Un million d’espèces sont menacées de disparaître à tout jamais. Si bien que de nombreux scientifiques assurent que nous sommes entrés dans la 6e extinction. Mais la tendance peut encore être inversée. Il “suffirait” pour cela de sanctuariser d’ici 5 ans 164 millions d’hectares, soit “seulement” 1,22% de la surface terrestre de la planète. C’est la proposition faite par un consortium de chercheurs piloté par l’ONG Resolve, dans un article publié dans la revue Frontiers in Science en juin dernier.
A deux mois de la prochaine conférence mondiale sur la biodiversité (COP16), qui doit s’ouvrir le 21 octobre prochain à Cali, en Colombie, cette nouvelle étude définit des zones prioritaires à protéger afin d’atteindre l’objectif “30×30”, qui vise à protéger au moins 30% de la planète d’ici à 2030. “Nous sommes au milieu de la sixième crise d’extinction, mais la première provoquée par l’Homme. Or nous disposons des données nécessaires pour évaluer ce qui devrait être fait pour en sortir”, explique le Dr Eric Dinerstein, de l’ONG Resolve et auteur principal de l’article.
En 2020 déjà, Eric Dinerstein et son équipe de recherche avaient estimé la superficie globale à protéger à 2,3%. Un chiffre depuis revu à la baisse, principalement en raison de l’affinage des “outils de télédétection”, rapporte le scientifique.
Les tropiques, une zone cruciale à protéger
De l’Argentine à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 16 825 sites ne bénéficiant d’aucun statut de protection ont été identifiés comme prioritaires en matière de conservation au cours de ces cinq prochaines années pour éviter l’extinction imminente de certaines espèces. “La grande majorité de ces zones se trouvent au niveau des tropiques”, détaille le Dr Eric Dinerstein. Et cinq pays concentrent plus de la moitié de ces sites. Il s’agit du Brésil, des Philippines, de l’Indonésie, de Madagascar et de la Colombie.
Ces sites prioritaires abritent à eux seuls plus de 4 700 espèces menacées. “La plupart des espèces sur Terre sont rares, ce qui signifie que les espèces ont soit une aire de répartition très restreinte, soit une densité très faible, soit les deux”, explique le Dr Eric Dinerstein. Autrement dit : “La rareté est très concentrée géographiquement”.
Parmi ces espèces en danger, on retrouve notamment les macaques noirs à crête des îles de Sulawesi en Indonésie, la tortue des Galapagos, le buffle nain Tamarau, ou encore la Gallicolombe poignardée des Philippines, mais également certaines plantes carnivores comme la Sarracénie pourpre en Inde.
Moins de 0,2% du PIB des Etats-Unis
Selon les calculs de l’équipe de recherche, la protection de ces zones, via une politique d’acquisition foncière, pourrait coûter 34 milliards de dollars (31,7 milliards d’euros) par an au cours des cinq prochaines années. “Cela représente moins de 0,2% du PIB des Etats-Unis, moins de 9% des subventions annuelles accordées à l’industrie mondiale des combustibles fossiles, et une fraction des revenus générés chaque année par les industries minières et agroforestières”, compare Andy Lee, co-auteur de l’étude et chercheur au sein de l’ONG Resolve.
Un investissement d’autant plus accessible que 38% des sites identifiés sont localisés en bordure ou à moins de 2,5 kilomètres d’une aire protégée existante. Cette proximité permet, pour cette équipe de recherche, d’envisager une intégration rapide de ces nombreux sites aux aires déjà protégées, et de réduire ainsi “considérablement les coûts d’acquisitions des terres”.
Toutefois, il ne faut pas oublier que se limiter à protéger 1,2% de planète est très insuffisant, et que cela “ne doit pas être un alibi pour ne rien faire ailleurs”, avertit auprès de Novethic le naturaliste Bruno David et auteur d'”A l’aube de la 6e extinction. Comment habiter la Terre” (Grasset 2021). Pour l’ancien président du Museum national d’histoire naturelle, “nous ne sommes rien sans cette biodiversité”. “S’en préoccuper aujourd’hui, c’est surtout nous préoccuper de nous-même car dans les crises du passé géologique de la Terre, ce sont les espèces les plus complexes qui ont disparu en premier” rappelle-t-il. Le seuil de 1,2% doit donc être considéré comme un plancher.