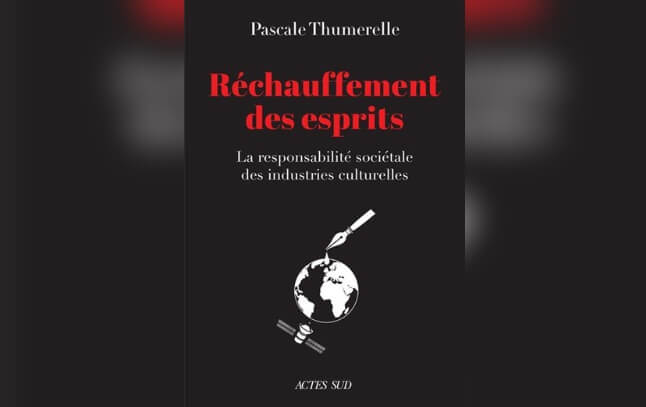Directrice de la RSE de Vivendi de 2001 à 2017, Pascale Thumerelle a vécu de l’intérieur les conséquences de la prise de pouvoir du groupe par Vincent Bolloré et l’influence que cela a eu sur les contenus diffusés par Canal Plus et ses filiales, en France et à l’international, particulièrement en Afrique. Fondatrice de Respethica, un cabinet de conseil sur la responsabilité sociétale et la création de valeur durable, enseignante à l’ESCP Business School et à Sciences Po, membre du Forum pour l’Investissement Responsable, elle vient d’écrire un livre aux éditions Actes Sud* pour alerter sur la nécessité d’exiger des politiques RSE spécifiques pour l’industrie culturelle, sous peine sinon de renforcer les menaces qui pèsent sur la démocratie.
Qu’est-ce qui vous a inspiré l’idée de ce livre et quels sont les manques de la RSE dans les industries culturelles ?
En ayant piloté la RSE d’une multinationale des industries culturelles pendant 15 ans, j’ai observé de près l’évolution des exigences et des opportunités qui lui sont liées. Elle est une ressource essentielle pour mobiliser l’ensemble de ses parties prenantes. Or, ce levier de questionnement et d’interpellation est méconnu ou trop faiblement activé dans les industries culturelles (médias, livres, films, musique, jeux vidéo, spectacles vivants…). Pourtant elles comptent parmi les plus grandes capitalisations boursières internationales, américaines (Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta) ou chinoises (Tencent). Les groupes européens sont de taille plus modestes (Bertelsmann, Spotify, Telefonica, Mediaset, The Guardian, TF1, Vivendi, Ubisoft, groupe Ouest-France…) mais le secteur est très puissant en termes de chiffre d’affaires et de création d’emplois. Pourtant, il est peu interrogé sur son impact sociétal. Il doit répondre de son empreinte carbone plutôt que de son empreinte cérébrale.
L’”empreinte cérébrale” désigne l’influence exercée sur nos esprits par celles et ceux qui créent
Pouvez-vous nous expliquer le concept d’empreinte cérébrale ?
L’”empreinte cérébrale” désigne l’influence exercée sur nos esprits par celles et ceux qui créent, produisent et distribuent des biens ou des services culturels. Cette empreinte, susceptible d’affecter des milliards de personnes, peut contribuer au bien commun en aiguisant notre besoin d’émerveillement, notre envie de divertissement, notre faculté à penser, notre capacité à agir. Mais elle peut aussi l’affecter. Des entreprises recourent à la désinformation, à l’exploitation des cerveaux des enfants et des adolescents, à la représentation stéréotypée des femmes ou à la mise en danger de la diversité des expressions artistiques.
Comment se caractérise son évolution en France et plus globalement en Europe ces dix dernières années où se sont multipliés les canaux de diffusion (réseaux sociaux, chaines You Tube and co…)
Si ces atteintes au bien commun ne datent pas du XXIème siècle, il est certain que les réseaux sociaux les ont exacerbées. Selon une étude de la Commission européenne, 83% des Européens pensent que la désinformation menace la démocratie, 63% des plus jeunes d’entre eux déclarent y être confrontés plus d’une fois par semaine. L’appel lancé aux médias en 1995 lors de la Conférence mondiale des femmes sous l’égide de l’ONU, pour mettre un terme à la diffusion d’images négatives ou dégradantes des femmes, a eu peu d’écho. Ces images prévalent encore sur la majeure partie des vidéos, des clips musicaux, hébergés sur la plateforme Youtube.
Les entreprises qui investissent en ce sens vivifient l’épanouissement des individus
Pensez-vous que la diversité culturelle est en danger et quelles en sont les conséquences pour la démocratie ?
La diversité culturelle, comme le rappelle l’Unesco, est un ressort du développement durable au bénéfice des générations présentes et futures. L’accès et la participation à la vie culturelle influencent les comportements civiques et démocratiques. Dans des sociétés de plus en plus fragmentées, divisées en “communautés” et exposées à la distorsion des faits ou à des propos xénophobes, répandus par les réseaux sociaux ou les médias attiseurs de haine, l’enjeu de la diversité des récits, des imaginaires, des idées, devient primordial. Les entreprises qui investissent en ce sens vivifient l’épanouissement des individus et revigorent l’harmonie des ensembles de sensibilités, indispensables à une véritable démocratie.
Quelles sont les pistes que vous proposez pour intégrer des exigences RSE spécifiques à l’industrie culturelle ?
Je propose plusieurs pistes d’action pour renforcer la mobilisation des entreprises, des ONG, de la communauté financière, des pouvoirs publics. Les enjeux RSE de ces industries sont directement liés aux droits humains. Les investisseurs responsables ont un rôle de premier plan. L’engagement actionnarial leur permettrait de questionner le secteur sur la rémunération des créateurs et créatrices précarisés par les plateformes de streaming, l’accessibilité à leurs contenus (un tiers de la population n’a jamais utilisé Internet) et à une information de qualité, les moyens engagés contre les discours de haine qui sapent le vivre-ensemble, leur détermination à prévenir le mal-être des mineurs (un internaute sur trois a moins de 18 ans). Il faudrait demander aux investisseurs responsables comment ils accompagnent les entreprises culturelles qui favorisent la constitution de “sociétés inclusives et durables” et équipent les citoyens de boussoles pour naviguer au mieux dans ce déferlement de contenus et d’usages.
* “Réchauffement des esprits : la responsabilité societale des industries culturelles”, de Pascale Thumerelle, éditions Actes Sud, janvier 2024.