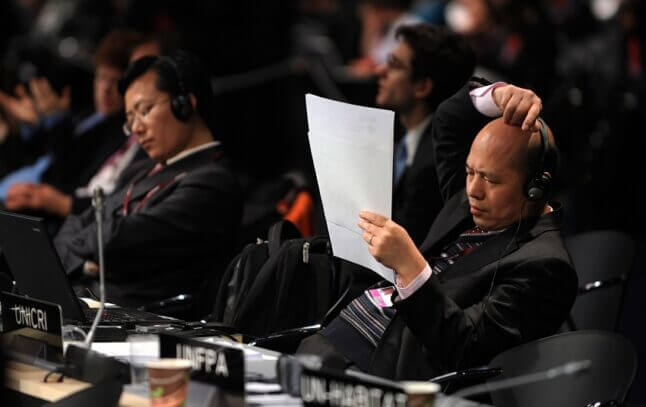"Les négociations de l’ONU sont totalement inadaptées à l’urgence climatique". C’est la phrase choc lancée début juin par Ségolène Royal, dans une interview au Monde, alors que s’ouvrait une nouvelle session de travail à Bonn en vue de la COP21. "En privé, tout le monde le dit, tout le monde en est parfaitement conscient, mais la lourdeur du processus est telle qu’il se poursuit comme si de rien n’était. (…) J’ai l’impression que l’on remet chaque fois à l’année suivante les décisions à prendre". La ministre de l’Ecologie oserait-elle dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas ? Les négociations climatiques, menées depuis 20 ans, ne servent-elles donc à rien ?
La COP21, la 21e conférence des parties, organisée au Bourget, du 30 novembre au 11 décembre, va rassembler les 196 parties (195 pays + l’Union européenne) ayant à l’heure actuelle ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Une convention adoptée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, là où débute l’histoire des négociations climatiques internationales.
Le sommet de Rio
1992, sommet de Rio. Deux ans auparavant, le désormais célèbre GIEC, groupe d’experts intergouvernemental sur le climat, avait publié son premier rapport d’évaluation dans lequel il confirme que les activités humaines ont perturbé le climat mondial et que le changement climatique en cours risque de provoquer des dommages considérables.
Ce sommet permet d’impulser la mise en place d’une gouvernance onusienne sur le climat acceptée de tous. A l’époque, 154 Etats et les membres de l’Union européenne signent la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Un succès salué par les observateurs du monde entier. Deux autres conventions, l’une sur la diversité biologique et l’autre sur la désertification sont alors également adoptées. Elles seront moins médiatisées.
Ce n’est que deux ans plus tard, en mars 1994, que la CCNUCC entre en vigueur. Elle est régie par deux principes essentiels : l’égalité – chaque pays équivaut à une voix – et la responsabilité commune différenciée qui classe déjà les pays en deux groupes. D’une part, les pays développés, historiquement responsables des émissions de gaz à effet de serre, et d’autre part, les pays en développement, dont les grands pays émergents d’aujourd’hui (Chine, Brésil ou Inde). La CCNUCC crée aussi les Conférences des Parties, les fameuses COP. La première se tiendra en 1995 à Berlin, c’est la COP1. Sa mission : aboutir à un accord sur le climat d’ici 1997. Déjà, le caractère contraignant des engagements de chacun fait l’objet de discussions houleuses.
De Rio au protocole de Kyoto
Cet accord prendra le nom de protocole de Kyoto. Il est adopté le 11 décembre 1997 au cours de la COP3, qui se tient au Japon. Il concerne 37 pays développés. Son objectif est précis : réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2 % entre 2008 et 2012 par rapport à 1990. Pour aider ces pays à y parvenir, le protocole introduit trois mécanismes de flexibilité : le mécanisme de développement propre (MDP), la mise en œuvre conjointe (MOC) et l’échange d’émissions, qui donnera lieu au marché carbone européen.
Le protocole de Kyoto n’entrera pourtant en vigueur que … le 16 février 2005. Soit plus de sept ans après son adoption! Car entretemps, les Etats-Unis par la voix de leur nouveau président, Georges W. Bush, se sont retirés, poussés par le Sénat qui s’était opposé au protocole en raison de l’absence de réduction des émissions par les pays émergents. Ce n’est qu’avec la ratification russe, en 2004, que le protocole de Kyoto peut enfin devenir opérationnel. Car avec cette adhésion, réalisée après des années d’hésitations par le président russe Vladimir Poutine, le quorum nécessaire de la moitié des émissions (55 % au final) de 1990 est enfin atteint.
Dès 2007, il faut pourtant se poser -déjà- la question de l’après-Kyoto, au-delà de 2012… A Bali, lors de la COP13, une "feuille de route" est donc adoptée avec comme objectif de parvenir à un nouveau protocole en 2009, à Copenhague. Cette année-là, pour la première fois, les pays en développement et les émergents, de plus en plus conscients qu’ils seront les premières victimes du changement climatique, acceptent de participer à l’effort. Trois des quatre piliers de la feuille de route de Bali – atténuation, adaptation, transfert technologique et financements – les concernent ainsi directement.
L’échec de Copenhague
Deux ans plus tard, la ferveur qui entoure la COP15, organisée à Copenhague, au Danemark, est telle qu’elle plongera les observateurs dans une profonde gueule de bois à l’issue des négociations. Le retour en force des Etats-Unis, représentés par le charismatique nouveau président, Barack Obama, change la donne d’un processus jusque-là dominée par l’Union européenne et sa volonté de mettre en place des engagements contraignants. Avec la Chine, ils formeront un G2 qui mènera les négociations.
L’accord de Copenhague, obtenu à l’arrachée par une âpre nuit de négociations entre quelques pas seulement, n’est porté que par un groupe d’une trentaine de pays, emmenés donc par les Etats-Unis et la Chine, ralliés par l’Inde. Les Européens sont laissés à l’écart. "Cela traduit bien le nouvel ordre géopolitique mondial qui prévaut depuis la crise de 2008-2009", estime Amy Dahan, mathématicienne et historienne des sciences, co-auteure de Gouverner le Climat. Quels futurs possibles ? Vingt années de négociations internationales (1). Le texte de Copenhague est finalement rejeté par l’assemblée des Parties qui en "prend note" mais ne l’adopte pas. Pour la spécialiste des négociations, "le schisme entre la réalité du monde et la pratique de gouvernance climatique est alors à son comble".
Pourtant, Copenhague aura tout de même permis quelques avancées. C’est ainsi la première fois que l’objectif de 2°C de réchauffement global d’ici 2100 est reconnu. Pour la première fois aussi les pays du Sud acceptent de s’engager dans la réduction des émissions en échange d’une promesse des pays du Nord de leur verser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour les aider dans la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique. Pour permettre de canaliser les financements des pays développés vers des projets d’adaptation et d’atténuation dans les pays en développement, un Fonds vert pour le climat est lancé.
De Copenhague à Paris
L’échéance de l’accord est repoussée mais son principe est maintenu. Le nouveau cap est fixé à 2015, lors de la COP21, dont on ne sait pas encore qu’elle se passera en France. A Durban, en Afrique du Sud, en 2011, alors que la conférence a failli capoter plusieurs fois, les Parties se mettent d’accord pour établir un nouveau groupe de travail appelé "la plateforme de Durban" ou ADP. Sa mission : rédiger un nouvel accord dont la mise en œuvre est prévue pour 2020. Un accord applicable à tous et prenant la forme d’un protocole, d’un instrument juridique ou d’un accord avec force de loi universel. Quelques jours plus tard, le Canada annonce qu’il se retire du protocole de Kyoto.
Ce protocole est amendé un an plus tard, lors de la COP de Doha, au Qatar. S’ouvre alors une seconde période d’engagement qui va de 2013 à 2020 (Kyoto II). Le Japon et la Nouvelle-Zélande ont déjà fait savoir qu’ils n’y participeraient pas. Au total, seulement 36 pays, parmi lesquels les 27 membres de l’UE, s’engagent sur un objectif de réduction des émissions de 18 % par rapport à 1990. Seulement, ils ne représentent plus que 15 % des émissions mondiales. Les Etats-Unis et la Chine, les deux plus gros émetteurs, n’en font pas partie.
En 2013, dans une conférence de Varsovie chahutée par les ONG qui dénoncent l’omniprésence des lobbys du charbon, le principe des INDC (Intended Nationally Determined), les contributions climatiques que chaque pays doit soumettre avant la conférence de Paris est mis sur la table. La COP19 entérine ainsi le principe de "bottom up", soit une négociation partant de la base vers le haut, considéré comme plus réaliste par rapport aux objectifs imposés du protocole de Kyoto. Mais sera-t-il plus efficace ? Le bilan des contributions publiées par près de 80 % des pays au 1er novembre 2015 montre la limite du système. Elles nous mènent à un réchauffement de près de 3°C.
Vers un accord post-Kyoto à la COP21 ?
La dernière conférence avant Paris s’est tenue à Lima au Pérou, en décembre 2014. Elle a accouché d’un texte de 37 projets, brouillon du futur accord. Toute l’année, quatre réunions techniques ont eu lieu à Genève puis à Bonn pour le retravailler et tenter de trouver un consensus. Au cours de la dernière session de travail, fin octobre, les délégués des 195 pays se sont accordés sur un nouveau texte long de 54 pages aux options encore trop nombreuses pour le rendre cohérent. Les représentants politiques sont désormais au pied du mur. Malgré la multiplication de réunions informelles auxquelles ont été conviés tout au long de l’année les ministres des principaux pays en charge du climat, il restera beaucoup (trop?) à faire pendant les deux semaines de la COP21, à Paris.
Pour la spécialiste des négociations, Amy Dahan, ce processus est une "fabrique de la lenteur" alors que les émissions de gaz à effet de serre explosent. Elle dénonce l’enclavement de la gouvernance onusienne qui devrait "s’attaquer aux modes de développement économique, aux règles du commerce international ou au fonctionnement du système énergétique mondial" au lieu "de cibler les émissions de CO2". "La gouvernance climatique est aujourd’hui au point mort : le climat ne sera pas ‘sauvé’ sans que les acteurs concernés s’attaquent aux institutions qui orchestrent la mondialisation économique et financière et prennent chaque jour des décisions contraires aux politiques climatiques souhaitables".
Christiana Figueres, la secrétaire exécutive de la CCNUCC, interviewée dans Libération, estime quant à elle que des progrès certes "lents mais très, très solides" ont été réalisés dans les négociations climatiques depuis leur début il y a vingt ans.
(1) Gouverner le Climat. Quels futurs possibles ? Vingt années de négociations internationales, Amy Dahan et Stefan Aykut, Paris, Presses de Sciences Po, 2015, 753 pages.