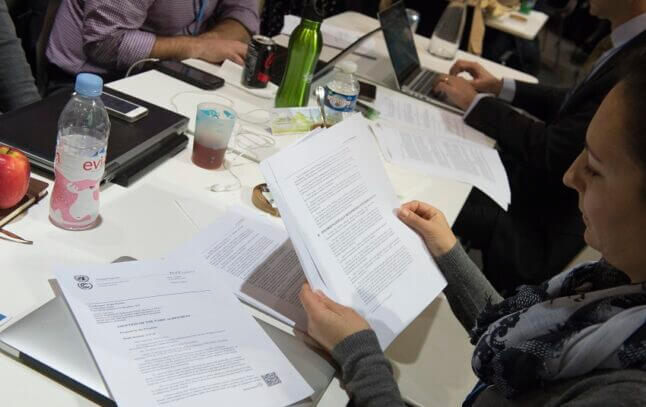Après 13 longs jours - et quelques nuits - de négociations, le projet d'accord de Paris a été présenté samedi midi puis adopté dans la soirée. L'accord (dont on trouve ici la traduction française) comporte de nombreuses avancées et quelques déceptions. Mais il constitue une avancée inédite en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Il comporte notamment de nombreux points contraignants pour les Etats, notamment dans la partie finance, et est applicable à tous. Une première dans l'histoire des négociations climatiques. Novethic décrypte ce texte long de 31 pages.
Les ambitions
L'ambition du projet de l'accord de Paris a été relevée à la fin de la COP sous la pression des pays en développement et d'une nouvelle coalition, celle dite des pays les plus ambitieux. Cette dernière, qui a pris corps au cours de ces deux semaines de négociations, regroupe 80 pays : des pays en développement, principalement d'Afrique et des Caraïbes, et des pays développés comme l'Union européenne, la Norvège, la Suisse ou les Etats-Unis. Mais aussi le Brésil, seul pays émergent à en faire partie.
Il s'agit désormais de limiter la hausse de la température globale à "bien moins de 2°C" d'ici 2100 et à poursuivre les efforts en direction des 1,5 °C. Pour ce faire, aucune réduction chiffrée des émissions de gaz à effet de serre n'est mentionnée. Le terme de neutralité climatique, trop flou, a disparu au profit de termes plus scientifiques qui renvoient aux travaux du GIEC : "l'équilibre entre les émissions anthropiques et les capacités d'absorption naturelles de la planète, donnant ainsi un rôle aux puits de carbone que sont les forêts". Et ce dans la seconde partie du siècle.
L'absence de cible chiffrée ne constitue pas forcément un handicap majeur selon Matthieu Orphelin, le porte-parole de la fondation Nicolas Hulot. Car "si l'on suit les rapports du GIEC, une cible de 1,5°C, cela veut dire une réduction des émissions de GES de 70 à 80 % d'ici la deuxième moitié du siècle". Et zéro émission en 2100, au plus tard.
Les financements
Le texte final de l’accord prévoit bien un article exclusivement consacré au mécanisme des pertes et dommages (art. 8). Une victoire pour les pays les moins développés et les petits Etats insulaires qui en ont fait leur cheval de bataille depuis les conférences préparatoires de Bonn (Allemagne). Il détaille les mesures concrètes à fournir par les pays développés pour soutenir ces pays économiquement et climatiquement vulnérables. Fortement impactés par les effets du réchauffement climatique (montée du niveau de la mer, sécheresse, tempêtes, etc.), ils voient leur développement gravement entravé. Mais au-delà de la reconnaissance symbolique, ce paragraphe s'appuie surtout sur le mécanisme mis en place lors de la Conférence de Varsovie en 2011. Il exclut également tout ce qui concerne une "responsabilité ou indemnisation" de la part des pays développés.
En ce qui concerne la finance proprement dite (art. 9), le document stipule que les pays développés "doivent" assister financièrement les pays en développement tant au niveau de l’adaptation au réchauffement climatique qu’à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, qui suppose l’expansion notamment des énergies renouvelables.
L'accord mentionne l'importance des ressources publiques et des dons, mais leur part n'est pas précisée.
Le deuxième paragraphe est destiné aux pays encore catégorisés en développement par la classification onusienne : les pays pétroliers, l’Arabie Saoudite en tête, alors que certains disposent d’un PIB plus élevé que des pays européens comme le Portugal ou la Grèce. Il est mentionné que les pays en développement qui en ont la capacité sont encouragés à contribuer au financement. Une disposition légale poussée, entre autres, par les Etats-Unis qui sont venus à Paris pour élargir l’assiette des contributeurs.
Les fameux 100 milliards de dollars par an promis à Copenhague par les pays développés pour la transition énergétique des pays du Sud restent bien une somme plancher. En revanche, ce paragraphe sort de l’accord pour entrer dans la partie décision de la COP. Une manoeuvre diplomatique destinée à permettre la ratification de l’accord par les Etats-Unis sans l’obliger à passer par le Congrès à majorité républicaine - et donc largement climato-sceptique. Mais qui en affaiblit la portée, comme s'en inquiètent les ONG telle qu'Oxfam. Ce montant devrait être révisé en 2025.
Les mécanismes de révision et de transparence
Autre avancée majeure de l'accord, la mise en place d'une nouvelle version des mécanismes de révision et de transparence pour les contributions climatiques nationales, les fameuses INDC. L'article 4, paragraphe 9, acte un processus de révision à la hausse tous les 5 ans pour toutes les Parties.
Un premier rendez-vous est prévu en 2018 dans les décisions (Décision de la COP) qui accompagnent l'Accord de Paris. Il s'agit d'un "dialogue de facilitation entre les Parties" sur les efforts déjà entrepris et leurs futurs engagements. Les Etats qui n'ont pris des engagements que jusqu'en 2025, comme les Etats-Unis par exemple, sont incités à les actualiser à ce moment là.
Un premier bilan global des impacts de ces contributions sera effectué en 2023. "L'objectif n'est pas de pointer du doigt tel ou tel Etat mais d'informer les pays sur l'état des lieux de l'action globale", explique Michel Colombier, de l'IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales).
Ce processus est "une architecture incroyablement forte", selon Michael Jacobs, ancien bras droit du Premier ministre britannique, Gordon Brown. Il met en avant sa transparence : "le texte prévoit un cadre unique, juridiquement contraignant et commun à tous les pays". Si les experts et les ONG saluent ce mécanisme de révision, les dates de la première révision et du premier bilan sont quant à elles jugées trop tardives par les ONG à l'instar de la Fondation Nicolas Hulot (FNH) qui demande à la coalition des "pays les plus ambitieux de décider volontairement de réviser leurs engagements avant 2020".
La façon dont les pays en développement seront concernés par ces dispositions reste à préciser dans les COP futures. Ceux-ci devront en effet bénéficier d'un appui pour la préparation de ces rapports. Les pays les moins avancés ainsi que les Etats insulaires en développement disposeront aussi d'une certaine flexibilité.
Les manques
Cependant, certains éléments sont absents du texte ou ont été édulcorés. C’est le cas de la mention "droits humains" qui a été supprimée de l’article 2 de l’accord de Paris qui définissait l’objectif général de la COP. Trois pays notamment, les Etats-Unis, la Norvège et l’Arabie Saoudite ont poussé pour que la mention soit reléguée dans la partie "décision" de la COP, en préambule de l’accord. "Cette question devait pourtant conditionner toute action engagée pour lutter contre les dérèglements climatiques, regrette Anne-Laure Sablé, chargée de plaidoyer au CCFD-Terre solidaire. Comment peut-on aujourd’hui parler de justice climatique ?", comme l'a fait Laurent Fabius lors de la présentation du texte samedi matin.
Le même sort a été réservé à la mise en place d’une tarification carbone, demande largement portée par le monde des affaires. Sa mention a purement et simplement disparu dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 décembre, pour apparaître elle aussi dans la "décision" de la COP. Et de façon très édulcorée. L'Arabie Saoudite et le Venezuela avaient pourtant été les seuls pays à tiquer sur la mention de cet outil dans l'accord.
Les négociateurs ont également reculé sur l’intégration des secteurs du transport international maritime et aérien. Le paragraphe optionnel a été supprimé et n’a jamais pu être réintégré malgré l’impulsion essentiellement portée par l’Union européenne en fin de négociations. Ces deux secteurs représentent à eux seuls 8% des émissions de gaz à effet de serre mais ils pourraient passer à un tiers d’ici 2050, selon la Commission européenne. Pour certains experts cependant, l'accord, qui est destiné aux États, n'est peut-être pas le meilleur endroit pour inscrire ces émissions, par essence internationales. D'autant qu'il aurait sans doute fallu faire des concessions sur un autre point pour contrebalancer celui-ci.
Enfin, si les syndicats n’ont eu de cesse de revendiquer la prise en compte de la dimension sociale du changement climatique sous le terme de "transition juste", celui-ci n’a pas été inséré dans le texte de l’article 2 de l’accord, comme ils le souhaitaient, mais il est affirmé dans le préambule. Pour la Confédération syndicale internationale, il s’agit tout de même là d’un "point d’appui pour elle afin de renforcer son action". Sa secrétaire générale, Sharan Burrow, a ainsi affirmé que les syndicats allaient maintenant agir dans chaque pays pour que les politiques de décarbonation et de transition énergétique assurent une transition juste pour tous : "personne ne doit rester en marge de ce qui est une course contre le temps."
Par ailleurs, l'Afrique a été oubliée du paragraphe des financements sur l'adaptation. Y sont clairement mentionnés comme bénéficiaires les pays les moins avancés et les petites îles en développement mais pas le continent africain. Un manque relevé juste avant l'adoption du texte.
Le statut juridique
L’accord a été présenté par Laurent Fabius comme "juridiquement contraignant". Mais qu’en est-il vraiment ? Les Nations-Unies n'ont aucun pouvoir de sanction. Rien n’est donc prévu en cas d’infraction, ce qui affaiblit la portée de la contrainte juridique. Mais en tant que protocole additionnel à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, l’accord a de fait une valeur de traité international.
Par ailleurs, plusieurs dispositions dans le texte sont contraignantes et inscrites comme telles avec les fameux "shall" ou "devront" en bon français, qui jalonnent le texte. Mais là encore tout est dans la nuance. Prenons le cas des contributions nationales des Etats (INDC) : tous les Etats devront en produire une et la réviser –à la hausse- tous les 5 ans. Cependant, leurs engagements en tant que tels ne sont eux, pas contraignants.
La contrainte vient donc en fait plutôt du risque de réputation qui pèse sur les Etats signataires mais qui ne respecteraient pas les dispositions de l’accord. C’est ce qui fait dire à l’avocat spécialiste de l’environnement que l'accord est "politiquement contraignant". A la société civile aussi de faire pression sur les Etats pour l’application de cet accord et pour que les Etats relèvent leur ambition, dans un esprit de "Name and Shame" montrant du doigt les pays les moins vertueux. C’est notamment tout l’intérêt des mécanismes de transparence et de révision qui permettront un certain contrôle. (Voir à ce propos les travaux de la Commission environnement du Club des juristes)
La mise en application
L'entrée en vigueur de l'accord n'est pas immédiate. Et pas non plus systématique. Elle est conditionnée à l'adoption de la Décision de la COP puisque l'accord constitue une annexe de cette décision. Cette étape a été franchie le 12 décembre.
Ensuite, il faut que les Etats signent l'accord. Il sera ouvert à signature à compter du 22 avril 2016 - jour d'une cérémonie de haut niveau organisée par Ban Ki-Moon, le secrétaire général de l'ONU. Et ce pour une durée d'un an.
Une fois signée par les 195 pays membres de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, qui ont négocié pendant ces deux semaines de COP, il faut encore que l'accord de Paris soit ratifié par 55 pays, représentant au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, en fonction des procédures prévues par les différents droits nationaux des Etats. Ceux-ci pourront le faire à partir d'avril 2016. L'accord pourra alors entrer en vigueur 30 jours après, au plus tôt en 2018 ont calculé les experts, au plus tard en 2020.
Par ailleurs, un mécanisme de dénonciation existe. Il est identique à celui du Protocole de Kyoto, l'accord précédent celui de Paris mais qui ne concernait que les pays développés. Au bout de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur, une Partie peut le dénoncer à tout moment. Elle prendra effet un an plus tard.
Mais attention pour les pays qui auront ratifié l'accord, "il n'est pas si facile d'en sortir", souligne Michel Colombier, de l'IDDRI. Du moins diplomatiquement parlant. "Certes le Canada notamment est sorti du Protocole de Kyoto mais il faut savoir qu'il a mis longtemps à le faire et qu'il n'a franchit le pas qu'une fois que le Protocole a été politiquement mort".
Précision: Nous avions décrypté le projet d'accord en amont de son adoption le 12 décembre. Il constitue le texte final de l'accord de Paris. Nous avons enrichi son contenu depuis.