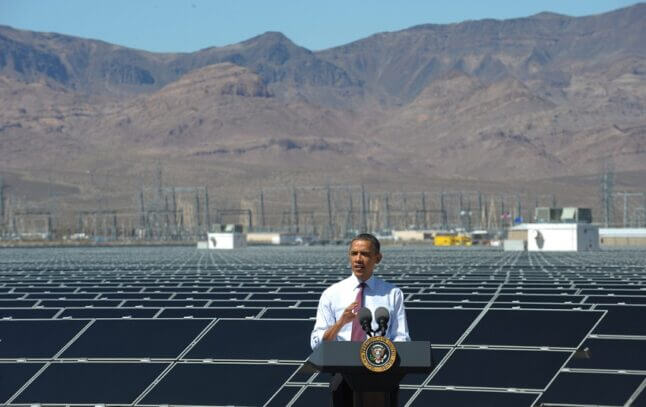C’est un coup de blizzard venu des Etats-Unis. A deux semaines de l’ouverture de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris, le secrétaire d’Etat américain John Kerry a prévenu que l’accord signé "ne serait certainement pas un traité" et qu’il ne contiendrait pas "d’objectifs de réduction [des émissions de CO2, ndlr] juridiquement contraignants", selon des propos rapportés par le Financial Times.
Voilà pourtant des mois que Barack Obama multiplie les signes de bonne volonté, s’engageant par exemple à réduire les émissions de CO2. S’agit-il d’une volte-face ? En réalité, non. L’administration américaine sait depuis longtemps que l’adoption du futur accord parisien sera un casse-tête juridique. Mais des chemins existent pour sortir de l’ornière.
Le Sénat américain, un obstacle infranchissable
La voie classique du "traité" international, celle prévue par la Constitution américaine dans son article 2, prévoit une signature par le président puis une ratification par le Sénat à la majorité des deux tiers. En 1998, le protocole de Kyoto avait ainsi été signé par Bill Clinton mais sa ratification avait été retoquée au Sénat avant que le texte ne soit définitivement écarté par George W. Bush.
Or, depuis plus d’un an, et leur victoire aux élections de mi-mandat, les républicains contrôlent 54 des 100 sièges au Sénat. Une majorité soutenue par les grands lobbys du pétrole et du gaz américain et dont la plupart des membres ne cachent pas leur climato-scepticisme. L’accord en préparation à Paris est "un mauvais coup fait à notre économie et notre sécurité énergétique", a déjà prévenu le sénateur John Barrasso, le chef de file de l’opposition républicaine sur ce dossier climatique, laissant planer peu de doute sur ses intentions si le texte arrivait au Sénat.
Le président américain peut décider seul
Pour éviter cet obstacle, il existe pourtant plusieurs solutions juridiques. La déclaration de John Kerry, aussi abrupte puisse-t-elle paraître, le laisse d’ailleurs entrevoir. D’abord, sur la forme, si le texte signé n’est pas un "traité" au sens de l’article 2 de la Constitution, il peut être d’une autre nature. C’est le cas notamment du "presidential-executive agreement". Cette procédure, déjà utilisée dans le passé pour d’autres accords internationaux, repose sur la seule volonté du président et possède la même force juridique contraignante qu’un "traité".
Le texte signé à Paris pourrait aussi prendre la forme d’un simple accord politique, mais sans aucune portée juridique cette fois, comme cela avait été le cas lors de la conférence de Copenhague sur le climat en 2009.
Le défi du "juridiquement contraignant"
Au-delà de la forme, c’est en réalité le fond du texte qui en est le véritable enjeu. Avec une question centrale : quelles dispositions dans ce texte seront juridiquement contraignantes ? Dans le détail, le secrétaire d’Etat John Kerry a dit refuser de s’engager sur des "objectifs de réduction [des émissions de CO2, ndlr] contraignants". De la même façon, du point de vue américain, il semble qu’il sera difficile de rendre juridiquement contraignantes des dispositions financières, comme la participation au Fonds vert par exemple.
Mais rien n’empêche d’avoir d’un côté un cadre général juridiquement contraignant et de l’autre des textes complémentaires ou des annexes sans force légale. C’est la distinction que voit se dessiner Daniel Bodansky, professeur de droit à l’université Arizona State et ancien conseiller juridique auprès du secrétariat d’Etat sur les questions de changement climatique. "Les accords qui ont une force contraignante contiennent souvent des sous-parties qui ne le sont pas, qui expriment simplement des buts à atteindre ou des recommandations", analyse-t-il.
"Sur cet exemple, l’accord de Paris pourrait contenir certaines obligations autour des contributions nationales (INDC), qu’il s’agisse de les formuler ou de les mettre à jour, mais sans exiger des pays signataires qu’ils mettent vraiment en œuvre ces INDC".
Une stratégie risquée à plus long terme
Cette stratégie américaine de l’accord à tiroirs repose sur la seule volonté des pays participants qui s’entraîneraient les uns les autres, dans un scénario vertueux, à prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique. Mais elle écarte au passage toute idée de contrôle et plus encore de sanctions en cas de non-respect des engagements.
A plus long terme, c’est-à-dire après les élections de novembre 2016, les Etats-Unis auront un nouveau président et un tiers du Sénat aura été renouvelé. Autant de cartes rebattues. Le secrétaire d’Etat John Kerry a ainsi plaidé pour deux autres dispositions intéressantes : le principe d’un non retour en arrière et celui d’un cycle de révision de l’ambition tous les cinq ans. Une manière de graver dans le marbre des engagements minimum en attendant des jours meilleurs.