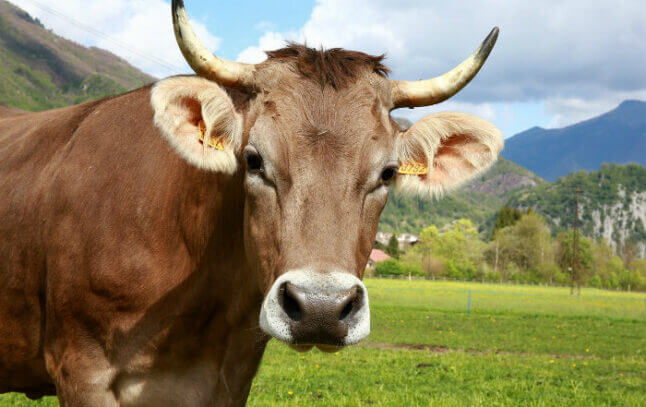Cinq mois après le lancement des États généraux de l’alimentation, voici venu le temps de la loi. Très attendu par les producteurs, le projet est présenté ce mercredi 31 janvier en Conseil des ministres. Si la FNSEA, principal syndicat agricole, se dit satisfaite pour l’instant, les premières limites de la loi se dessinent déjà.
1 - Nous ne sommes pas dans une économie administrée
Le premier volet, économique, vise à "préserver la capacité de production agricole". Autrement dit, il s’agit de rémunérer plus justement les agriculteurs qui traversent aujourd’hui une crise. "C’est la principale condition pour maintenir la souveraineté alimentaire de la France", glisse une source proche de Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture. Pour se faire, le gouvernement compte inverser le processus de construction du prix en partant du coût de production pour établir le prix de vente.
Sur le papier, l’idée paraît bonne. En réalité, c’est un peu plus compliqué. Aujourd’hui, seules deux filières obligent déjà à une contractualisation : la filière lait et celle des fruits et légumes. Sur ces deux filières, la loi pourrait exercer un vrai changement, pour les autres, c’est moins sûr. "Notre choix a été de ne pas rendre obligatoire la contractualisation par la loi", explique le ministère de l’Agriculture. "Mais s’il y a un contrat, il faudra respecter les clauses que nous imposons", ajoute-t-il. "On n’est pas dans une économie administrée mais libérée dans laquelle on dit que les prix ne doivent pas être faits à la sauvage", tranche cette même source.
2 - Les distributeurs ne sont pas obligés d’accepter le prix proposé par le producteur
Autre limite : le poids du producteur. Certes, dans les filières soumises à une contractualisation, les producteurs pourront proposer leur prix aux distributeurs mais ces derniers ne sont pas dans l’obligation de les accepter. D’autant qu’un producteur ne fait pas le poids face à un distributeur.
"Les 400 000 exploitants agricoles pèsent peu face aux distributeurs et industriels", concède le ministère, "mais la loi va justement les inciter à se regrouper en OP, organisation de producteur pour faire pression", explique cette même source. Elle tempère cependant : "la loi ne va pas résoudre le problème de déficit de compétitivité de certaines exploitations".
3 - Produits locaux : les marchés publics interdisent la préférence locale
Enfin, le projet de loi compte réduire les inégalités d’accès à une alimentation de qualité de durable. Pour cela le gouvernement veut atteindre, d’ici 2022, dans la restauration collective, une part de 50 % de produits durables dits bio ou locaux. "La restauration collective, qui fournit aujourd’hui un septième des repas pris en France, a un rôle à jouer dans la réduction des inégalités, avec notamment une capacité à donner accès à une offre alimentaire de bonne qualité nutritionnelle", affirme Stéphane Travert.
Problème : les marchés publics interdisent la préférence locale. Pour "contourner" cette règle l’idée est de prendre en compte l’impact environnement du cycle de vie du produit, en particulier le poids du transport. "Le but est de privilégier des modes de production durable", affirme le ministère qui n'a pas encore fini de plancher sur la question.
Marina Fabre @fabre_marina
Publié le 31 janvier 2018
Le projet de loi issu des États généraux de l'alimentation est présenté ce 31 janvier en Conseil des ministres. S'il porte de belles ambitions, il risque de se heurter à la réalité. Certes la loi va inverser la construction du prix de vente pour qu'elle tienne compte du coût de production mais cette obligation ne concerne que les filières soumises à une contractualisation, soit la filière lait et celle des fruits et légumes.
Découvrir gratuitement
l'univers Novethic
- 2 newsletters hebdomadaires
- Alertes quotidiennes
- Etudes