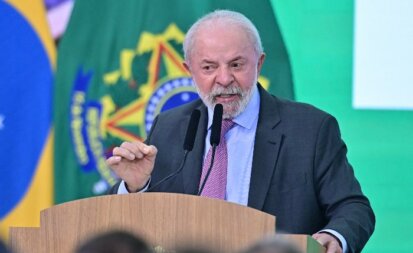"Si la décision est favorable, l’État devra justifier de la manière dont il met en œuvre la lutte contre le changement climatique", explique Corinne Lepage, avocate de Damien Carême, le maire de Grande Synthe. Celui-ci avait saisi le Conseil d’État avec d’autres ONG comme l’Affaire du siècle, en janvier 2019, accusant la France de "non-respect de ses engagements climatiques". Une première étape vient d’être franchie avec les conclusions plutôt favorables du rapporteur public, magistrat chargé de faire une recommandation sur la saisine.
Celle-ci est souvent, mais pas systématiquement, suivie par le Conseil d’État qui va devoir se prononcer sur la réalité de l’action climatique du gouvernement. Il a d’ores et déjà accepté le principe d’un recours d’une municipalité du littoral nord comme Grande Synthe, sur le sujet. La France mène-t-elle ou non une politique qui lui permet de respecter l’objectif de l’Accord de Paris et le cadre posé par les lois de programmations sur la transition énergétique ? "Nous pensons que non et les conclusions du rapporteur nous permettent d’espérer mettre fin à cette phase de communication sur de grands engagements pour entrer dans la réalité de l’évaluation de la réduction réelle des émissions de gaz à effet de serre", explique Corinne Lepage.
Pas le temps d’attendre 2030 ou 2050
Le rapporteur a mis l’urgence climatique en tête de son argumentaire expliquant que "le cœur du sujet est le calendrier des actions" et que les engagements de la France, dans le cadre de l’accord de Paris, des législations européennes ou nationales ne peuvent avoir "un objectif uniquement programmatique mais bien contraignant". Il a ajouté que "renvoyer les requérants à 2030 ou 2050 pour voir si les objectifs sont atteints conduirait à participer à cette tragédie" climatique, car "le risque existe que tout retard soit irréversible".
L’État, qui n’a pas envoyé de représentant à l’audience, a demandé par écrit un rejet des demandes, pour des motifs de forme et de fond. Mais quelle que soit la décision du Conseil d’État, la France aura du mal à échapper au débat sur la réalité de son action climatique dans cette décennie qui commence, période cruciale pour limiter le réchauffement. Le Haut Conseil pour le climat lui a d’ailleurs recommandé, en juillet 2020, de "redresser le cap et relancer la transition".
Caractère contraignant
Une décision du conseil d’État favorable au climat permettra de donner une force juridique à l’Accord de Paris dont le gouvernement conteste dans ses conclusions le caractère contraignant tout comme pour les lois de programmation. S’il suit les conclusions du rapporteur public, cette décision viendra nourrir le risque juridique que représente l’inaction climatique même si elle ne peut pas aller jusqu’au cas des Pays-Bas. Dans ce pays, la Cour suprême a obligé le gouvernement à agir.
La décision du Conseil l’État ouvrira une nouvelle période où l’État devra justifier des actions mises en œuvre. Sauf extraordinaire, les militants pour le climat les mettront à nouveau en cause ce qui ouvrira une nouvelle instruction courant 2021. La bataille judiciaire n’en est qu’à son prélude.
Anne-Catherine Husson-Traore, @AC_HT, Directrice générale de Novethic
Publié le 10 novembre 2020
Saisi par plusieurs ONG et le maire de Grande Synthe, le conseil d’État a examiné le 9 novembre leur recours pour "inaction climatique de l’État". Cette première juridique ouvre la possibilité de faire évaluer et contrôler les engagements de la France sur le climat, année par année, sans attendre le cap fixé pour la neutralité carbone en 2050. Corinne Lepage, avocate de la ville du Nord, fait preuve d’un "optimisme raisonnable" pour cette décision qui devrait être rendue la dernière semaine de novembre.
Découvrir gratuitement
l'univers Novethic
- 2 newsletters hebdomadaires
- Alertes quotidiennes
- Etudes