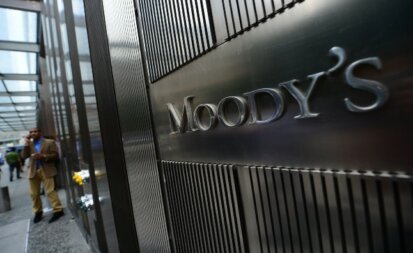Cette fois c’est la bonne. Les 27 réunis vendredi 16 juin ont enfin trouvé un accord sur la directive révisée sur les énergies renouvelables (RED III). Le texte prévoit d’atteindre 42,5% de renouvelable dans la consommation finale d’énergie d’ici à 2030. La France, qui bloquait les discussions depuis plusieurs mois, a obtenu gain de cause sur la prise en compte du nucléaire. L’accord "correspond aux attentes de la France", a réagi Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, dans une déclaration à la presse. Il "acte la reconnaissance du nucléaire dans l’atteinte de nos objectifs de décarbonation", ajoute-t-elle.
Paris demandait qu'en plus de l'hydrogène renouvelable, produit à partir d'énergies renouvelables, l’hydrogène bas-carbone, produit à partir d'électricité nucléaire, la première source d’électricité en France, soit reconnu dans la décarbonation de l’industrie, au risque sinon de ne pas atteindre les nouveaux objectifs fixés par l’Union européenne. Un accord de principe avait été obtenu le 30 mars dernier après de longs mois de négociations, mais la France avait finalement fait volte-face, réclamant de nouvelles garanties.
Feu vert à l’énergie nucléaire
La Commission européenne a finalement dû se fendre d’une déclaration reconnaissant que "d’autres sources d’énergies sans fossile que les énergies renouvelables contribuent à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050". Une façon de donner son feu vert à l’énergie nucléaire. La France a aussi obtenu des concessions sur la production d’ammoniac, dont la synthèse pour les engrais et la chimie est aujourd'hui issue de l'hydrogène fossile.
La directive consacre ainsi que "certaines installations intégrées de production d’ammoniac existantes" pourront être exemptées des objectifs de décarbonation si elles prouvent qu’un "processus de transformation" a déjà été entamé pour éliminer l’hydrogène d’origine fossile au plus tard en 2035. "C’est essentiel pour ces usines qui jouent un rôle clé pour notre souveraineté alimentaire", a commenté la ministre. Le texte doit désormais être validé par le Parlement européen avant une adoption définitive du Conseil.
Ligne de faille
Ce dossier confirme la ligne de faille entre pro et anti-nucléaires au sein de l’Union européenne. Pour parvenir à ses fins, la France est allée jusqu’à créer une alliance du nucléaire, regroupant une quinzaine d'États parmi lesquels la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la Finlande, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède, s’opposant notamment à l’Allemagne et aux "Amis du renouvelables" qui regroupent l’Autriche, l’Espagne, la Grèce, Malte, le Danemark, l’Estonie ou encore le Portugal.
Un bras de fer qui se poursuit sur la réforme du marché de l'électricité actuellement en cours et qui rappelle celui qui avait déjà opposé la France et l’Allemagne sur l’intégration du nucléaire et du gaz fossile dans la taxonomie européenne, une classification des activités économiques ayant un impact favorable sur l'environnement. Des scissions qui révèlent à quel point le Pacte vert, qui doit permettre au continent d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, est fragile. En début d’année, l’Allemagne avait failli faire capoter la loi sur la fin des véhicules thermiques en 2035. Plus récemment, c’est le PPE et l’extrême-droite qui sont montés au créneau contre la loi sur la restauration de la nature. Certains craignent que cela n'ait ouvert une brèche.
Concepcion Alvarez