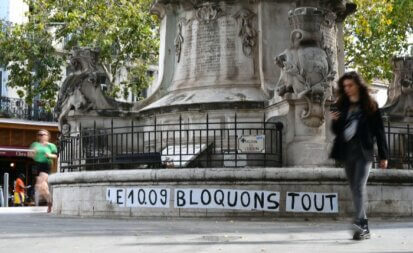Définition simple d’un écosystème
Définition simple d’un écosystème : un écosystème désigne un ensemble d’organismes vivants (plantes, animaux, micro-organismes) qui intéragissent avec leur environnement physique (sol, eau, air) et entre eux.
Ces interactions créent un réseau complexe et dynamique où chaque élément influence les autres. Par exemple, un étang accueille des poissons, des plantes aquatiques, des insectes, et des microorganismes, qui dépendent de la qualité de l’eau et du cycle des nutriments. L’ensemble des écosystèmes abritent les êtres vivants animaux ou végétaux (la biodiversité) et constituent ce que l’on appelle “les espaces naturels” ou “la nature”.
Exemples et types d’écosystèmes
Il existe différents types d’écosystèmes, répartis sur l’ensemble de la planète.
Écosystèmes terrestres
- Forêts tropicales : Situées principalement autour de l’équateur (Amazonie, Congo, Bornéo), elles abritent une biodiversité exceptionnelle avec des arbres géants, des plantes grimpantes, des insectes et des mammifères tels que les jaguars ou les orangs-outans.
- Forêts tempérées : Présentes en Europe, Amérique du Nord et Asie, elles accueillent des arbres à feuilles caduques (chênes, hêtres) et des animaux comme les cerfs, les renards et de nombreux oiseaux.
- Prairies : Les prairies sont un écosystème principalement constitué de zones en herbes.
- Déserts : Comme le Sahara ou le désert d’Atacama, ces écosystèmes arides ont peu de précipitations et une vie adaptée aux conditions extrêmes (chameaux, scorpions, plantes grasses).
- Toundras : Régions froides et peu arborées situées dans les zones arctiques, elles abritent des lichens, des mousses, des rennes et des oiseaux migrateurs.
Écosystèmes aquatiques d’eau douce
- Lacs : Écosystèmes stagnants qui soutiennent des poissons (truites, perches), des plantes aquatiques, et des oiseaux comme les hérons.
- Rivières et fleuves : Habitats dynamiques où vivent poissons migrateurs (saumons), amphibiens et plantes subaquatiques.
- Zones humides : Tourbières, marécages et mangroves fournissent des services essentiels comme la filtration de l’eau et l’habitat pour les oiseaux aquatiques et les amphibiens.
- Écosystèmes marins
- Récifs coralliens : Ces “forêts sous-marines” situées dans les mers chaudes (Grande Barrière de Corail) sont des sanctuaires pour une immense variété de poissons, mollusques, et crustacés.
- Océans profonds : Loin de la lumière, des organismes bioluminescents (comme certains poissons abyssaux) prospèrent dans ces conditions extrêmes.
- Estuaires : Zones où les eaux douces rencontrent les eaux salées, elles hébergent des espèces comme les huîtres, les crevettes et de nombreuses espèces d’oiseaux.
Écosystèmes urbains ou modifiés par l’homme
- Agroécosystèmes : Les champs de cultures (blé, maïs) interagissent avec les sols, les insectes pollinisateurs et les systèmes hydriques locaux.
- Écosystèmes urbains : Parcs, toits végétalisés, et jardins où coexistent les humains et des espèces adaptées comme les pigeons, les hérissons, ou encore les abeilles urbaines.
Comment fonctionne un écosystème ?
Un écosystème est le résultat de l’interaction permanente entre d’un côté :
- Le biotope : l’environnement physique, comprenant les facteurs climatiques, géologiques, et hydrologiques spécifiques à un lieu.
- La biocénose : les communautés d’organismes vivants, qui cohabitent et interagissent dans cet environnement.
En ce sens, un écosystème n’est jamais statique et évolue en permanence autour d’une forme d’équilibre. Ces composantes fonctionnent ensemble, formant des systèmes qui évoluent selon les conditions naturelles et les pressions extérieures. Par exemple, dans une savane, les herbivores consomment les plantes, les prédateurs régulent les populations d’herbivores, et les déjections des animaux enrichissent le sol. Ce cycle favorise une régénération constante. Cependant, des événements naturels comme des incendies, ou des impacts anthropiques comme la déforestation, peuvent constituer des bouleversements pour les écosystèmes.
Des écosystèmes à toutes les échelles
Les écosystèmes existent sous de nombreuses formes et à différentes échelles :
- Locale : un jardin potager, une haie, ou un étang.
- Régionale : une chaîne de montagnes ou une forêt tempérée.
- Globale: les grands systèmes comme les océans ou les forêts tropicales, qui régulent le climat mondial.
Un exemple fascinant est celui du sol, qui constitue un écosystème abritant des milliards d’organismes invisibles mais essentiels pour la fertilité agricole.
Pourquoi un écosystème est dynamique ?
Un écosystème est dynamique dans le sens où les êtres vivants et le milieu qui le constituent évoluent en permanence au fil du temps. Les populations des êtres vivants au sein d’un écosystème peuvent ainsi évoluer en fonction de leurs modes de relation réciproques : les uns sont les prédateurs des autres, d’autres évoluent en compétition, ou en symbiose. Certaines populations peuvent alors diminuer ou augmenter, d’autres peuvent devenir envahissantes, ce qui affecte les autres, sous forme de réactions en chaînes. Par les migrations, certaines espèces nouvelles peuvent être introduites dans un écosystème et le modifier, quand d’autres peuvent disparaître.
Le milieu évolue aussi, en fonction de la température, l’humidité, la lumière, ou encore les ressources en eau et nutriments, qui changent naturellement au fil des cycles saisonniers, des catastrophes naturelles ou d’autres événements. Ces variations influencent la disponibilité des ressources et la survie des espèces. Les cycles biogéochimiques, comme ceux du carbone, de l’azote, de l’eau et du phosphore, sont en permanence en circulation entre les organismes vivants et leur environnement. Ces cycles sont influencés par les activités biologiques et géologiques, entraînant des ajustements continus dans les écosystèmes.
Par ailleurs, des perturbations naturelles ou humaines, comme les incendies, les inondations, les éruptions volcaniques ou l’action humaine (déforestation, pollution, urbanisation, réchauffement climatique), modifient souvent les écosystèmes de façon brutale. Cela force les organismes à s’adapter ou disparaître, ce qui modifie l’équilibre écologique.
Dépendance aux écosystèmes : pourquoi les écosystèmes sont importants ?
Les humains dépendent des écosystèmes pour leur survie, car les services rendus par les écosystèmes sont essentiels pour la plupart des activités humaines. Par exemple, la pollinisation est un service écosystémique crucial assuré principalement par les insectes pollinisateurs (abeilles, papillons, bourdons), mais aussi par certains oiseaux et chauves-souris. En permettant la reproduction des végétaux à fleurs, la pollinisation est essentielle à l’agriculture humaine. De la même manière, les écosystèmes que constituent les sols sont indispensables au maintien de l’agriculture.
Selon un rapport publié par la Banque Centrale Européenne, près des 3/4 des entreprises européennes dépendent ainsi des services écosystémiques de manière critique. Cela signifie que l’ensemble de l’économie européenne a besoin des écosystèmes pour fonctionner de manière optimale.
Dégradation des écosystèmes
Mais les activités humaines modifient également considérablement l’état des écosystèmes naturels, et perturbent lourdement leur fonctionnement. Selon l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), le GIEC de la biodiversité, plus d’un tiers de la surface terrestre est dédié à l’agriculture ou à l’élevage, ce qui entraîne une conversion massive des forêts, des zones humides et des prairies. Depuis 1992, les zones urbaines ont doublé en superficie, exacerbant les pressions sur les écosystèmes naturels. La pollution marine par les plastiques a été multipliée par dix depuis 1980. Elle affecte des centaines d’espèces marines, incluant 86 % des tortues marines et 44 % des oiseaux marins, ce qui perturbe les écosystèmes marins en profondeur. La construction de barrages perturbe les cycles des rivières et les migrations des poissons. L’utilisation de produits chimiques pesticides en agriculture altère les sols et menace les insectes pollinisateurs essentiels aux cultures. Les émissions de gaz à effet de serre contribuent au réchauffement climatique, transformant les habitats et mettant en danger de nombreuses espèces. Globalement, l’IPBES a identifié 5 pressions exercées par les activités humaines sur les écosystèmes :
- L’artificialisation des milieux, comme l’urbanisation, la construction d’infrastructures ou l’intensification agricole, réduit les habitats naturels et fragmente les écosystèmes. Ces transformations forcent les espèces à migrer ou à disparaître.
- Les pollutions et l’utilisation massive de pesticides constituent une autre menace majeure. Les polluants chimiques, plastiques ou organiques contaminent les sols, les eaux et l’air, affectant la santé des espèces et perturbant les chaînes alimentaires. Les pesticides, en particulier, détruisent des insectes essentiels comme les pollinisateurs.
- La chasse, la pêche et la surexploitation des ressources naturelles mettent également en danger de nombreuses espèces. La surpêche, par exemple, épuise les populations marines et perturbe les écosystèmes océaniques, tandis que la chasse excessive peut conduire certaines espèces à l’extinction.
- Le réchauffement climatique agit comme un facteur transversal qui aggrave les pressions sur les écosystèmes. La montée des températures, les changements dans les régimes de précipitations et l’intensification des événements extrêmes modifient les habitats et perturbent les équilibres écologiques.
- Les espèces invasives, enfin, représentent une pression souvent sous-estimée. Ces espèces, introduites accidentellement ou volontairement dans de nouveaux environnements, peuvent supplanter les espèces locales et modifier profondément les écosystèmes.
La préservation des écosystèmes
La préservation des écosystèmes est essentielle pour maintenir les bases de la vie sur Terre, mais cela nécessite d’adopter une vision systémique de la crise écologique. La protection des écosystèmes passe d’abord par la réduction drastique des pressions exercées sur la nature.
Il s’agit par exemple de limiter l’étalement urbain, de promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité (comme l’agroécologie) et de restaurer les habitats dégradés grâce à des corridors écologiques permettant la libre circulation des espèces. L’objectif est également de réduire les pollutions, notamment grâce à une transition vers des modes de production agricole sans intrants chimiques, le développement de politiques de réduction des déchets, et une gestion plus stricte des rejets industriels. Des changements importants doivent être apportés en matière de gestion de la chasse et de la pêche, grâce à une réduction de ces activités et une gestion plus durable, avec des quotas stricts, la préservation des zones de reproduction et la promotion de pratiques plus respectueuses, comme la pêche artisanale. Lutter contre le réchauffement climatique est également une étape clé pour mieux préserver la biodiversité, et cela passe par une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre, des politiques de sobriété énergétique et économique, et la mise en place de stratégies d’adaptation pour les écosystèmes les plus vulnérables. Sans oublier bien-sûr la lutte contre les espèces invasives.
Défis et difficultés liés à la protection des écosystèmes
Malgré des efforts déployés ça et là par certains Etats et de nombreuses ONG, protéger les écosystèmes reste un défi complexe. L’un des principaux obstacles réside dans le conflit entre les intérêts économiques de certains acteurs à court terme et les objectifs écologiques à long terme. De nombreuses activités humaines, comme l’agriculture intensive, l’extraction de ressources ou l’urbanisation, sont difficiles à encadrer car ils sont au coeur d’intérêts économiques, industriels et financiers importants, ce qui tend à rendre leur limitation politiquement et socialement délicate.
La question est d’autant plus complexes que les écosystèmes ne s’arrêtent pas aux frontières, et que leur protection nécessite donc une action coordonnée au niveau international. Or, les politiques de conservation diffèrent d’un pays à l’autre, et les intérêts divergent bien souvent sur les questions écologiques. C’est ainsi que les multiples COP sur la biodiversité, dont la COP16 qui a eu lieu en novembre 2024, se terminent bien souvent par des accords en demi-teinte, et ne parviennent pas vraiment à structurer une politique de protection de la biodiversité sur le long terme.
Enfin, la protection de la biodiversité nécessite également de mobiliser constamment les populations, grâce à la sensibilisation, et à la transformation des modes de vie. Un défi alors que près de 8 milliards de personnes cohabitent quotidiennement avec les écosystèmes et que leurs activités impactent sans cesse la biodiversité mondiale.