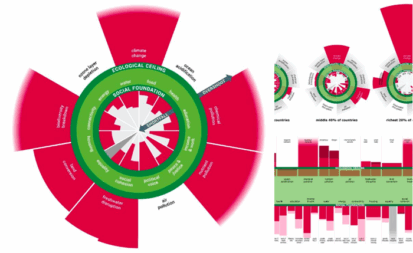Les politiques salariales des entreprises semblent créer de plus en plus de crispations chez les travailleurs. Est-ce un constat que vous partagez, et si oui, comment l'expliquez-vous ?
Elise Penalva-Icher : En effet, la question des rémunérations suscite chez les salariés de nombreuses frustrations. Avant tout, il faut comprendre que contrairement aux idées reçues, en France, les salariés n'ont pas de problème "culturel" à parler de leur salaire et de leurs rémunérations. Lors de mes enquêtes, j'ai interrogé de nombreux salariés qui au contraire veulent en discuter, veulent comprendre comment ils sont payés, comprendre les raisons de leur rémunération. Pourtant aujourd'hui, les entreprises se posent trop peu la question de leurs politiques salariales, alors qu'elles suscitent beaucoup d'incompréhension et d'insatisfaction chez leurs salariés.
Plusieurs facteurs contribuent à cette frustration. Depuis la fin des années 1980, le passage à une économie néolibérale a considérablement transformé les politiques salariales des entreprises. On est passé notamment de rémunérations collectives, définies en fonction de grilles basées sur les niveaux de qualifications, à des dispositifs complexes de rémunération individualisés. On a vu apparaître de très nombreux modes de rémunération, des primes individuelles, de l'intéressement, de la participation, mais aussi des dispositifs encore plus complexes comme l'épargne salariale pour les cadres, etc. La rémunération aujourd'hui est fluctuante, en partie réversible, elle ne rémunère plus seulement le travail, mais parfois une participation au capital de l'entreprise, un rapport particulier à l'entreprise…
Bref, notre rémunération est aujourd'hui beaucoup plus floue, beaucoup plus difficile à comprendre. En particulier, beaucoup de salariés ont du mal à comprendre pourquoi leur rémunération est différente de celle de leurs collègues, quelles sont les justifications aux écarts de salaires qu'ils observent.
Justement, les écarts de salaires contribuent-ils au malaise des salariés sur le sujet ?
E.P-I : Oui, c'est le deuxième point. Comme le démontrent depuis longtemps les travaux de recherche sur le sujet, la question salariale est aussi une question de perception de ce que l'on reçoit de manière relative. Est-ce que ce que je reçois est juste par rapport aux autres, par rapport à mon travail, au contexte qui m'entoure ?
Les salariés ne sont pas opposés à l'idée qu'il y ait des écarts de salaires, et ils comprennent que des différences salariales existent, mais pour que ces différences soient acceptées, elles doivent être justifiées par des principes entendables par le plus grand nombre. Or aujourd'hui, les entreprises sont incapables de justifier certains écarts de salaires. Par exemple, les inégalités salariales entre les hommes et les femmes ne sont plus socialement acceptables et pourtant, elles persistent. Quant aux écarts de salaires entre le salarié moyen et les dirigeants qui affichent des rémunérations stratosphériques, ils sont aussi de plus en plus contestés. On se rend bien compte que ces écarts sont bien trop grands pour être justifiables, bien trop éloignés de toute conception de justice.
Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, avait par exemple tenté de justifier sa rémunération en se comparant aux autres dirigeants de groupes pétrochimiques, mieux rémunérés. Mais cette justification n'est évidemment pas entendable par les salariés, car cette comparaison à une niche d'individus extrêmement minoritaires, avec des salaires si élevés, illustre la reproduction d'une petite classe élitiste par l'entre-soi. De tels écarts placent symboliquement les dirigeants "hors de leur entreprise", d'où le malaise généré.
Comment expliquer que les entreprises persistent avec ces politiques salariales défaillantes ?
E.P-I : La justification de la mise en place de ces modes de rémunération individualisés, c'est l'idée du "mérite" et de la "motivation". On prétend que l'on va rémunérer les salariés selon leur mérite, leur productivité au travail, leur engagement. Le problème, c'est que dans la pratique, il est extrêmement difficile d'avoir des indicateurs qui réduisent le travail à ces notions de mérite et de productivité. Le travail dans une entreprise est nécessairement collectif : on a besoin du travail des autres pour faire le sien, on a besoin d'une organisation adaptée… Il devient donc très difficile pour les managers et les ressources humaines de justifier leurs politiques salariales complexes et individualisées auprès de leurs équipes.
D'autre part, les entreprises utilisent parfois leurs politiques de rémunération pour contrôler leurs salariés, pour les sanctionner, les mettre au placard, les fidéliser… On donne par exemple une prime au jeune dont on ne veut pas augmenter le salaire, ou on enlève sa prime au senior que l'on veut mettre de côté... Là encore, cela crée un hiatus entre l'idée théorique d'une rémunération "au mérite" et la réalité des faits, telle qu'elle est vécue par les salariés. Finalement, on se rend compte que les critères de rémunération ne sont jamais très clairs, jamais vraiment justifiés, jamais vraiment transparents.
Résultat, on voit dans nos études que les logiques de rémunération individuelles et notamment les primes individuelles suscitent presque systématiquement de la frustration dans les équipes. Et on assiste par ailleurs logiquement à une demande de plus en plus forte de transparence et d'équité salariale de la part des salariés.
Cette demande de transparence et d'équité peut-elle pousser les entreprises à changer leurs politiques en matière de rémunération ?
E.P-I : En tout cas, toutes les données montrent que la transparence et l'équité salariale sont des enjeux de plus en plus importants pour les salariés. Et cela devient donc un enjeu pour les entreprises : c'est un enjeu de recrutement, pour attirer les candidats, un enjeu de fidélisation, c'est aussi un enjeu de réputation. On a même des salariés qui, lorsqu'ils constatent des inégalités de salaires dans leur entreprise, commencent à regarder ailleurs… La question des rémunérations peut même devenir un enjeu stratégique, notamment lorsqu'elle devient un risque social, ou une question de vigilance dans les chaînes d'approvisionnement.
Ce sont des questions qui sont éminemment au cœur de la responsabilité des entreprises. C'est à la fois une question sociale, qui pousse à s'interroger sur la question du salaire décent, à la fois en bas et en haut de l'échelle des salaires. Michelin a d'ailleurs récemment mis en place une politique de salaires décents sur sa chaîne de valeur. Mais c'est aussi une question de gouvernance, qui interroge la manière dont on pense et organise l'entreprise. Les entreprises ont tout intérêt aujourd'hui à être capables de proposer une forme de transparence et de justice salariale et de prendre ces questions à bras le corps, car elles deviennent de plus en plus essentielles.
Concrètement en quoi peut consister la mise en place d'une politique de transparence et d'équité salariale ?
E.P-I : Il y a plusieurs degrés de transparence salariale, et cela ne veut pas nécessairement dire rendre publics tous les salaires. L'essentiel est que les entreprises soient capables de justifier l'échelle des salaires et les différences salariales, par des formes de grilles salariales par exemple. L'idée est aussi de permettre aux salariés d'y voir un peu plus clair sur leur rémunération, de comprendre ce qui la justifie et comment elle évolue. Le système des primes collectives est aussi un levier intéressant, qui contribue à la satisfaction des salariés, à leur fidélisation, et permet d'éviter les dérives des primes individualisées.
Quant aux écarts de salaires, on considère généralement qu'un écart acceptable dans une organisation est de l'ordre de 1 à 7 entre les plus bas et les plus hauts revenus. C'est très éloigné des chiffres que l'on observe dans la plupart des grandes entreprises, ce qui montre qu'il est urgent pour les entreprises d'engager une réflexion sur le sujet. Associer les partenaires sociaux, créer une forme de dialogue autour des rémunérations dans les entreprises, penser des outils de rémunération collectifs sont autant de pistes à explorer.
Propos recueillis par Clément Fournier.
*Elise Penalva-Icher, professeure de sociologie à l'université Paris-Dauphine PSL et membre de l'IRISSO, autrice de "La Frustration salariale. A quoi servent les primes ?" paru aux Sorbonne Université Presses.