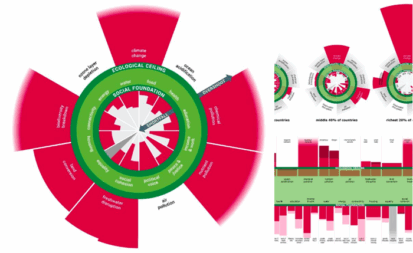"Nous sommes la première nation à présenter un budget vert avec des indicateurs précis, qui prend en compte les dépenses favorables à l’environnement et les dépenses qui le sont moins", s’est félicité Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des finances lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2021. Comme annoncé, le gouvernement a décidé de calculer les parts verte et brune des dépenses publiques en se livrant à l’exercice du budget vert.
Premier constat, les dépenses vertes devraient dépasser de plusieurs milliards d’euros celles qui sont défavorables à l’environnement. Dans le projet de loi de finances 2021, elles s’élèvent à 38,1 milliards d’euros pour le budget prévu pour en 2021, en augmentation de 30 % par rapport au budget précédent. Les dépenses brunes, elles, atteignent 10 milliards d’euros, en baisse de près de 10 % par rapport à l’année 2019.
La méthodologie de la part verte du budget s’inspire de la taxonomie européenne des activités vertes, dont le principe a été adopté cette année. Mise au point par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), elle prend en compte six objectifs environnementaux : la lutte contre le changement climatique ; l’adaptation et la prévention des risques naturels ; la gestion de la ressource en eau ; l’économie circulaire, les déchets et la prévention des risques technologiques ; la lutte contre les pollutions ; la protection de la biodiversité, des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. Pour être considérée comme verte, une dépense doit en respecter au moins un, sans nuire à un autre.
Plus de 90 % neutres
Au total, 4,7 milliards d’euros de dépenses sont ainsi considérées comme mixtes, c’est-à-dire qu’elles ont un impact favorable sur un objectif et défavorable sur un autre. C’est le cas par exemple du transport ferroviaire, dont les faibles émissions de gaz à effet de serre rangent le secteur côté vert, tandis que l’impact négatif sur la biodiversité des infrastructures physiques lui font perdre des points.
Côté dépenses totalement vertes, Bercy cite notamment les 6,9 milliards d’euros de budget dédié au développement des énergies renouvelables, ou encore les 2,2 milliards d’euros de taxes affectées pour les agences de l’eau. Côté brun, le ministère des finances comptabilise notamment les réductions et exonérations de la TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques relative aux carburants), qui représentent 5,1 milliards d’euros.
Ce nouvel outil, qui fera l’objet d’un "jaune" budgétaire (annexe au Projet de loi de finances), doit inciter le gouvernement à accélérer la transition écologique et énergétique, en faisant en sorte de réduire les dépenses brunes et augmenter les vertes. Mais en faisant seulement de petits pas… La grande majorité des dépenses de l’État ne sont pas catégorisées dans cette nouvelle grille d’analyse et reste donc flous. Sur les 488,4 milliards d’euros de l’objectif total de dépenses de l’État pour 2021, seuls 52,8 milliards d’euros sont vertes, brunes ou mixtes. La très grande majorité du budget (plus de 90 %) est considérée comme neutre pour l’environnement, sans impact négatif mais sans effet positif non plus.
Arnaud Dumas, @ADumas5
Publié le 29 septembre 2020
Le ministère de l’Économie et des finances s’est livré pour la première fois à un exercice d’analyse du budget à l’aune de l’environnement et du climat. Sur un total de 488 milliards d'euros, la part des dépenses vertes atteint près de 40 milliards d’euros, en augmentation. Tandis que la part brune est l'inférieur à 10 milliards d'euros. L’immense majorité des dépenses restantes est tout simplement neutre et donc non-orientée vers une transformation durable de l'économie.
Découvrir gratuitement
l'univers Novethic
- 2 newsletters hebdomadaires
- Alertes quotidiennes
- Etudes